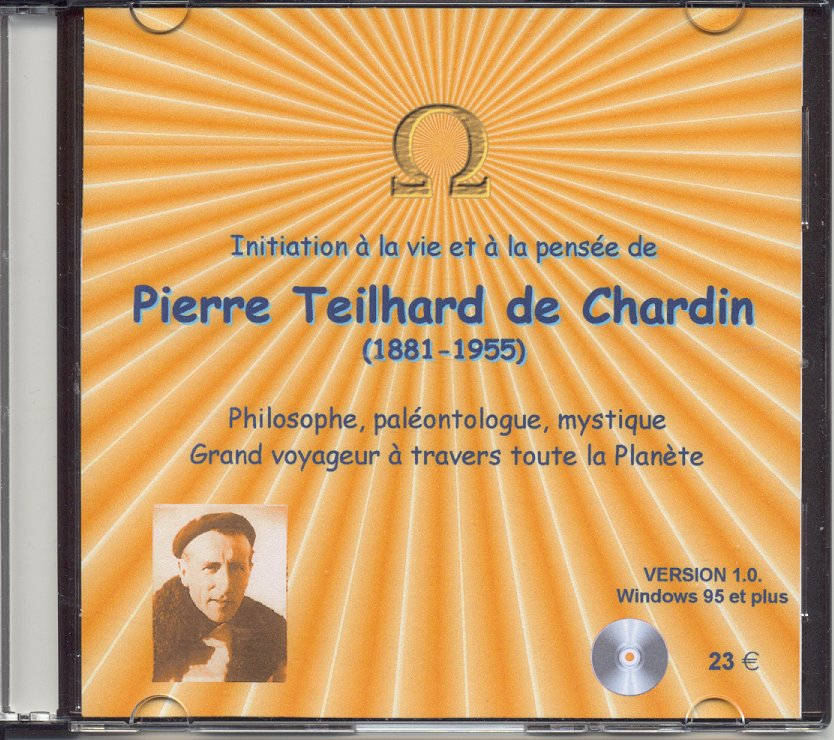INVESTIGATIONS TRINITAIRES (11) – La réponse de Job et au-delà…
INVESTIGATIONS TRINITAIRES (11) – La réponse de Job et au-delà…
Résumé : Face à ses amis, Job proteste, réfute les arguments et engage un procès contre son Créateur à la limite du blasphème. Après de longues disputes, le Créateur se manifeste enfin : seul Job a bien parlé de moi, dit-il, avant de déployer toutes les merveilles de la création. J’interprète le déploiement de la création dans le sens d’une créativité partagée au sein de laquelle l’être humain est un acteur essentiel et qui ouvre une aventure à l’horizon infini.
Face à ses amis contradicteurs, dont j’ai essayé d’analyser les arguments dans l’article précédent, avec projection dans notre actualité, Job, le juste souffrant, tente de répondre. Il ne donne pas de solution, pas plus que le Livre du reste… Nous sommes dans le registre de la « réponse », pas de la « solution », c’est-à-dire celui de la parole et non celui de l’idée et de l’algorithme scientifique ou psychologique. Et donc de la dialectique existentielle.
*
L’expérience contredit les discours.
« Si votre raisonnement est juste, répond Job à ses amis, -traduction avec les mots d’aujourd’hui, à savoir que « tu es malade parce que tu es coupable ou parce que tu es mis à l’épreuve », alors expliquez-moi : la souffrance des enfants et des bébés, et plus généralement celle des innocents, qu’en dites-vous ? » Quand il y a des épidémies, tout le monde est atteint, personne n’est épargné, justes et injustes, bons et méchants, riches et pauvres, savants et simples d’esprit, vieillards et enfants. La maladie se moque bien des culpabilités, des raisonnements religieux et des capacités à lutter.
L’Évangile de Jean présente une scène émouvante et assez drôle d’un aveugle de naissance face à Jésus. Les disciples de Jésus demandent « qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ! ». Jésus répond : « ni l’un, ni l’autre… mais c’est pour que soit manifestée la gloire de Dieu ! ». De quelle gloire de Dieu s’agit-il ? N’est-ce pas pour l’évangéliste une façon de dégager en touche et de réanimer les poncifs spirituels ? Il faut rester prudent dans l’herméneutique ! Je vais marcher sur des œufs pour ne pas être entraîné dans des considérations trop simplistes… L’aveugle-né prend ensuite la parole contre les opposants de Jésus, avec un sens de l’ironie qui vaut la peine d’être relu. En cours d’article, je proposerai une réflexion sur la perspective christique par rapport au combat de Job. Voyons Job et sa réponse.
*
Pourquoi ne pas revendiquer l’innocence.
L’attitude de Job est de défendre, contre toutes ces accusations, son innocence. Mais il refuse d’être seul. Face à ses amis, il supplie qu’on lui trouve un défenseur. Mais où est-il, ce défenseur ? Ses amis ? Il les réfute.
Job revendique l’innocence. L’idée de la culpabilité de tous a servi d’argumentation afin de trouver une explication morale au mal, à la souffrance, à la mort. Malheureusement, elle sert aussi à maintenir des situations d’injustice : j’en ai parlé. Tout le monde est coupable, directement ou indirectement. Il existe un fatalisme, pas uniquement religieux, qui évite de s’interroger sur les mécanismes structurels éthiques et socio-politiques, lesquels conduisent certains à être pauvres et d’autres riches, à être malades ou bien portants, à être doués ou débiles. Il y a même, dans l’arrière-boutique du libéralisme, l’idée selon laquelle la liberté d’action politique et celle de l’entreprise doivent permettre aux meilleurs et aux justes d’arriver à l’abondance, grâce à leurs qualités personnelles et naturelles (par grâce divine), indépendamment du conditionnement physique, social et économique… La solidarité sociale n’est qu’accessoire ou seconde ; elle sera un effet de la bonté des riches dont les biens, chèrement acquis, ruisselleront vers les miséreux, les nécessiteux, les malades et les faibles. Les capitalistes sont des gens vertueux. Ceux qui combattent le capitalisme sont des jaloux et des haineux.
Omission des conditions sociales et économiques. De plus, pense-t-on, il y a transmission de l’injustice d’une génération à l’autre, le riche transmet à ses enfants ses biens, le pauvre transmet à sa progéniture ses tares. Là, l’idée d’une transmission d’un « péché originel », comme structure d’injustice, retrouve, de manière détournée, du sens. On peut élargir.
Malheureusement, explique Job avec les mots de son temps, dans son contexte immédiat de société religieuse et de morale familiale, l’expérience démontre le contraire. Il n’est pas nécessaire d’être dans la situation de Job pour s’en apercevoir. Les maladies et la mort frappent les justes et les injustes, les innocents et les coupables, les riches et les pauvres, les génies et les handicapés. Au-delà d’un certain seuil, le mal est indifférent aux conditions sociales, morales et naturelles des femmes et des hommes.
J’ai le souvenir de cette anecdote qu’on raconte à propos d’une responsable de monastère -sans doute, Claire d’Assise-. Elle explique que si une sœur casse une assiette, elle lui donne une réprimande. Mais si cette sœur met le feu involontairement au couvent et que tout est détruit, quel sens aurait une réprimande ? Ceci les dépasse toutes les deux.
*
Sauveur ou défenseur ?
Job demande un défenseur. Ici s’introduit une bifurcation. Les amis de Job et nombre de moralisateurs religieux ou laïques affirment que face à la culpabilité, nous avons besoin non d’un défenseur, mais d’un sauveur. Le défenseur, l’avocat, défend l’innocence de son client. Le sauveur arrache le coupable de son état de malheur, de sa faute, même s’il n’en est pas directement responsable. La perspective est différente.
Nombres d’églises, dans le Christianisme, ont hypertrophié l’image du sauveur, en l’occurrence celle du Christ Jésus… Le nom Jésus signifie « Dieu sauve », Dieu au sens du tétragramme. De plus, il est présenté comme l’innocent condamné, ce qui ajoute du poids à la culpabilité de ceux qui l’ont condamné, sous-entendu nous tous. Le Christ sauveur a souffert pour les fautes que nous avons commises, pour les péchés. Nous souffrons parce qu’il faut payer l’addition avec lui… ou sans lui. L’esprit de la dette évoquée dans l’article précédent envahit le champ de la réflexion. Il existe une analyse de la Passion qui est un terrible piège pour la liberté et la vie spirituelle. Une telle présentation place les églises dans la position des amis de Job. La revendication de Job est pervertie. Lui, Job, demande que soit reconnue son innocence et il appelle un défenseur.
À mes yeux de lépidosophe, le schéma Création-Péché-Salut m’apparaît très superficiel face à la souffrance, en dépit des terribles débats et conflits qui ont eu lieu dans l’histoire à son propos. Il y a une dimension au-delà de ce schéma réducteur : c’est celle de la souffrance de l’innocent face à l’étendue du mal qui déborde de partout nos responsabilités et a fortiori nos capacités de le résoudre.
*
Innocence et culpabilité métaphysique.
Le Livre de Job déplace la question de la culpabilité personnelle, sociale ou héréditaire vers un autre niveau. Dans l’article précédent, je l’ai évoquée à travers l’idée de « culpabilité métaphysique ». De quel droit le fait d’exister, sans l’avoir choisi, rend-il coupable et engendre-t-il la souffrance personnelle ? Pourquoi l’existence place-t-elle le sujet en situation de dette ? Faut-il rendre au Créateur cette vie qui est donnée sans consultation ? Et puis, je suis là, dans cet espace particulier, dans ce temps, avec des conditionnements ontologiques, sexuels, socio-économiques, physiques ! Sans rien demander. Et maintenant, serais-je redevable d’une dette ? Pourquoi suis-je né ? Pour souffrir ?
Job maudit le jour de sa naissance. Il n’en peut plus. Le chapitre 3 du Livre de Job est bouleversant : « périsse le jour où je suis né !… Qu’il se change en ténèbres… Cette nuit, qu’elle attende en vain la lumière, car elle n’a pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le sein de ma mère ? Pourquoi n’ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles ? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m’allaiter ? Je serai couché maintenant, je serais tranquille, je dormirais, je reposerais… »…
La situation de Job et de nombre de souffrants m’a souvent fait dire et écrire que certaines souffrances peuvent être perçues comme des situations pires que la mort. La mort est le retour au rien, au zéro. La souffrance, et plus encore la souffrance de l’innocent, est négative ! La preuve : l’homme ou la femme qui souffre, réclame la mort, le zéro, comme un bien préférable à sa situation négative. Le chemin du bonheur vers le malheur est plus vertigineux que celui du bonheur vers la mort, vers le rien, et inversement. La chute dans un gouffre est pire que celle sur le sol. S’il faut en plus entendre les bavardages des bien-portants et des vertueux, la solitude semble encore plus profonde. Il ne reste au souffrant que le cri, que le silence qui enveloppe le cri, que le silence où le cri s’est perdu. Longtemps, dans un contexte de moralisation religieuse extrême, les suicidés qui ne supportaient plus leur état de souffrance ont été maudits ! Les sciences psychologiques et psychiatriques, et l’éthique philosophique, ont heureusement rétabli la réalité de ce qu’est le mal, par-delà les apologies de la culpabilité.
Bien sûr, il y a des maux dues à la responsabilité humaine. Si je frappe quelqu’un, si je répands la calomnie, etc., il y aura des retours de bâton. OK. Une des forces de l’histoire humaine est d’avoir su se munir, contre les méfaits responsables, d’un droit et d’une justice, avec accusations, défense, avocats, procureur et… un juge. Il est tellement plus simple d’être accusateur ! Le juge a la Loi et la jurisprudence, et donc la collectivité et l’histoire, avec lui. Mais au-delà de la capacité humaine au jugement, au soin, à la connaissance, il existe des maux contre lesquels il est difficile de poser une appréciation justifiée. Il n’est pas facile, comme cela a été évoqué dans l’article précédent, de naviguer entre ces trois récifs : celui de la moralisation à outrance qui, sous prétexte de responsabiliser chacun, le culpabilise ; celui du fatalisme qui conduit à l’inaction et parfois décharge les monarques et les administrations de leur responsabilité ; et celui d’une justification religieuse qui se résoudrait dans la dialectique de l’épreuve et de la conversion. À ces récifs, ajoutons le tourbillon de l’explication rationnelle de la souffrance et du mal, sous l’angle philosophique, scientifique ou politique. Job conteste toutes ces mauvaises solutions.
Voilà le drame ultime de Job : la maladie est absurde. La souffrance de l’innocent est absurde. L’existence peut-être même est absurde ! A-t-elle une raison d’être, si mon être est atteint, si je dois souffrir sans raison ? Si j’ai eu le bonheur d’avoir vécu dans telle ou telle circonstance favorable, la souffrance est-elle une manière de rendre une dette, parce que j’ai joui de la vie qui m’est donnée ? Si le mal est pire que la mort, alors pourquoi vivre ? Pourquoi exister ? Pourquoi un tel monde existe-t-il ? Job veut mourir.
*
La piste incomplète du plus grand bien
La traversée de la souffrance et du mal ne trouvent pas non plus d’explication dans un plus grand bien, ai-je expliqué dans l’article précédent, que ce soit en Adonaï, dans un au-delà, que ce soit encore dans une utopie politique et sociale, ou dans un retour à la Nature. Un grand bien a priori, et programmé, j’entends. Il a existé et il existe encore des cynismes politiques qui sont prêts à justifier des massacres ou des morts au nom d’un plus grand bien. Lors de la crise du coronavirus, on l’a bien vu : certains responsables de nations étaient prêts à sacrifier une partie de leur peuple, pour maintenir l’économie du pays et l’état de leurs finances… qu’ils considéraient comme un plus grand bien. Nous pouvons dire merci à Kant, à l’Esprit des Lumières, aux Déclarations des Droits de l’Homme, d’avoir placé la dignité humaine avant tous les intérêts économiques et avant toutes les idéologies.
Le Dieu tout puissant, tout connaissant, tout libre ou tout transcendant est mis en procès depuis le début de ces articles. L’idée d’une réparation des fautes et d’un salut qui à la fois culpabilise et infantilise les femmes et les hommes, comme des parents qui prennent en faute leur enfant, ont eu leur temps et ont induit nombre de dégâts spirituels. Les explications religieuses, morales et intellectuelles, théologiques, se pensent objectives, vraies, neutres, au-dessus de la mêlée. Mais le sens du vécu subjectif de la souffrance innocente et de celle du juste est omis et il reste insoluble. Il est inacceptable de donner raison au mal. Il est comme un grumeau que le discours rationnel ou symbolique ne parvient pas à dissoudre. Job se refuse à ces solutions toutes faites.
*
La révolte contre Dieu. Le droit au procès et au blasphème.
Face au mal qui le ronge, expose le Livre, Job se révolte. Il retourne l’accusation et met Adonaï en procès. Ce n’est pas lui le coupable, c’est Adonaï. Toutes ces belles constructions religieuses, rituelles, morales s’effondrent. L’athéisme existentialiste reprend le procès de Job et complète les athéismes qui vitupèrent contre les pouvoirs qui ont exploité les pauvres et les exclus.
Je me permets ici une parenthèse très importante : dans l’univers biblique, l’innocent et accusateur Job parle à Adonaï à la deuxième personne comme s’il s’adresse à un sujet, alors que les grands athées du Dix-Neuvième Siècle parlent de Dieu à la troisième personne, comme d’un objet. Ce point est important pour la suite de notre méditation. Continuer à parler, même quand tout devient absurde… Nous sommes dans le registre de la question et de la réponse, et non dans celui d’un problème et de sa solution. Il s’agit de celui de la parole et non celui des idées.
Ce point nous ancre un peu plus dans le sujet. Le mal, la maladie, la souffrance dérange un ordre établi et l’entourage. Soit. Mais la révolte, le cri, le blasphème de celui qui souffre, dérangent plus encore cet ordre établi. Avec les mots, avec le pouvoir de la parole et le hurlement de l’esprit, Job touche l’humain dans ce qu’il a de plus spécifique, dans sa condition de sujet. Le risque est celui de la solitude. C’est celui que prend Job. La souffrance n’est pas seulement un scandale objectif, elle atteint le sujet, le moi profond.
Certes, on peut se révolter à plusieurs. OK. La révolte collective fonctionne jusqu’à un certain degré. Mais elle dissout la douleur subjective dans un bain collectif où les acteurs qui la gèrent ne prennent souvent plus le temps de l’écouter. Dérive, pardon de le ressasser, de la parole vers les idées. La révolte qui est évoquée ici est au-delà de la revendication sociale et politique, au-delà d’une formulation objective de la situation de souffrance. Elle est infiniment personnelle, irréductiblement subjective. Elle déborde celle des revendications collectives.
*
Impuissance ou sadisme divin ?
Contre Adonaï, contre la Providence, contre le Destin, la révolte et le procès s’expriment en trois propositions, des propositions que l’on retrouve, par exemple, dans l’ouvrage de Hans Jonas sur Auschwitz, plus que dans le Livre de Job à proprement parler :
1) Si Adonaï est tout-puissant, pourquoi laisse-t-il le mal se déchaîner ? Serait-il impuissant contre le mal ? Vieux et vertigineux sujet religieux, et même philosophique et scientifique. Job et Jonas renvoient l’énigme du mal à la philosophie. Quoique insoluble dans des solutions simples, apparemment logiques, objectives ou conceptuelles, quoique inachevée à travers des techniques et des moyens instrumentaux, l’énigme de la souffrance doit pouvoir être saisie par des mots, par un langage qui permet sa circonscription : imaginaire, littéraire, poétique et dramatique, dialectique, révolte et cri… Tant que Job continue à parler, à crier, à hurler, même contre d’apparentes évidences, le mal n’a pas raison. Pouvoir de la parole contre les idées. Adonaï, celui du début du Livre de Job, paraît bien impuissant !
Ici, je transpose cette situation dans le monde médical et face à l’administration, suite à des parcours que j’ai proposés à plusieurs reprises dans des milieux de soignants, et dans la ligne d’une expérience personnelle de la maladie. La révolte se traduit ainsi : « non, vous n’êtes pas tout puissant ». Bien sûr, jamais un soignant ou un médecin ne prétendra être tout puissant. Toutefois, bien souvent, le corps médical et son arrière-fond scientiste aspirent à la toute puissance. Même chose du côté des services sociaux, de l’administration et des mutuelles de santé. Ces derniers temps, il a fallu l’épidémie du Covid-19 pour secouer le paradigme de la toute puissance médicale, comme présupposé de la puissance politique… ou inversement le paradigme politique tout puissant qui enveloppe la puissance médicale.
2) La seconde proposition de Job se situe dans l’attribut de bonté divine. Si Adonaï est bon, pourquoi persécute-t-il ceux qu’il aime ? Quel bien curieux amour qui fait souffrir l’être cher ! Du pur sadisme ! Pas de l’amour, en tout cas… J’ai déjà invité le lecteur, dans un article antérieur, à mettre en procès certaines notions sur l’amour de Dieu, afin, non de le nier, mais de lui donner un autre sens que celui d’une condescendance divine d’un côté, et celui d’une affectivité excessive ou défective de l’autre. Job crie qu’Adonaï est un chasseur qui traque une proie : hop, une flèche par ci, hop un coup par là. Ce Dieu-là ne peut être bon.
Il est possible là aussi de projeter cet énoncé dans le cas du malade face à son médecin ou au personnel soignant. Le malade est traqué jusque chez lui, parfois sous des formes froides. Parfois même, le corps médical de certaines institutions essaie de débusquer des malades pour obtenir des subventions… Et qu’en est-il de l’acharnement thérapeutique ? Est-il vraiment de la bonté d’âme, de l’humanisme ? Veut-on nier la souffrance vécue comme expérience plus négative que la mort ? Ne peut-on pas laisser les personnes âgées ou en fin de maladie mourir tranquillement chez elles ? Attention ! Je ne me prononce pas sur la validité morale de l’acharnement thérapeutique. Chaque situation est unique.
Voici l’aporie traditionnelle, sous-jacente à la révolte de Job, et récemment posée par Hans Jonas : si Adonaï est tout puissant, il ne peut être bon. Si Adonaï est bon et amour, il n’est pas tout puissant. Ou alors acceptons que son dessein est inconnaissable. Hans Jonas refuse cette troisième alternative, qu’a en revanche adoptée le Coran : Allah, l’équivalent de l’Elohim biblique, est insondable : la souffrance appartient au mystère divin. Et hop, le Coran envoie le ballon dans les tribunes, ce que j’ai souvent tendance à lui reprocher. Transcendance ! Autant se taire ! Hans Jonas, lui, face à l’aporie, opte pour l’impuissance divine, en s’appuyant sur des traditions de la spiritualité et de la mystique juives, notamment celle de la Kabbale. Job également, d’une certaine manière.
Certaines spiritualités juives et chrétiennes ont essayé de répondre à l’aporie en affirmant que Dieu souffre avec les souffrants. Israël est le messie souffrant, ou le serviteur souffrant. Le Christ Jésus est l’image du Dieu souffrant avec les hommes. Oui, pourquoi pas ? Toutefois l’accent est alors porté sur la passion au détriment de l’action et de la créativité, au risque de sombrer dans un dolorisme qui agace prodigieusement nos contemporains.
Et Auschwitz ? Et l’effondrement des civilisations ? Et les génocides ? On peut imaginer qu’à l’instar de la vie individuelle et familiale, les cultures et les civilisations meurent également selon la nature des choses et de l’histoire – cynisme de ma part, bien sûr -, de même que les espèces animales et végétales s’éteignent. Hitler et sa bande de crapules deviennent alors des instruments du Destin, de la Fatalité ou de la nécessité biologique étendue à la noosphère. Piège qui fait basculer la contradiction vers le fatalisme.
J’invite à garder de la distance vis à vis de toute « solution », que le Livre de Job, du reste, ne propose pas. Nous pouvons tenter de maintenir le cœur près de la misère, d’être « miséricordieux », comme le dit une notion religieuse vieillotte. Ce n’est pas simple. En rester là serait incomplet et bien triste !
*
Pour un juste équilibre, il est préférable de conserver à l’esprit et méditer la dialectique action-passion, et son corollaire responsabilité-innocence sans en essentialiser l’une ou l’autre. Sachons toutefois, comme le rappelle Pierre Teilhard de Chardin dans un remarquable petit traité de spiritualité, que la dimension des passivités et donc des souffrances, est bien plus vaste et profonde que celles des activités.
Ici survient une autre trappe : celle de la victimisation de l’innocent. La victimisation, affective ou justiciable, n’est pas plus efficace que la confiance absolue en la toute puissance, qu’elle soit divine ou humaine, religieuse ou naturaliste, spirituelle ou scientifique. La parole du juste qui souffre doit être entendue en vérité, c’est-à-dire dans son innocence et non dans son état victimaire, même si parfois l’état de victime est réel. Ce n’est pas le cas de Job -sauf par rapport au Satan-. En ce sens, nous le verrons plus loin, l’approche trinitaire peut offrir une direction prometteuse à cette dialectique, sans sombrer dans des schémas simplistes du style péché-salut ou souffrance divine par empathie, ou confiance en l’humanisme universel… ni prétendre y trouver une « solution ».
Un mot sur la prière. La prière, tant décriée dans les milieux forts et sarcastiques, trouve ici une de ses significations. Laquelle ? La révolte et le cri sont des invariants des psaumes bibliques, et le cri de Job a un parfum psalmiste. Le blasphème fait partie de la prière. Oui, et je le maintiens contre les dragons de vertu religieuse et contre les semeurs de mort de certains courants intégristes et fondamentalistes. Malgré tout, Job ou le psalmiste, à travers le blasphème et la révolte, conservent la relation avec Adonaï, échangent une parole avec Lui, ne se taisent pas, même quand les événements portent vers la souffrance et la mort. Dans le Judaïsme, m’a un jour expliqué un rabbin, on peut être pour Adonaï ou contre Adonaï, mais jamais sans Adonaï. Faire disparaître la prière, refuser la révolte, hurler contre le blasphème, c’est tuer la parole, c’est détruire la communication et toute communication… Job est accusé de blasphémer. Ce blasphème est une prière. Le Christ Jésus a aussi été condamné à mort pour blasphème. Non : la prière peut et doit parfois aller jusque là.
*
Injustice divine.
3) Dernier point de la réponse révoltée de Job, Adonaï est injuste. Ou très exactement, Adonaï, tu es injuste. La justice divine est prise en défaut. La raison divine est prise en défaut. En d’autres termes, le mal n’obéit à aucune logique rationnelle ou religieuse. L’univers dans lequel nous vivons est fait de cohérence et d’incohérence, d’apparente logique et d’absurdité, de raison et de déraison. Les deux !
Voilà un paradigme d’arrière fond, un horizon fuyant, qu’il faudra conserver à l’esprit tout au long de notre navigation. « Tu ne mettras pas Adonaï à l’épreuve », dit la Torah et le récit des tentations dans les Évangiles. Et pourtant : Job ne craint pas de mettre son Dieu en procès.
*
La passion du Christ résout-elle la souffrance de Job, le juste ?
Dans ma jeunesse, j’ai croisé des courants religieux catholiques qui estimaient que, dans le Christianisme, la Passion du Christ et la Résurrection offraient une réponse à la souffrance de Job. Et ils ajoutaient que l’Église Catholique symbolisait cette réponse. Je n’entrerai pas dans l’analyse de cet ajout. En revanche, la première proposition a de la valeur, puisqu’elle a conduit à un bouleversement historique et à de grands déploiements culturels, littéraires et artistiques.
Pour répondre à cette affirmation, il est important de déployer toutes les facettes : innocence ou culpabilité ? Fatalité ou responsabilité ? Le Christ Sauveur ou Défenseur ? De quel côté se situe le Ressuscité ? Du côte de son Père ou du côté des femmes et des hommes ? Du côté de Zorro, le sauveur des victimes, ou du côté de la solidarité avec les souffrants ? Et la création là-dedans, quel sens a-t-elle ? Création du monde, oui, mais plus encore création d’un être conscient et sujet de sa propre histoire ?
Une bonne philosophie, même lépidosophique, répond que le « ou » est abusif : chacun des points de vue est analysable et peut-être même à reconstruire dans une méthodologie dialectique ou organique. Par exemple, pourquoi ne pas lire l’épopée christique à la fois comme celle d’un sauveur et celle d’un défenseur. L’enfant qui se noie dans une piscine a besoin d’un maître nageur, donc d’un sauveur, et non d’un avocat qui explique autour de lui qu’il ne l’a pas fait exprès. Je prends l’exemple d’un enfant à dessein. Dans un second temps, le sauveur ne servira plus : c’est le défenseur de l’enfant qui reprend la main, contre la maman ou le moniteur qui voudront l’engueuler. Par conséquent, pourquoi les chrétiens n’accepteraient-ils pas le double rôle de leur Christ : sauveur et défenseur. Le souci, c’est que le premier aspect a été hypertrophié, et le second effacé dans l’histoire. Le dogme du péché originel n’a rien arrangé. En réalité, en théologie trinitaire, la dualité existe.
Signalons en effet que dans l’Évangile de Jean, Jésus parle d’un défenseur qu’il appelle par ce mot étrange « le Paraclet », qui représente dans le contexte johannique l’Esprit ! Le Mystère Trinitaire sort du brouillard et se dessine à l’horizon.
Je reste toutefois réservé sur la démesure qu’a pris dans l’histoire et la spiritualité l’idée du Dieu Sauveur dans la personne du Christ Jésus. L’idée est peut-être consolante et nécessaire, mais elle n’est pas suffisante. Qu’une petite partie de l’enjeu soit la « réparation du péché », le nettoyage de « la faute originelle » qui explique la souffrance, et autres fadaises, je veut bien l’accepter comme hypothèse. Mais elle me paraît une bien basse idée de l’interrogation sur la Passion et de la Résurrection. Elle omet plusieurs aspects : d’une part, comme cela a été dit, la défense de l’innocence du souffrant, ce que justement revendique Job ; le sens de l’histoire et de la durée : sauver, cela semble une action immédiate et instantanée, mais il n’y a pas beaucoup de place pour la parole, pour la Justice, pour le « process », au sens où je l’entends, c’est-à-dire le Procès Créateur (le Credo chrétien parle du « Process » de l’Esprit) ; enfin, s’arrêter au simple Salut oublie la dimension à laquelle j’attache tant d’importance, à savoir la Création, sa longue genèse, et plus profondément, la signification de la Création et de l’existence… une Création qui, dans notre conditionnement physique et cosmique, est une vaste dérive, une évolution des entités vers plus de vie et de conscience.
Le Christianisme n’est pas seul à tenter d’assumer une réponse au cri de Job, sous l’angle de la Passion. La tradition juive a adopté l’idée selon laquelle le peuple juif était le peuple messianique, avec en arrière-fond la figure du Serviteur souffrant que l’on trouve dans le Livre du Prophète Esaïe.
Par ailleurs, bien des penseurs, des philosophes, ont également tenté de démontrer que la souffrance surmontée des peuples est la véritable source du sens de l’histoire, voire de l’existence elle-même. La lutte des classes peut être lue comme une douteuse, mais réelle, projection de la Passion christique au plan social, de même que la loi de la jungle et les combats dans la nature permettraient, explique-t-on, l’amélioration des espèces. La souffrance est-elle rédemptrice, voire créatrice ? Dans un article précédent, j’ai déjà exprimé ce que je pensais de cette double proposition. Non, ce qui est « rédempteur », c’est le combat mené contre le mal… et l’histoire de l’humanité court dans ce sens : médecine, droit, sciences, religions, pensée, arts, littérature, musique, toute la vie de la Noosphère rappelle le combat permanent contre le mal. Mais attention de ne pas voir l’épopée humaine exclusivement sous l’angle du combat, au risque d’une surenchère éthique. Il demeure ici une autre perspective : celle de la création et de l’alliance. Ce sera l’objet des prochains articles.
*
Comment interpréter la dernière partie du Livre de Job ?
Les lignes suivantes relèvent plutôt d’une herméneutique encore plus personnelle que les lignes précédentes. Elles anticipent ce que j’écrirai plus loin, sous l’aune de la navigation trinitaire.
La partie dialectique du Livre de Job met, enfin dira-t-on, le grand accusé en scène : Adonaï. Tout le monde a parlé de lui, mais lui, n’a rien dit. Adonaï sort de son silence après avoir laissé Job et ses amis débattre durant des pages et des pages… À la fin du Livre, il est écrit que la colère d’Adonaï s’enflamme contre les amis de Job, forme ancienne pour demander d’arrêter les bavardages sans fin. Il affirme ensuite : « le seul qui a bien parlé de moi, c’est mon serviteur Job ». En d’autres termes, celui qui s’est révolté, qui a revendiqué son innocence contre toutes les accusations, contre toutes les explications rationnelles ou morales, celui qui a intenté un procès contre Adonaï lui-même, jusqu’au blasphème, est le seul à avoir « bien parlé de lui ». Comme si Dieu se manifestait aujourd’hui en disant : les athées existentialistes, les non-croyants, les blasphémateurs, ont raison quand ils se révoltent contre le mal, contre l’injustice, contre la souffrance de leurs sœurs et de leurs frères… voire contre les méfaits qu’on impose à la biosphère. Ils ont raison quand certains, religieux ou moralistes, s’arrogent le droit de faire la leçon aux souffrants, de se servir de la souffrance pour les manipuler, de donner des explications simples au mystère du mal. Ceux qui parlent vrai et sensé ne sont pas ceux qui le justifient par des manipulations religieuses, des doctrines, des discours lénifiants, style « New Age », quiétisme (oriental ou non), stoïcisme… La souffrance a droit à la parole. Ce n’est pas le loup de Vigny : « souffre et meurs sans parler ».
Qu’on soit clair : il s’agit là d’un contexte qui est celui de la souffrance intolérable de l’innocent dans un contexte familial et personnel. Le Livre de Job ne parle pas de la haine, du mensonge ou de la suffisance qui peuvent habiter certains anti-religieux primaires et certains intégristes. La haine est complètement absente du Livre. Bien au contraire. Le mensonge également. Job n’est nullement orgueilleux. Il est simplement humain. Et là est le lieu où tous les théismes et athéismes se crashent. Où tous les faux-fuyants, agnostiques, métaphysiciens, moralistes, se dissolvent. Et pourtant, le Livre écrit que seul Job a bien parlé d’Adonaï, de son Dieu.
Adonaï montre alors qu’il souffre avec ceux qui souffrent, thème récurrent de toute la tradition biblique, juive et chrétienne. Cette fois, il le démontre lui-même. Un travail d’enfantement ? La vie a-t-elle un prix si élevé qu’elle doit traverser les douleurs de l’enfantement ? Prudence, naturellement. Je renvoie à ce que j’ai écrit de l’intuition de Dietrich Bonhoeffer, dans l’article précédent. Propos à ne pas dire à un malade qui sait qu’il va mourir ! Quoique ! Qui sait ? Une lueur est pourtant possible dans cette direction, mais j’ai déjà exprimé ci-dessus ma réserve à l’égard d’un discours excessif sur la souffrance divine, dans la mesure où elle hypertrophie la passion au détriment de l’autre dimension, celle de l’action et de la création.
*
L’Hymne à la création
Le Livre de Job, en effet, s’achève par un formidable hymne à la Création qui est un des plus beaux parmi la « bibliothèque biblique ». Oh, il n’offre pas une solution à l’interrogation de la souffrance. Mais il ouvre une piste. Même si la théophanie, c’est-à-dire la manifestation divine, demande à Job et à ses amis de se taire et d’écouter ce qu’elle a à dire, elle n’empêche pas Job de répondre… Elle a été précédée par un premier discours sur la Création, un peu obscur il est vrai, d’un des amis de Job, le jeune Elihu. L’hymne de la Création de la Théophanie commence par « Quel est celui qui obscurcit mes plans par des propos dénués de sens ? ». Je trouve ce verset très drôle. Il vise sans aucun doute Elihu. Puis elle se tourne vers Job : « ceins tes reins comme un brave ». L’hymne divin à la Création prend la forme de l’adresse personnelle, celle d’un appel à la réponse : en gros, « tu n’étais pas là, quand je fondais la Terre, quand j’assignais l’aurore à son poste, quand les petits des bouquetins crient vers Elohim… ». La théophanie parle à Job à la deuxième personne, ce qui signifie qu’Adonaï le considère comme un sujet qui peut, voire qui doit répondre. Ce n’était pas le cas du discours d’Elihu.
J’interprète l’hymne de la Théophanie, à titre personnel, dans trois directions.
Tout d’abord, la question du mal reste un mystère, une pierre sur laquelle chacun trébuche et qui n’a pas de raison d’être en soi. J’espère avoir suffisamment insisté sur ce point dans les lignes qui précèdent, même si une part de responsabilité dans le mal existe chez les êtres conscients. Au-delà d’un seuil, l’énigme demeure. Je ne suis pas sûr que le récit de Job cache une apologie du « plus grand bien ». Le texte montre plutôt une bascule entre le mystère de l’absurdité du mal vers celui de l’être, au sens métaphysique du terme. Le miracle n’est pas la guérison du mal ou le salut, mais l’énigme de l’existence d’un monde. Comme je le montre, le déploiement du monde est un « process », aux deux sens du terme : processus et procès. Il est une montée de l’Esprit aux deux sens du terme : émergence de sujets libres et souffle créateur.
D’autre part, l’hymne à la Création correspond à une remise en place de l’expérience religieuse. Le Livre de Job est le passage de l’angoisse à l’émerveillement, d’une religion de crainte -début du Livre- à une religion de l’étonnement. Originellement, certains historiens des religions fondent le sentiment religieux et leur structuration rituelle et morale sur la dualité tremblement-fascination. La peur et le vertige, ai-je tendance à penser : sur le sommet d’une montagne ou seul sur un voilier au milieu d’un océan déchaîné, chacun peut expérimenter le double sentiment de la peur et de la fascination. Or le Livre de Job commence par une piété fondée sur la crainte d’Adonaï. Au fond, je suis juste parce que je crains Dieu. Religion bien tranquille et rassurante, celle que dénonce Karl Marx dans sa célèbre formule selon laquelle « la religion est le soupir de la créature opprimée, l’opium du peuple… », un lieu d’où « l’esprit est exclu », écrit-il ensuite. La traversée de l’océan de souffrance du malheureux Job ne le conduit pas sur une autre rive de crainte, mais sur celle de l’étonnement, et même de l’émerveillement face à la Création. Avec quelques formules fortes, vertigineuses et parfois inquiétantes, j’en conviens.
Je suis très sensible à l’argument selon lequel la philosophie naît de l’étonnement, formule socratique et aristotélicienne. Le « é », « Ex » est la sortie de soi, l’ouverture. Ex-ister signifie « sortir de », sortir du néant, de l’uniformité, du sans forme, dirait Aristote. Dans le cadre de la souffrance de Job, l’étonnement et l’existence se traduisent par la reconnaissance réciproque. Celle d’Adonaï qui affirme que seul Job a bien parlé et qui est digne d’un dialogue avec lui ; celle de Job qui s’émerveille devant la Création et affirme son respect envers le Créateur. La Parole fait exister. Je ne suis pas loin de partager l’idée contemporaine selon laquelle la Bible est le Livre des religions de la fin des religions, parce qu’elle libère la parole et le sujet religieux contre les rites magiques, les idolâtries, les superstitions et les mauvais idéaux. En tout cas, telle est ma manière de lire l’histoire de Job qui n’est qu’apparemment religieuse et qui est avant tout existentielle. Une religion centrée sur soi du début du récit bascule vers une religion, puis une philosophie et une poésie ouvertes au monde : je sors de moi-même et je m’Ex-tonne de cet univers admirable et étrange -mot d’Einstein de la fin de sa vie pour exprimer son « sentiment religieux » personnel !
Il serait imprudent d’en rester là. Émerveillement, étonnement OK. Demeurer sur le terrain d’une admiration, d’une contemplation éternelle face aux merveilles de la Création, de la nature, de la vie, et derrière elles, du Créateur, peut faire surgir une nouvelle forme de soumission… même si elle semble plus libérée que celle de la crainte : celle de l’égocentrisme contemplatif, ignorant de l’autre comme sujet. Le travail de la philosophie, de la pensée religieuse, de l’expérience spirituelle (au sens fort du terme) a pu se continuer grâce à de nouvelles occasions d’étonnement à travers la parole du monde, que ce soit celle de la nature, celle de l’histoire, celle de l’esprit… jusqu’à la science moderne.
*
Pour cette raison, j’ajoute aux deux directions proposées par l’hymne à la création, une troisième qui sera un des fils conducteurs de la réflexion qui se continue, un des fils de la méditation sur le mystère trinitaire. La Création, il ne s’agit pas seulement d’une création à simple sens : celle qui va du divin créateur vers le monde surgi du néant, et qui serait un résultat du passé. Elle est une création partagée qui plonge vers l’infini de l’avenir. Le texte de Job est ici insuffisant. L’être humain, comme le reste de la biosphère et peut-être d’autres formes vivantes et conscientes de l’univers, sont les produits de processus qui les ont précédés. Mais chacune de ces formes, vivantes et surtout conscientes, développent leur propre autonomie d’extension, de spéciation, de complexification et de communication. Elles prennent le relais de la création à deux niveaux : le premier est l’achèvement de ce qui semble inaccompli et parfois bien mal fichu. Le second est celui de la créativité de leur être propre, à travers des process qui mènent à des formes nouvelles, voire des mondes nouveaux. Je ne parle pas d’utopie, ici, mais du simple regard sur le réel. Arrêtons nous simplement à l’aventure humaine, sans extrapoler sur d’autres formes vivantes et conscientes.
Jamais, ni la Bible de la Première Alliance, ni l’esprit évangélique ne revendiquent une quelconque valeur de la souffrance en soi. Ce contresens a conduit à d’énormes catastrophes spirituelles dans l’histoire et dans les consciences personnelles. Ils ne suivent pas non plus l’idée de destin ou de fatalité. La Croix du Christ, par exemple, n’est pas une valorisation de la souffrance. Elle est celle de la lutte à mener d’une part contre les maux et d’autre part, pour plus de créativité : la résurrection est une « re-création », écrit Paul. Ainsi médecine, connaissance, sciences, techniques permettent de lutter contre les maux et déformations physiques et psychiques ; tandis que politique, droit, justice offrent les moyens de combattre les maux moraux et sociaux… Mais ce n’est pas tout : non seulement, l’histoire humaine est celle de luttes contre les maux divers, mais encore elle est celle d’émergences de formes nouvelles dans le domaine de la pensée, de la sensibilité, de l’imagination, du jeu : arts, musique, littérature, poésie… regards infiniment subtils sur le monde et sur les frères et les sœurs, jusqu’à l’amitié et l’amour créatif et procréatif. Non seulement, les hommes prolongent l’épopée de la nature, mais en plus ils ont fait surgir de nouvelles figures d’existence. Et ce n’est sans doute pas fini.
À leurs risques et périls… car la créativité est une aventure où est engagée la liberté et le jeu éternel de la parole, de la question-réponse. Au commencement, le monde était informe et vide. Puis vient par la parole l’alternance des nuits et des jours, de la lumière et des ténèbres.
Je lis le formidable récit de création de la fin du livre de Job non comme un appel au silence face aux merveilles, mais plus encore comme une invitation à en débattre, à stimuler la recherche et le combat contre les maux, et surtout à participer à cette création…










































































































 Il est certain que faire de la morale l’alpha et l’oméga de toute réflexion philosophique, sociale, politique ou religieuse est là aussi plutôt triste. Aujourd’hui, il est désolant de s’interdire de rire pour diverses raisons comme celle de ne pas vexer telle ou telle catégorie d’individus ou telle communauté. Pourtant rire est essentiel. Mais il est prudent (belle vertu médiévale) de rire dans des contextes temporels et spatiaux adaptés. Comme handicapé physique, je ris volontiers de moi-même ou avec des amis handicapés proches, mais je me garderai bien de le faire face à une femme ou un homme qui vient de se faire amputer ou atteint d’une maladie invalidante récente ou incurable.
Il est certain que faire de la morale l’alpha et l’oméga de toute réflexion philosophique, sociale, politique ou religieuse est là aussi plutôt triste. Aujourd’hui, il est désolant de s’interdire de rire pour diverses raisons comme celle de ne pas vexer telle ou telle catégorie d’individus ou telle communauté. Pourtant rire est essentiel. Mais il est prudent (belle vertu médiévale) de rire dans des contextes temporels et spatiaux adaptés. Comme handicapé physique, je ris volontiers de moi-même ou avec des amis handicapés proches, mais je me garderai bien de le faire face à une femme ou un homme qui vient de se faire amputer ou atteint d’une maladie invalidante récente ou incurable.