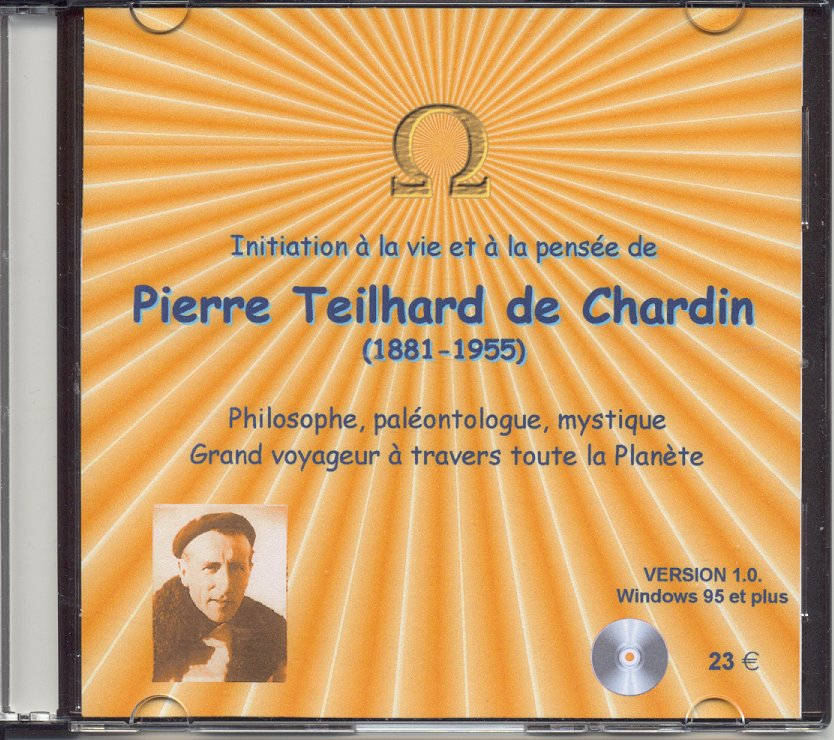Théismes et autres regards face à la souffrance de Job.
Théismes et autres regards face à la souffrance de Job.
Résumé : Job, le juste et innocent qui souffre, s’oppose à toutes les justifications du mal, au nom du divin ou autres raisons : ce qu’on appelle la « théodicée ». Dans cet article, j’essaie de passer en revue toutes les tentatives d’explication et de consolation (peu consolantes, finalement) des amis de Job : culpabilité, épreuve, plus grand bien, etc. Toutes les religions, philosophies, idéologies se heurtent à cette interrogation. Dans un second article, je proposerai les réponses du Livre de Job et les pistes qu’elles ouvrent.
Le Livre de Job.
Combien de fois entendons-nous face à une souffrance intolérable : « Où est Dieu ? Que fait donc Dieu face à ce malheur, face à cette horreur ? ». Pas besoin d’aller jusqu’aux grandes catastrophes naturelles, aux épidémies comme la récente pandémie de Covid-19, ni aux monstruosités historiques pour entendre cette accusation. Chacun d’entre nous a pu l’appréhender, voir l’affirmer soi-même, face à une épreuve qui paraît insurmontable et traumatisante. Non seulement l’accusation posée contre le divin, le destin, la providence semble légitime, mais encore ceux qui la contestent ou justifient religieusement ou rationnellement la souffrance, paraissent naïfs ou aveugles.
La question du mal et de la souffrance face au divin est appelée, en philosophie et en théologie, la « théodicée ». Le concept est ancien, mais il a été rendu populaire par le célèbre « Traité de Théodicée » de Leibniz. Le philosophe allemand semble justifier le mal et la souffrance pour des raisons d’organisation ou de programmation divine, ce qui a provoqué en son temps l’ironie de Voltaire. Or il existe, dans les mythes de sagesse biblique, un personnage qui concentre en lui toutes les procès et toutes les ondes de culpabilité diffusées par la question du mal. Le personnage biblique se nomme Job. Toutes les figures théistes, monothéistes et polythéistes, et athéistes, athées et agnostiques, se heurtent à la question de Job : pourquoi le mal, et surtout le mal innocent ?
Pour les lecteurs qui ne connaissent pas les enjeux de l’interrogation posée par Job, en voici l’essence. J’aborde la situation de Job, le juste souffrant, celui des jeux de culpabilité et de justification du mal qui sont indiqués dans le livre, les protestations de Job, à travers des réinterprétations et des extrapolations -non exhaustives- que j’en extrais. Le mythe de Job est un récit que l’on lit dans la Bible, mais aussi dans d’autres traditions. Le Coran en touche un mot. J’avoue que l’interprétation coranique ne me convainc pas. Les herméneutiques posées par nombre de traditions juives et chrétiennes sont autrement plus persuasives.
*
Le cadre de la souffrance de Job se situe dans l’espace familial. Cependant il est possible de l’étendre au-delà. L’introduction du livre de Job n’est pas très intéressante : il s’agit d’une sorte de conte, où un être surnaturel, Satan, demande à Dieu (Adonaï), de mettre à l’épreuve le prétendu juste qu’est un certain Job, homme riche, aimé et pieux. L’esprit biblique dans le Livre de Job joue sur plusieurs sens du nom divin, à savoir « אֱלֹהִים » ELOHIM, le nom collectif de Dieu, un peu le Dieu du Panthéon, Créateur de l’Univers, que l’on retrouve dans le premier récit de la Genèse ; « יְהוָה », YAHVE, le tétragramme dont le nom mystérieux est révélé à Moïse, et qui représente plutôt celui qui parle au peuple et qui fait alliance avec lui ; et parfois d’autres noms… Pour cacher le tétragramme, la tradition juive préfère dire ADONAÏ. C’est le terme que j’utilise ici, qu’on me le pardonne, sans que soient respectées les subtilités du texte hébreu du Livre de Job. Ceci permet d’éviter des confusions par rapport aux figures divines que j’ai proposées dans les articles précédents.
Suite à la demande du Satan, commence une première série d’épreuves du malheureux Job. Il perd sa fortune, ses troupeaux, ses possessions. Puis ses enfants et sa femme meurent. Malgré tout, Job reste fidèle à Adonaï. Alors arrive une seconde série d’épreuves qui, cette fois, atteignent Job dans son corps. Il tombe malade, côtoie la mort et souffre terriblement. Ce ne sont plus ses avoirs et son pouvoir qui sont atteints, mais son être même, dans son corps. À cet instant, Job fait un « burn out ».
À partir de là, la forme littéraire du texte biblique change. Il ne s’agit plus d’une narration, mais d’un dialogue, d’une dialectique même, voire d’un procès à plusieurs faces : le procès des amis contre Job, les objections et plaintes de Job et le procès de Job contre Adonaï. Quatre amis de Job vont intervenir, trois personnes âgées et un jeune. Ils vont tenter d’expliquer plus ou moins maladroitement pourquoi Job souffre. Job ne se satisfait jamais de leurs tentatives et crie sa révolte. Ne soyons pas injustes envers les « amis de Job ». Ce sont de vrais amis. Ils viennent le consoler. Tous ceux qui ont souffert savent que dans les instants de souffrance, de maladie, vieillissement, humiliation, exclusion sociale, désolation, survient une distinction entre les faux et les vrais amis : les faux amis disparaissent, changent de trottoir quand ils vous croisent, tandis que les vrais se révèlent et restent. La maladie et j’ajoute, la vieillesse, sont des excellentes révélatrices des relations affectives, que ce soit sur le plan familial ou sur le plan amical. L’exclusion sociale également… Le chômage par exemple. Les amis de Job sont donc, malgré leur maladresse, de véritables amis.
L’argument majeur des amis de Job se résume ainsi : « si tu es malade, si tu souffres, c’est que quelque part, tu es coupable ». Ou plus généralement, c’est parce qu’il existe une culpabilité autour de toi que tu ne voies pas. Culpabilité dans la cause de la maladie. Culpabilité dans la situation de perturbation que crée la maladie dans l’entourage, mais -j’extrapole- aussi dans la société. Cet argument se décompose en trois sous arguments : (1) Si tu es malade, c’est de ta faute. (2) La vertu engendre toujours une récompense. (3) Nous sommes tous coupables devant Adonaï. À ces trois arguments sur la culpabilité, s’en ajoute un autre sensé expliquer l’origine de ton mal, celui de l’épreuve (4) : Adonaï t’éprouve, ou plus largement « il faut souffrir pour être fort » (songeons à Nietzsche). L’épreuve est, du reste, l’origine même du Livre de Job, puisqu’il est écrit que Satan met Job et Adonaï lui-même à l’épreuve. On peut, sans que ce soit explicite dans le récit de Job, adjoindre (5) les tentatives de rationalisation de la question du mal à travers les théodicées philosophiques et théologiques : celles-ci risquent de nous entraîner très loin. Je suis contraint de restreindre. Analysons chacun de ces arguments et sous-arguments dans la ligne de Job et de la relecture que j’en propose.
*
(1) Si tu es malade, c’est de ta faute.
Tu es malade de ta faute. Ne rions pas. Certains affirmeront que cet argument ne prend pas aujourd’hui. Personne n’oserait affirmer que quelqu’un est malade ou est en souffrance parce qu’il a fait le mal ! Ben tiens ! Rappelons-nous ce qui s’est passé autour du SIDA : c’est de la faute de ton identité d’homosexuel, ou du fait que tu te drogues, etc. On peut élargir : dans les milieux alternatifs, écologistes, médecines parallèles, etc. combien de fois n’avons-nous pas entendu affirmer que tel ou tel est malade parce qu’il ne mange pas bio, parce qu’il bouffe au MacDo, parce qu’il respire mal, qu’il ne fait pas d’activité physique, parce qu’il a une mauvaise hygiène, parce qu’il boit… On peut élargir jusqu’à l’infini la sphère des culpabilités. Sans doute, y a-t-il quelquefois une part de vérité dans ces médisances et bavardages calomnieux, mais résolvent-elles l’interrogation posée par la souffrance ?
Les discours de culpabilité commencent très tôt : « tu as la grippe, tu as une angine, tu ne t’es pas assez couvert », enseigne-t-on aux enfants. « Tu es fatigué, tu aurais dû manger plus abondamment ce matin ; tu as des poux ? Tu n’as qu’à pas te frotter à des malpropres à l’école ! Etc. », pour ajouter une petite dose de contrainte sociale. La culpabilisation peut inciter à changer de comportement, si elle est proportionnée. La culpabilité n’est pas mauvaise en soi : il y a une bonne et une mauvaise culpabilité. La première est vectrice de la réflexion, de la compassion et de l’action, la seconde est paralysante, voire source de maux pathologiques. Chacun connaît les dégâts d’un excès d’appel à la volonté ou à la responsabilité personnelle. Elle fonctionne jusqu’à certaines limites. Limites que justement conteste Job. Inversement, tout déculpabiliser peut conduire à la déresponsabilisation, et parfois à la victimisation de difficultés minimes qui sont solvables. Ce n’est pas sur ce dernier terrain que Job se bat…
Le poids de la culpabilité malveillante est particulièrement vif à l’égard des maladies psychiques ou mentales. Face aux dépressions, on entend dire : « il ou elle manque de volonté. Elle ou il n’a qu’à se secouer, etc. ». L’âme, c’est-à-dire la volonté et la raison, doivent dominer les nerfs, les sensations et les émotions, et discipliner, voire asservir le corps. Stoïcisme : souffre et meurs sans parler ! Le rapport de contrôle d’une prétendue « âme » responsable des nerfs et du « moral » empoisonne beaucoup d’approches de la maladie psychique. Sont oubliés la réalité autonome du corps, la part de l’inconscient et surtout le lien ontologique entre notre système physiologique et notre vie psychique, mentale, morale et affective. La tradition dualiste et quelque peu schizophrénique, celle qui oppose l’âme, siège de l’entendement et de la volonté, et le corps, siège des passions et des déterminismes biologiques, fait beaucoup de dégâts.
*
À ces culpabilisations directes, s’ajoutent des culpabilités indirectes. Tu souffres par la faute de quelqu’un de ton entourage… Par exemple, celle de l’hérédité. « Il est malade, parce que dans sa famille, ils sont tous comme ça ! Ils sont tous morts de cette maladie ! Ils sont tous tarés ! »… Plus largement, les maux se développent dans des milieux miséreux, au manque d’hygiène et à la moralité corrompue. Combien d’hommes politiques peu scrupuleux ont utilisé cet argument pour des pratiques douteuses : destruction d’habitats, enfermements dans des lieux confinés, exils… et je laisse au lecteur le soin d’imaginer encore pire !
Autre exemple de culpabilisation indirecte : celui de la perturbation dans l’entourage créée par la maladie, par le mal. « Parce que tu es malade ou parce que tu es handicapé, ou je ne sais, tu nous empêches de partir en vacances, en week-end… Tu nous obliges à rester à la maison. Qui va s’occuper des enfants pendant que tu es à l’hôpital ? » J’ai même connu des personnes âgées et souffrantes qui culpabilisaient leur conjoint décédé : « il ou elle me laisse seul(e) ! Il ou elle m’a abandonné ». Ici, le cri est compréhensible. Le deuil efface cet apparent puits sans fond.
*
(2) La vertu est toujours récompensée.
Il s’agit du second argument des amis de Job. En d’autres termes, si vous êtes droit, juste, bon, aimant, vous ne serez jamais malade et vous aurez une vie et une vieillesse heureuse. L’argument précédent est inversé : le malheur est dû à votre irresponsabilité et votre vie dissolue. Le bonheur et l’efficacité de votre action sont liés au bien que vous vous faites à vous-mêmes et aux autres. Je ne contredis pas a priori cette opinion qui peut, à une petite échelle et dans des cas statistiquement analysés, être valide. Elle circule, par exemple dans les milieux de conseils en entreprise, dans les services sociaux et parfois dans des cabinets médicaux. Toutefois soyons respectueux de l’échelle de validité de cette allégation. Elle aussi, a des limites, comme va l’affirmer Job.
La proposition selon laquelle la vertu rend sain et heureux est redoutable, peut-être plus encore que la première, celle du reproche d’une culpabilité derrière le mal. Les personnes impuissantes, faibles par nature ou par culture, qui se trouvent en situation de dette et de culpabilité, qui habitent des milieux sociaux défavorisés, n’ont pas toujours les moyens d’une vie vertueuse. Dans le cas précédent, l’argument portait sur la capacité de la personne qui souffre à user de sa volonté et de sa sphère de responsabilité pour lutter ou accepter le mal qui le détruit. Dans le cas présent, les personnes fragiles, qu’elles soient malades, souffrantes ou non, sont elles-mêmes interdites de bonheur… parce qu’elles n’ont pas la potentialité de faire le bien autour d’elle. Je pense aux handicapés, physiques, affectifs ou mentaux ; ou à ces individus qui n’ont pas pu faire d’études, pour des raisons physiques, psychiques ou socio-économiques, et qui sont confinés à des activités dégradantes, voire au chômage. Double peine : non seulement ils doivent subir leur état, mais en plus ils doivent supporter les vendeurs de bonheur ?
Il est plus difficile à un exclu social et économique, à une personne chétive ou un infirme mental d’aspirer au bonheur, via la vertu. Il y aura toujours des conseilleurs, un peu comme les amis de Job, pour affirmer que tout le monde est égal devant le bonheur, et éventuellement de la dite réussite : il suffit d’un peu de bonne volonté et d’acceptation de sa situation. Bref, soyez vertueux, votre entourage et nos enfants en profiteront, vous ne serez pas malade et votre avenir sera radieux. Je ne partage pas cette opinion. Devant le bonheur, il y en a « qui sont plus égaux que d’autres » !
Job va répondre que la vertu n’engendre pas automatiquement le bonheur.
*
(3) Nous sommes tous coupables devant Dieu.
Troisième argument qui mérite approfondissement. Il s’agit de la culpabilité métaphysique. Job ne la contourne pas quand il crie pourquoi suis-je né ! L’accusation est portée contre Adonaï ou contre la représentation que les individus de l’époque de Job s’en faisaient. La quasi totalité des gens croyaient en Dieu ou en des divinités surnaturelles qu’ils estimaient tout puissants. Dans le fait que quelqu’un souffre, qu’une famille souffre, il y a démonstration que nous ne sommes pas Dieu, que nous sommes mortels. Il existe toute une tradition religieuse, spirituelle diront certains, selon laquelle la vie nous est prêtée. Cette proposition s’oppose à une autre tradition selon laquelle la vie est donnée gratuitement. De plus, cette vie, qui nous est prêtée, a de la valeur. Elle a du prix. Par conséquent, nous avons une dette morale et religieuse, à défaut de comptable, envers celui ou ceux qui nous ont créés. Ce prix de la vie, il faut le payer.
Un célèbre pasteur allemand, pendu par les nazis, a écrit un remarquable livre qui m’a soutenu dans ma jeunesse : « le prix de la grâce ». Contrairement aux affirmations précédentes, il met l’accent sur la gratuité du don de la vie et non sur son prêt. Il garde l’idée selon laquelle la vie a du prix et associe, moralement et politiquement, le don et la valeur de la vie. Par conséquent l’investissement spirituel et éthique est de l’ordre du désir et non celui de la dette à rendre. Le vieux mot « grâce », mot que j’utilise peu en raison de son lourd et racoleur passif religieux, signifie étymologiquement « don gratuit ». Il n’appartient pas au registre du commerce religieux ou politique où nos bonnes actions, nos prières et nos engagements représentent le paiement de la dette que nous avons à l’égard du Créateur ou de la communauté humaine. Le pasteur protestant assassiné, Dietrich Bonhoeffer pour ceux qui n’ont pas deviné, ouvre une porte que le Livre de Job utilisera. Pour l’instant, les amis de Job n’en sont pas encore à cette vision de la gratuité. Mais la question est posée.
Autre aspect : certaines théologies et spiritualités chrétiennes en ont ajouté une couche par une généralisation abstractive. Il en a déjà été question à propos de la figure du Dieu des prophètes. Le mythe du péché originel fonctionne sur l’idée d’une culpabilité métaphysique qui déborde le cas concret de Job : il y avait un paradis ; il a été corrompu par la faute de l’homme (dit Paul), de la femme (disent les rieurs) ; donc tu dois souffrir -ce qui est effectivement exprimé dans les textes bibliques, même si les exégètes savent que telle n’est pas la signification première du mythe et qu’il n’y a pas de péché originel dans la Genèse-.
Là, je ne peux pas ne pas mettre en procès avec force le dogme du « péché originel » de nombre d’interprétations des églises chrétiennes, relayées ensuite par la morale laïque (faut arracher les enfants à leur famille inculte et misérable !) et parfois psychologique (les enfants sont tous des pervers !). Il est à l’origine de désastres dans les consciences et dans les sociétés. Dans ses interprétations courantes, il est interprété ainsi : « nous sommes tous pécheurs devant Dieu », à cause de l’hérédité transmise par un fauteur de trouble de la préhistoire. Or, l’idée de « péché originel » est absente de la Bible : il s’agit d’un mythe que l’histoire biblique envoie promener allègrement par la suite. le Judaïsme ne l’accepte pas. Certaines relectures des lettres de Paul de Tarse l’ont toutefois insinué. Augustin, au quatrième siècle, en est le concepteur principal et il est l’inventeur du mot… La tradition augustinienne, mais pas Augustin lui-même, a utilisé cette idée pour expliquer que le péché originel se transmettait par hérédité, et donc par la sexualité. Certaines spiritualités religieuses qui ont suivi s’en sont servi pour exalter la chasteté des religieuses et religieux, abaisser la valeur de la conjugalité et du mariage et discréditer la procréation. Non sans manipulation des esprits et parfois des corps !
Je suis bien conscient que les théologiens d’aujourd’hui n’interprètent plus le dogme du « péché originel » dans le sens d’une culpabilité que chacun porte en soi par hérédité, et qui ferait de chacun un coupable en puissance, avant de passer en acte. Le péché originel, expliquait un théologien récent, n’est pas un péché, au sens moral et religieux du terme. Il signifie simplement que chaque individu qui naît arrive dans un monde où le mal est présent et actif, et où il doit accepter la finitude de l’existence vivante. L’anti-rousseauisme, si on veut -Que le bon Jean-Jacques Rousseau ne pardonne, car lui-même n’a jamais été rousseauiste !- Malheureusement, la représentation malsaine de la culpabilité universelle induite par un péché des origines est stigmatisée dans les consciences.
Insistons donc sur le fait que le concept de « péché » n’est pas à l’origine moral, mais qu’il est religieux. Il définit la distance de l’homme avec le divin. En raison de son histoire liée à celle du Christianisme, puis de l’Islam, il est difficile de le transposer sur le plan de la métaphysique ou de l’éthique. Mais il est plus proche de l’idée de transcendance que de celui de dérive morale. Laissons de côté ce débat qui entraînerait trop loin.
*
Aujourd’hui, beaucoup de personnes ne croient plus en Dieu. Les raisons historiques, sociologiques et philosophiques de ce déplacement croyant ne sont pas abordées ici. La culpabilité métaphysique se transpose alors dans l’attitude à l’égard du politique ou de la nature : la plupart d’entre nous avons la chance d’exister et d’être généralement en bonne santé. Nous avons donc une dette envers nos parents, notre hérédité, notre structure naturelle, notre milieu social, nos administrations, nos gouvernants… voire envers l’Être Suprême, la Raison Universelle ou je ne sais quelle puissance créatrice ou génératrice. Bien. Ce n’est pas le cas de tous, chacun le sait. Cette dette, ce jeu de mauvaise culpabilité, est souvent inconsciente et traverse nos mentalités personnelles, nos collectivités, nos nations soucieuses de morale sociale et de soin. Si devant un magnifique paysage suite à une escalade en montagne ou assis sur une plage ensoleillée, je pense « quelle chance j’ai », il y aura toujours un petit diable caché pour souffler dans l’ombre : « ça ne va pas durer ! Il faut souffrir pour payer cette chance ! Il faut penser aux pauvres qui n’ont pas pu partir en vacances, à l’infirme qui reste dans son centre de soins, à la belle-mère que j’ai laissée dans son taudis, etc.»
Kafka a relevé cette terrifiante empreinte dans le « Procès » : son héros K est coupable. Il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas de quoi. Comme Job, mais en bonne santé, il crie son innocence. Il sera poursuivi tant qu’il ne reconnaîtra pas sa culpabilité. S’il avoue sa culpabilité et quand il l’avouera, on le laissera tranquille. K est l’anti-Job. Ce sont les accusateurs qui finissent par triompher.
La culpabilité métaphysique se transpose sur les plans sociologiques. « Si tu es malade ou handicapé, tu coûtes cher à la Sécurité Sociale. Si on n’était pas là, tu crèverais ! Heureusement que la solidarité générale est là pour des gens comme toi… avec nos impôts ! », etc. Dans une société de plus en plus individualiste, voici un propos que l’on entend ou que certains n’osent dire, tout en le pensant. En d’autres termes, chacun a une dette existentielle à l’égard des institutions sociales soutenues par les bien-portants. Non seulement mon être naturel reçoit son existence de Dieu, de la nature, de je ne sais, mais encore mon bien-être social tient son existence de la société, de ceux qui travaillent dur et de ceux qui ont la santé. Le malade ou le souffrant paie la dette qu’il doit à la société et à la nature.
Dans la même ligne, il existe également une culpabilité à l’égard du corps médical. J’ai une dette envers les soignants, les chercheurs, les techniciens, les pharmaciens, etc. Heureusement qu’il y a des hôpitaux, des infirmières, des médecins. Je n’ai pas à me révolter, à crier ma souffrance, à moins que cela reste dans les limites du supportable.
Les « culpabilisateurs » de métier ont ainsi un terrain favorable à leur discours. Pensons au récent coronavirus : c’est de la faute des chinois et de leur désinformation, de la mauvaise organisation italienne, de l’abandon de l’Obama Care… ou du libéralisme économique du flux tendu et de la disparition des stocks. Il y a certainement du vrai dans ces affirmations… Gardons toutefois une prudence éthique et politique face à ces condamnations hâtives, sans procès, sans jugement, sans un minimum de raison et de sagesse.
*
(4) Tu es à l’épreuve.
L’idée de l’épreuve est inscrite dans le prologue du Livre de Job. Adonaï et Satan mettent la piété de Job le juste à l’épreuve. La fin du Livre de Job fausse un peu le débat, puisque Job est rétabli dans sa condition initiale. Sans doute, l’auteur aurait-il dû s’arrêter sur le splendide hymne à la Création qui la précède. J’y reviens dans l’article prochain.
Il n’empêche que l’idée d’une mise à l’épreuve n’est pas à contourner. Pour devenir un virtuose, un pianiste doit travailler dur et parfois souffrir. Une ballerine ou une patineuse aussi. Mis à part la négation du mal par les vendeurs de bonheur d’une part, et le discours soumis des fatalistes de tout poil d’autre part, l’épreuve est une idée qui a de la valeur. Malheureusement, dans le Livre de Job, elle est réduite au combat singulier d’un homme, seul, contre le malheur et contre les bavards. La célèbre formule nietzschéenne, « ce qui ne tue pas rend plus fort », a beaucoup de succès actuellement. Lue comme aphorisme moral, la formule est toutefois à manier avec précaution. D’une part, elle exclut les maux qui sont au-delà de nos forces, d’autre part, elle omet la solidarité active que d’autres personnes et des institutions humaines peuvent apporter dans ces situations. Elle n’est pas généralisable, tant au plan individuel qu’au plan social.
Je parle d’expérience : une personne qui n’a pas connu la souffrance doit rester réservée et ne jamais imprudemment expliquer à l’équivalent de Job d’aujourd’hui : « tu es à l’épreuve », ou pire encore : « c’est Adonaï qui te met à l’épreuve ». Peut-être les mystiques, les vrais j’entends, ont-ils la capacité de l’affirmer pour eux-mêmes ! Jamais pour les autres. Prudence et sagesse, s’il vous plaît. J’ai le souvenir de cet archevêque prêchant la morale, le stoïcisme, le sens de l’épreuve et la soumission à un malade, tant qu’il était vivant et responsable de ses ouailles… et qui, le jour où il est gravement tombé malade à son tour, a avoué qu’il aurait mieux fait de se taire.
La mise à l’épreuve et son apparente absurdité sont parfois justifiées au nom d’un plus grand bien divin ou d’un plus grand bien social. J’ai lu cette explication dans une sourate du Coran, je ne sais plus laquelle. Apparaît ici le Dieu bouche-trou ou l’hypothèse ad hoc qui arrange bien les pouvoirs religieux et politiques : « taisez-vous donc, Allah sait ce qu’il fait, Dieu sait ce qu’il fait… Notre gouvernement sait ce qu’il fait ». Pour reprendre ce qui a déjà été médité dans un article précédent, on aimerait bien savoir ce qui s’entend sous le concept de « bien », surtout le bien divin, en plus des concepts théologiques que j’ai médités dans les articles précédents. Un philosophe russe contemporain a parlé de la « tyrannie du bien ». Du bien imposé par d’autres, j’entends, ou de ce qu’on croit être bien. N’est-ce pas encore une manière de dégager en touche, de nier la subjectivité de celui qui est en souffrance et de mousser son propre ego ou son propre pouvoir ?
Les grandes idéologies du Vingtième Siècle qui promettaient le bonheur social et qui voulaient nier le sujet au nom d’un Idéal d’État ou d’une Société Parfaite ne résolvent donc pas non plus le procès engagé par Job. Il est possible d’accepter, dans notre capacité limitée d’action et de réflexion -selon notre pouvoir- de subir des épreuves pour plus de justice, plus d’amour, plus de connaissance, plus de bonheur. Admettons. Seulement, chacun affronte tôt ou tard la souffrance d’une passion -au sens christique du terme-, au sein de laquelle il ne voit ni vérité, ni sens. Les idéologies du Vingtième Siècle ont démontré leurs limites à Auschwitz, dans le Goulag ou dans les marécages du Cambodge.
Par ailleurs, vouloir nier la souffrance par des ascèses religieuses comme on le lit dans certaines religions orientales n’est pas très pertinent non plus, même si ça marche à petite échelle.
Je ne nie pas l’idée de mise à l’épreuve. Je propose simplement qu’elle reste située à l’intérieur de ses limites… c’est-à-dire ici et maintenant, tant que la responsabilité personnelle, ou éventuellement collective, est encore possible dans son efficacité et dans sa signification. Il y a, au-delà de ces limites, des souffrances qui sont « insupportables »… et là, l’idée d’une épreuve, imposée par je ne sais qui de plus vaste que soi, vole en éclats. La vraie question du sens est par conséquent au-delà de ces considérations… Voilà la situation de Job face à ses contradicteurs.
Arrive parfois, derrière ces multiples accusations, justifications, explications, l’injonction clé : « convertis-toi »… et ça ira mieux. Ben voyons !… et de quelle conversion s’agit-il ?
*
(5) La justification rationnelle du mal.
Les paragraphes précédents se sont surtout arrêtés sur l’aspect moral, psychologique et sociologique de la souffrance et du mal, et sur les discours de culpabilité pour les justifier ou pour accuser le souffrant. La pensée philosophique, celle qui se place en recul par rapport aux événements et aux émotions immédiates, s’est parfois risquée à vouloir justifier rationnellement le mal. On connaît le cas un peu exceptionnel et caricatural de Leibniz et de sa Théodicée. Mais on pourrait en ajouter combien d’autres, parmi les anciens, les médiévaux et les modernes. Job n’aborde pas l’angle de la raison philosophique, dans la mesure où il reste dans un contexte religieux et familial.
Je ne développe pas et aspect des choses, puisqu’il a déjà été avancé dans les articles précédents et reste présent tout au long de ces articles. Il est même possible de se demander si l’ensemble de la réflexion philosophique n’est pas structurée autour de cette question. À titre personnel, je maintiens l’idée que l’origine du mal n’est pas raisonnable, n’est pas rationnelle… et elle ne peut être circonscrite dans un concept. J’ajoute qu’il est même injurieux de prétendre résoudre son énigme d’un point de vue strictement intellectuel… et encore moins scientifique. En revanche, s’il n’y a pas de solution à la question du mal, il y a peut-être des réponses : la dualité « solution-réponse » est une des clés de lecture de ma méditation trinitaire. J’y reviendrai abondamment dans des articles futurs.
Parvenus à ce point, le lecteur acceptera volontiers, me semble-t-il, que toutes les images, mythes et représentations divines exposées dans les articles précédents flirtent volontiers avec les palabres sophistes, religieuses ou morales des amis de Job. Je fais remarquer également la parenté de certaines idéologies politiques avec ces représentations religieuses. Question: résisteront-elles au procès intenté par Job contre le divin, contre les diverses explications et justifications ? En effet, que répond Job face à ses amis, parfois consolateurs, parfois accusateurs, unanimement maladroits ?