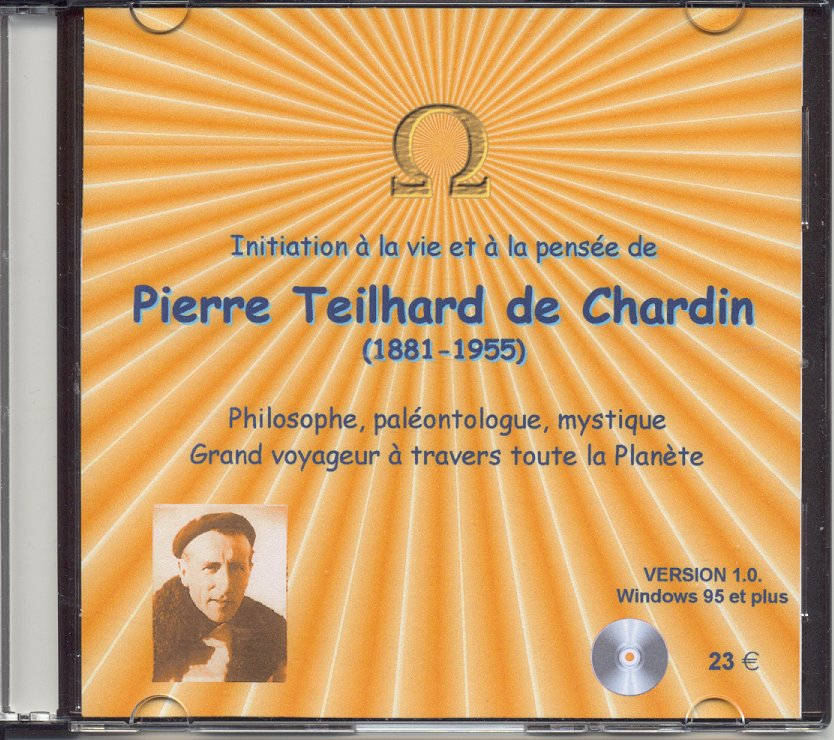Lorsque j’étais étudiant, j’ai eu le bonheur irremplaçable d’un professeur d’éthique exceptionnel. Aujourd’hui encore, son cours reste un arrière-plan de l’ensemble de ma réflexion morale. Il était plutôt traditionnel, pas traditionaliste, et il est devenu aujourd’hui une personnalité reconnue et parfois un peu crainte en Italie. Il m’a fait découvrir ce que sont les normes morales, les valeurs, l’obligation, la structure des vertus, la différence entre éthique et morale (que je ne reprends pas ici) et bien d’autres choses. Nous avons aussi parcouru l’histoire de la morale : dans l’Antiquité et au Moyen-âge, celle-ci est dominée par le concept de « bonheur ». Avec la chevalerie, « l’honneur » est essentiel au point que Dante a mis la traîtrise comme le pire des péchés. Avec la bourgeoisie et surtout avec Kant, c’est la notion de « devoir » qui devient primordiale.
Comme travail de fin d’études, j’avais travaillé sur le Traité de la Béatitude de Thomas d’Aquin, et j’avais fait remarquer à ce professeur que la vision du grand théologien médiéval restait très individualiste et que cela ne me convenait pas. Il m’avait répondu que ma remarque était justifiée et il m’avait mis une excellente note (un 16, si je me rappelle, note très rare de sa part). J’avais en tout cas la meilleure note des étudiants.
Ce qui est très drôle, c’est que j’ai toujours eu une allergie quasi physique à l’égard de toute morale et de tout moralisateur ! Je fuis les donneurs de leçons, les consultants et experts, comme la peste ! Chacun a ses contradictions !
Depuis cette époque, j’ai pu découvrir d’autres morales, d’autres éthiques, comme bien sûr des morales plus révolutionnaires ou plus sociales, et ces dernières décennies, plus écologiques ; l’éthique du travail revendiquée à la fois par le capitalisme, le communisme (mais pas forcément le marxisme), le protestantisme vu par Max Weber ; ou une éthique comme l’éthique de la responsabilité, version Hans Jonas ou Emmanuel Lévinas, qui a ma préférence. Cette éthique s’inscrit dans un contexte de contrat, d’où la responsabilité – c’est-à-dire de question-réponse -, et s’il y a une responsabilité naturelle, comme celle des parents à l’égard des enfants, elle demande à être librement choisie. Cela dit, même la morale de la responsabilité a ses limites. Lesquelles ? Voir ci-dessous.
Je n’ignore pas non plus la violente critique de la morale par Nietzsche, critique à laquelle je souscris en partie, à condition qu’elle soit considérée comme garde-fou et qu’on n’oublie pas que Nietzsche est un poète. J’ai aussi en tête la remarque de Kierkegaard selon laquelle une morale sans humour prive les humains de toute spiritualité. Je rappelle toutefois que Kierkegaard visait surtout la morale bourgeoise. Quant au libertarisme actuel, qui n’est pas une morale à mes yeux, il débouche sur le néant et la tristesse… Mais c’est un autre sujet.
 Il est certain que faire de la morale l’alpha et l’oméga de toute réflexion philosophique, sociale, politique ou religieuse est là aussi plutôt triste. Aujourd’hui, il est désolant de s’interdire de rire pour diverses raisons comme celle de ne pas vexer telle ou telle catégorie d’individus ou telle communauté. Pourtant rire est essentiel. Mais il est prudent (belle vertu médiévale) de rire dans des contextes temporels et spatiaux adaptés. Comme handicapé physique, je ris volontiers de moi-même ou avec des amis handicapés proches, mais je me garderai bien de le faire face à une femme ou un homme qui vient de se faire amputer ou atteint d’une maladie invalidante récente ou incurable.
Il est certain que faire de la morale l’alpha et l’oméga de toute réflexion philosophique, sociale, politique ou religieuse est là aussi plutôt triste. Aujourd’hui, il est désolant de s’interdire de rire pour diverses raisons comme celle de ne pas vexer telle ou telle catégorie d’individus ou telle communauté. Pourtant rire est essentiel. Mais il est prudent (belle vertu médiévale) de rire dans des contextes temporels et spatiaux adaptés. Comme handicapé physique, je ris volontiers de moi-même ou avec des amis handicapés proches, mais je me garderai bien de le faire face à une femme ou un homme qui vient de se faire amputer ou atteint d’une maladie invalidante récente ou incurable.
J’ajoute que ma référence ultime dans le domaine spirituel face à la souffrance et au mal, reste le petit traité de spiritualité de Pierre Teilhard de Chardin, « Le milieu divin ». Cet ouvrage recouvre à mes yeux tout système éthique qui aurait la prétention d’être universel et éternel. Petit traité à lire les yeux ouverts, avec la conscience de ses défauts naturellement, de son référentiel jésuite d’autre part, une fois qu’on a bien ri avec Nietzsche ou avec Francis Blanche par exemple.
*

Martha Argerich
Bien : et qu’en est-il des valeurs dominantes d’aujourd’hui ? Suite aux JO, suite à la lecture de 90% de nos magazines, suite encore à la vision de nos journaux télévisés et de séries diverses, suite à l’écoute comique des experts en entreprise, on peut dire sans détour que la valeur dominante d’aujourd’hui est la réussite face à l’échec. Bravo à celles et ceux qui réussissent, malheur à ceux qui échouent… quand il n’y a pas un être sarcastique qui souffle : « s’il rate, c’est de sa faute ! ». Réussites et échecs sont relatifs à une échelle de valeurs qui place en idéaux des personnages reconnus qui donnent l’impression d’avoir « réussis »: riches, saints, beaux, puissants, intelligents, virtuoses, révolutionnaires, etc. Albert Einstein, Marguerite Yourcenar, Teddy Riner, Martha Argerich sont des personnages admirables, sans aucun doute. L’admiration devant de grands personnages est une attitude d’adolescent : nécessaire à tel moment de la vie, empoisonnante ensuite. Dans tous ces cas de figure, on oublie que le contexte socio-économique, la chance, la génétique parfois, le hasard aussi, tout autant que le travail, sont des paramètres qui expliquent en grande partie ces réussites. Inversement nombre d’échecs sont liés à ces mêmes paramètres, la chance en moins. Le philosophe de l’École de Francfort, Axel Honneth, y ajoute la reconnaissance… ce en quoi je partage son point de vue. Certains travaillent beaucoup, arrivent parfois à des créations inégalées, mais ne seront jamais reconnus. Et puis le travail est-il la valeur ultime de toute vie sociale réussie ?
Si la morale est un moyen de lutter contre le mal, contre les maux, il convient toutefois de rester très réservé à l’égard de ceux qui espèrent circonscrire l’origine des maux. Ça marche parfois. Nombre de malheurs sont aujourd’hui surmontés grâce aux progrès scientifiques, médicaux, sociaux, écologiques, sportifs, ludiques, voire intellectuels. Cependant tous ne le sont pas et certains ne le seront jamais. C’est le mérite du Livre biblique de Job, et de tous ceux qui se situent dans son aval, de le rappeler avec force : toute tentative de donner raison définitive au mal est vouée à l’échec. Même le dogme du péché originel, spécifique au Christianisme, n’y parvient pas. Même Paul de Tarse n’ose aller si loin. Même chose de la réflexion à moitié juste, mais naïve, de Leibniz. A fortiori, une morale fondée sur la réussite et l’échec paraît d’un ridicule affligeant face à Job, face aux tragédies qui sèment l’épopée humaine, face au malheur innocent, face à la vieillesse et à la mort.
Il ne s’agit pas de sombrer dans le travers inverse : celui de la fatalité face au malheur. Il sert souvent d’alibi pour se déresponsabiliser face à des maux ou des situations dans lesquelles on s’est soi-même mis ou sur lesquels on peut agir. La fatalité ou le destin ont aussi servi à des inquisitions religieuses ou à des magiciens pour s’arroger le droit de manipuler des esprits simples ou d’exercer des contraintes maléfiques sur des individus et des sociétés. L’équilibre à trouver passe par le procès de la raison analytique, une bonne dose d’esprit critique et un peu d’humour. Penser à Érasme par exemple, bon contrepoids à Calvin ou à Luther, quand ces deux-là étaient un peu trop fanatiques (pas toujours, heureusement) !
*
Maintenant peut-être voulez-vous savoir comment je dépasse ce couple mensonger réussite-échec ? J’ai plein d’idées qui me viennent à la fois du monde biblique, de la pensée philosophique (Hegel, Whitehead -un de mes penseurs de chevet-, Bergson ou Ricœur par exemple), des sciences ou simplement de l’amitié. En gros : et si on lisait sa vie non comme une série d’échecs et de réussites, mais comme une histoire à raconter. Une histoire où malheurs et humour se mêleraient (j’ai toujours songé que le souterrain entre tragédie et comédie est plus peuplé qu’on ne l’imagine). Oh, les évènements qui arrivent, qui nous arrivent, ne sont pas toujours drôles. Mais inscrits dans une histoire, un « process », écrit Whitehead, ils drainent des contextes, des environnements, des temporalités et surtout des rencontres, qui colorisent et parfument les faits. Et surtout ils élargissent notre espace, nos sens et notre esprit. Oui, je le reconnais : ce n’est pas simple, loin de là. C’est pour cela que j’aime la Bible : non pour ses valeurs (bof !), mais pour son tissu d’histoires, pour l’étendue du temps, pour les amitiés et les combats, pour les nuits et les jours, pour les confiances et les trahisons surmontées, pour les cris et les rires, pour un Adonaï (le Dieu proche du peuple) beaucoup plus silencieux que bavard. Et il y a de quoi rire et de quoi pleurer, rager, aimer… Si, cher lecteur, tu ne le crois pas, je peux très facilement te le montrer. C’est aussi pour cela que j’aime toujours autant Teilhard : c’est parce qu’il fait de la terre, du temps et de la vie de chacune et de chacun, quelque chose de divin. Pas besoin d’être brillant et de réussir pour cela.
PS. Je n’ai pas ou plus d’admiration pour Teilhard ! Cela fait longtemps qu’il est descendu à mes yeux de sa sphère céleste. Je l’aime, simplement, avec son histoire, ses défauts, ses amitiés et ses qualités. Et je garde mon esprit critique…