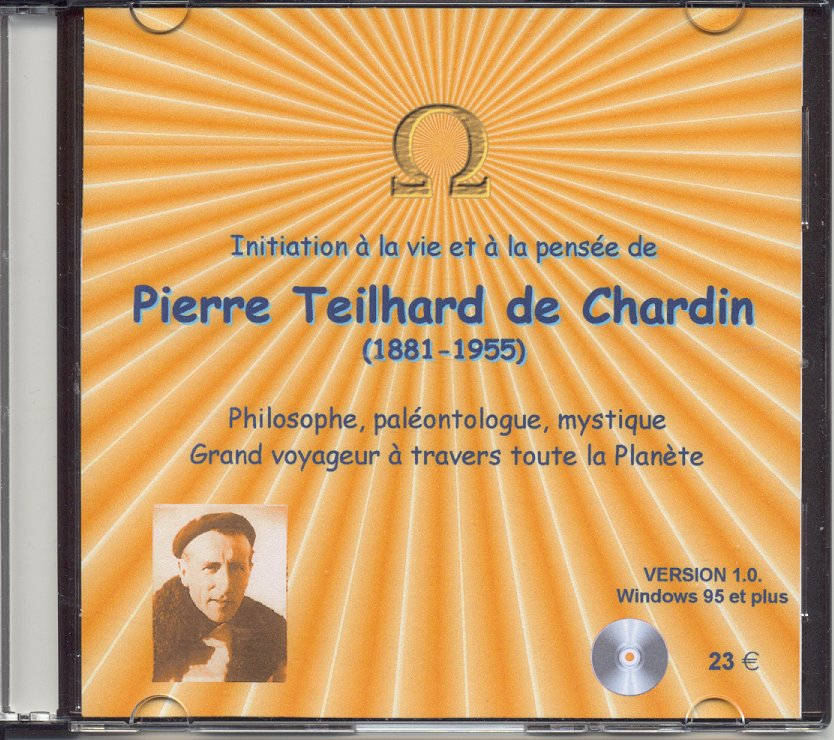Chemin Piémontais (1)
Chemin Piémontais (2)
Chemin Piémontais (3)
Chemin Piémontais (4)
Chemin Piémontais (5)
Chemin Piémontais (6)
Avril 2017, Portet d’Aspet

Village de Montjoie
De loin, la silhouette d’une église fortifiée surgit au-dessus des rares champs labourés de la région et des haies qui les délimitent. Depuis le départ de Mirepoix, les paysages sont plus pastoraux qu’agricoles. Ce n’est pas le cas ici, sur ces collines. Montjoie est un tout petit village qui domine au sud-ouest la ville de Saint-Girons et à l’ouest, celle de Saint-Lizier. L’apparition, dans ce village, d’un vaste monument religieux visible de loin reste un sujet d’étonnement. L’approche par le petit sentier qui y accède révèle que tout le village de Montjoie, hôtel de ville compris, semble surgir d’un autre temps ; un temps où les campagnes étaient habitées, possédaient une économie autonome et ouverte sur le commerce, où la solidarité sociale et religieuse autorisait les habitants à construire de telles églises.
L’argument, souvent entendu, selon lequel ces bâtisses furent financées et érigées par les riches bourgeois et les aristocrates, n’est pas entièrement convaincant. Il a fallu des artisans, des architectes, l’ensemble de la population, pour échafauder, puis agencer l’ensemble en un tout cohérent. On peut imaginer des réticences, mais vraisemblablement peu d’épreuves de force entre bâtisseurs et habitants locaux. Il fut un temps où l’esprit collectif l’emportait sur les revendications individuelles, m’a expliqué dans ce gîte du Portet d’Aspet où j’écris ces lignes, un professeur de littérature médiévale. Et si les commanditaires et sponsors tenaient à ce que leur nom ou leur blason demeurent éternellement gravés sur un mur, dans une chapelle ou un tympan, ils restaient seconds par rapport à ce qui rassemblait la communauté : à savoir la religion chrétienne, avant la Réforme, et la collectivité villageoise. La mentalité moderne, dans nos nations, est très éloignée de cet esprit… Depuis la Renaissance jusqu’à aujourd’hui, les architectes signent leurs œuvres, de Brunelleschi et Bramante jusqu’à Gaudi ou Pi… sans tenir compte de la multitude des petits métiers qui ont permis leurs réalisations. Même lorsqu’on bâtit des stades de foot…
 J’ignore ce qu’il faut préférer : aujourd’hui, des buildings se dressent à l’effigie de leur propriétaire, la Tour Trump en étant la parfaite caricature. Le collectivisme idéologique des soviétiques ou des maoïstes chinois, qui désirait placer la collectivité avant l’individu, n’a pas empêché le culte de personnalités qui s’élevaient au niveau du divin… ce qui signifie qu’il relève du même paradigme. Admettons ce besoin moderne de mettre des individus en avant pour signer des œuvres. Amartya Sen, le philosophe économiste indien, posait la question de savoir à qui appartenait une flûte : à celui qui l’a financée, à celui qui l’a fabriquée, à son propriétaire ou à celui qui en joue. À condition que chacun de ces personnages soient différents. À tous, répondait-il. Si la flûte s’appelle Hanson ou Yamaha, qu’elle appartienne à un mécène fortuné, le virtuose flûtiste en fait profiter tous les mélomanes. Selon les cultures, l’accent sera mis sur l’un ou l’autre des protagonistes, et dans la nôtre, ce seront plutôt le propriétaire et le concepteur de la marque… même si, dans le cas de l’architecture différent de celui d’un instrument de musique, l’artisan qui passe à côté d’une maison qu’il a aidé à bâtir dira à son apprenti, sa fille ou son fils : « voici une de mes maisons ! ». N’oublions pas cependant ce qui n’est pas appropriable, les fameux « communs » : mais ce sujet fait l’objet de débats et de conflits d’intérêts. Il reste qu’il fut un temps où l’esprit collectif recouvrait la revendication individuelle, non sans conflits certainement, mais seule l’étude des archives permet de les actualiser, ce qui n’est pas le cas d’un chef d’œuvre de Michel-Ange, par exemple, qui fait l’objet d’un consensus universel et reconnu, indépendamment de tous ceux qui ont contribué à sa réalisation.
J’ignore ce qu’il faut préférer : aujourd’hui, des buildings se dressent à l’effigie de leur propriétaire, la Tour Trump en étant la parfaite caricature. Le collectivisme idéologique des soviétiques ou des maoïstes chinois, qui désirait placer la collectivité avant l’individu, n’a pas empêché le culte de personnalités qui s’élevaient au niveau du divin… ce qui signifie qu’il relève du même paradigme. Admettons ce besoin moderne de mettre des individus en avant pour signer des œuvres. Amartya Sen, le philosophe économiste indien, posait la question de savoir à qui appartenait une flûte : à celui qui l’a financée, à celui qui l’a fabriquée, à son propriétaire ou à celui qui en joue. À condition que chacun de ces personnages soient différents. À tous, répondait-il. Si la flûte s’appelle Hanson ou Yamaha, qu’elle appartienne à un mécène fortuné, le virtuose flûtiste en fait profiter tous les mélomanes. Selon les cultures, l’accent sera mis sur l’un ou l’autre des protagonistes, et dans la nôtre, ce seront plutôt le propriétaire et le concepteur de la marque… même si, dans le cas de l’architecture différent de celui d’un instrument de musique, l’artisan qui passe à côté d’une maison qu’il a aidé à bâtir dira à son apprenti, sa fille ou son fils : « voici une de mes maisons ! ». N’oublions pas cependant ce qui n’est pas appropriable, les fameux « communs » : mais ce sujet fait l’objet de débats et de conflits d’intérêts. Il reste qu’il fut un temps où l’esprit collectif recouvrait la revendication individuelle, non sans conflits certainement, mais seule l’étude des archives permet de les actualiser, ce qui n’est pas le cas d’un chef d’œuvre de Michel-Ange, par exemple, qui fait l’objet d’un consensus universel et reconnu, indépendamment de tous ceux qui ont contribué à sa réalisation.
Je reste assis un certain temps, sandwich à la main et gourde à proximité, au milieu du petit village de Montjoie. Je lis. L’après-midi avance, mais Saint-Lizier, mon objectif est proche. La responsable de l’office du tourisme m’a prévenu qu’elle fermait à 18 heures. L’arrivée sur le bourg de Saint-Lizier crée une émotion similaire à celle sur la petite cité de Montjoie. De loin, les majestueux édifices médiévaux dominent l’ensemble de la municipalité. Le Palais des Évêques écrase la ville. Les rues anciennes reflètent avec plus de criant ce que j’évoquais précédemment à propos du petit village de Montjoie, à savoir l’unité de l’ensemble porté sans doute par une communauté villageoise. Je n’ai pas pu ne pas m’émerveiller devant ces architectures et leur histoire cachée.
Je me promène dans les rues sur une jambe, avec les béquilles, sans prothèse. Ce n’est pas grave. Un sentiment étrange m’a envahi dans les murs du bourg, celui d’être bien, paisible, d’être seul et en même temps de me penser relié à l’histoire des hommes. Les rares visiteurs ne viennent que parce que c’est écrit dans les guides touristiques ou parce qu’ils aiment les vieilles pierres, les cathos nostalgiques par exemple ou les étrangers. J’ai écrit par ailleurs que j’adorais déambuler au milieu d’immeubles modernes ou d’entreprises de haute technologie, comme à Guangzhou en Chine, à La Défense à Paris ou à l’Aérospatiale où j’ai travaillé dans ma jeunesse. Bon, je suis un peu menteur, car des émotions face aux œuvres humaines anciennes, j’en ai connues par exemple à Istambul près de la Cathédrale Sainte-Sophie ou à Granada, au cœur de l’Alhambra… et en combien d’autres lieux.

Cathédrale de Saint-Lizier
Ici, à Saint-Lizier, je suis surpris de ma propre sérénité et de mon propre détachement à l’égard de toute considération esthétique, mais encore idéologique, confessionnelle ou philosophique. Voici la Cathédrale et son impressionnant cloître. Je goûte le simple bonheur d’être là, en cette localité et au milieu de la Cathédrale, où les murs, la nef, les colonnes, les fresques dévoilent, sans forcer le regard, une forte présence, celle de l’histoire sans doute, certainement plus, peut-être. Ma solitude en paraît plus contrastée. Comment lire la « vie » dans ces espaces où elle s’est figée. Je reste longuement assis près d’une statue de Notre Dame, située dans un contre-jour qui permet difficilement une belle photo. Après plusieurs essais, je me contente de ce que permet l’appareil photo. Le Palais épiscopal est malheureusement fermé et inaccessible. De plus, je suis fatigué après une longue marche, le moignon est en feu et je n’ai pas le courage d’escalader la colline pour y accéder.
L’hébergement se situe dans l’ancien Hôtel-Dieu (hôpital) de Saint-Lizier, adossé à la Cathédrale et au cloître. Le confort est là. Une sympathique institutrice, Jeannette, vient me rejoindre un peu plus tard. Elle vient de Foix. Elle a eu une vie bousculée, s’affirme athée, et elle parcourt le Chemin sans que je parvienne à cerner la raison. Elle non plus, semble-t-il. Une rechercher personnelle, probablement, ou un besoin de respirer en dehors de son travail. Le lendemain, à Châtillon, je la retrouverai dans un gîte qui est l’exact opposé de celui de Saint-Lizier : un ancien pigeonnier pour deux ou trois personnes, toilettes et douches difficiles d’accès. Cette exiguïté va créer entre nous une complicité (chaste, dois-je préciser) et beaucoup de rires. Jeannette termine à Châtillon sa marche de quelques jours. Elle doit rentrer en Ariège pour son travail.
À vrai dire, la journée de marche entre Saint-Lizier et Châtillon est longue. Pour commencer, en raison d’indications floues et trompeuses, je m’égare à plusieurs reprises, je traverse des zones résidentielles au-dessus de Saint-Girons, et j’ajoute au moins deux kilomètres aux dix-huit prévus. Je décide de couper à plusieurs reprises par de petites routes départementales tranquilles. Ce jour-là est aussi le Vendredi Saint, la fête liturgique préférée de la Réforme. Je suis encore tout chaud des entretiens avec le pasteur du Mas d’Azil. Alors je marche, concentré sur les textes de la Passion, jusqu’à les écouter sur le smartphone, avec l’aide du cinquième évangéliste, Jean-Sébastien Bach. L’émotion est immédiate et continue. Mon regard est en cette journée porté vers les trahisons, les reniements, les haines, les lâchetés qui entourent l’homme Jésus, plus que vers la révélation de son identité. L’interrogation de Pilate « qu’est-ce que la vérité ? », suivie de sa fuite en avant, questionne ma sensibilité de philosophe papillon. Il est tellement à la mode aujourd’hui d’entendre dire « il n’y a pas de vérité », ou « chacun sa vérité », que j’ai tendance à songer que nombre de nos intellectuels et de nos contemporains sont plus proches de Pilate que du Christ. Cela dit, le mot « vérité » est complètement piégé par les dogmatismes de tous ordres, religieux notamment, de ces derniers siècles. Or le texte de l’Évangile de Jean ne fait pas dire à Jésus « j’ai la vérité », comme l’affirment les petits cathos bien-pensants, mais « je suis la vérité », dans son corps exposé notamment. Nous naviguons dans d’autres océans. Ce n’est pas la vérité des idées qui est en jeu, comme devait le penser Pilate, formé à la philosophie grecque, mais la réalité corporelle, physique, existentielle, personnelle -et peut-être un peu politique- de ce personnage hors du commun. On quitte le registre du bavardage idéologique et religieux (dogmatique) pour entrer dans celui de la rencontre personnelle…
 … et celui de notre condition humaine, bien en amont des doctrines et des critiques. Aujourd’hui, je lis les Évangiles et la Bible non sous l’angle éthique, politique ou religieux, encore moins sous l’angle moralisateur, mais essentiellement sous celui de la condition humaine. Je parle de la condition humaine en songeant à notre finitude, à l’exercice de notre volonté, de notre intelligence et de nos sensibilités au sein de tous les déterminismes de notre nature et de notre culture : déterminisme ontogénétique, celui de nos apparences physiques, sexuelles et de nos capacités et limites psychiques et émotionnelles ; déterminisme phylogénétique, celui de notre existence historique, géographique et sociologique qui nous a fait apparaître sur tel ou tel rameau particulier du buisson de l’humanité ; déterminisme événementiel qui fait que tel ou tel accident ou rencontre aléatoire bouleverse notre itinéraire. La morale ne m’intéresse pas ou plutôt, elle passe au second plan. Le droit non plus. Elle sont des nécessités du bien-vivre ensemble, mais elles ne résolvent pas l’interrogation posée par le sens de notre existence. La Passion du Christ, je la lis ainsi, comme réponse ouverte au sens de la vie… « pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ». Combien de fois ai-je croisé des personnes révoltés par telle situation politique ou éthique, mais qui en fait cachaient une interrogation véritablement métaphysique ? Et tant pis si, en écrivant de telles lignes, je tourne mon regard ailleurs que vers les fausses évidences de nos mentalités et moralités modernes.
… et celui de notre condition humaine, bien en amont des doctrines et des critiques. Aujourd’hui, je lis les Évangiles et la Bible non sous l’angle éthique, politique ou religieux, encore moins sous l’angle moralisateur, mais essentiellement sous celui de la condition humaine. Je parle de la condition humaine en songeant à notre finitude, à l’exercice de notre volonté, de notre intelligence et de nos sensibilités au sein de tous les déterminismes de notre nature et de notre culture : déterminisme ontogénétique, celui de nos apparences physiques, sexuelles et de nos capacités et limites psychiques et émotionnelles ; déterminisme phylogénétique, celui de notre existence historique, géographique et sociologique qui nous a fait apparaître sur tel ou tel rameau particulier du buisson de l’humanité ; déterminisme événementiel qui fait que tel ou tel accident ou rencontre aléatoire bouleverse notre itinéraire. La morale ne m’intéresse pas ou plutôt, elle passe au second plan. Le droit non plus. Elle sont des nécessités du bien-vivre ensemble, mais elles ne résolvent pas l’interrogation posée par le sens de notre existence. La Passion du Christ, je la lis ainsi, comme réponse ouverte au sens de la vie… « pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ». Combien de fois ai-je croisé des personnes révoltés par telle situation politique ou éthique, mais qui en fait cachaient une interrogation véritablement métaphysique ? Et tant pis si, en écrivant de telles lignes, je tourne mon regard ailleurs que vers les fausses évidences de nos mentalités et moralités modernes.
Tout cela est bien difficile à partager. La méditation et l’écoute musicale de la Passion du Christ m’unifie au-delà des dimensions mentales et physiques, morales et sensationnelles, émotives et raisonnables. Je suis un philosophe papillon beaucoup plus sensible à l’Être qu’au Bien, pour gloser avec prétention sur les anciens Universaux. Et cela me rend irréductible à toute religion, toute éthique, toute idéologie politique. Le soir, avec Jeannette, dans le pigeonnier de Castillon-, je suis incapable de partager cette dernière expérience de la marche qui me rend pèlerin et compagnon. Est-ce nécessaire, du reste ?
*
Le ciel est couvert. J’ai prévu de m’arrêter à une dizaine de kilomètres, compte-tenu de la longue journée du vendredi sous le Soleil. Seulement, les deux hébergeuses signalées sur les guides et conseillées dans d’autres gîtes ne répondent pas au téléphone, ni aux textos. On verra bien. Pour accéder à cet hébergement, le randonneur doit grimper une côte assez raide. Suite à l’absence de réponse et comme la météo est adaptée à la marche, je continue sur la route goudronnée. Il y a peu de véhicules. Tant mieux. J’apprendrai plus tard que les deux hôtesses de cet hébergement sont en retraite.
Où aller, alors ?
Le ciel est toujours sous les nuages. Quelques gouttes de pluie tombent çà et là, sans mouiller. Il faut savoir que la marche au Soleil peut être agréable quand il ne fait pas trop chaud, mais le moignon dans la prothèse n’aime pas que la température s’élève. Il y a transpiration et irritations, et vite fragilités et apparition de fermentations. Bon, je sais, ce n’est pas ragoutant, mais la marche d’un unijambiste, c’est aussi cela. Comme la météo est convenable, une idée germe dans mon cerveau. Et si je montais jusqu’au Col du Portet d’Aspet, à une vingtaine de kilomètres, point le plus élevé du Camino Pyrénéen. L’idée me stimule, et, en début d’après-midi, je téléphone « Chez Jo », café-restaurant qui propose le logis aux pèlerins, quelques centaines de mètres avant le Col, dans le village du Portet d’Aspet. Puisque je brûle une étape, et si le lieu l’autorise, je m’arrêterai deux jours là-haut. Les avis internet sur « Chez Jo » sont très positifs.
 Je marche allègrement sur la route. De vieux villages pittoresques, Orgibet, Augirein, décorent la promenade. C’est une des plus belles journées depuis le départ. Arrivé à Saint-Lary, petit village au pied du Col, je me ravitaille dans la seule petite épicerie ouverte, tenue par une charmante dame dont l’accent trahit qu’elle n’est pas du pays. Sa gentillesse donne à penser qu’elle est là pour les randonneurs tout autant que pour les habitants.
Je marche allègrement sur la route. De vieux villages pittoresques, Orgibet, Augirein, décorent la promenade. C’est une des plus belles journées depuis le départ. Arrivé à Saint-Lary, petit village au pied du Col, je me ravitaille dans la seule petite épicerie ouverte, tenue par une charmante dame dont l’accent trahit qu’elle n’est pas du pays. Sa gentillesse donne à penser qu’elle est là pour les randonneurs tout autant que pour les habitants.
Pour monter au Col, il y a deux accès, soit par lva route, soit par le GR à travers les bois. L’épicière me recommande vivement de passer par le sentier boisé, car la route pourrait s’avérer dangereuse. Et elle a raison, à une nuance près. Le sentier qui quitte Saint-Lary est abrupt. Le cœur bat violemment, malgré les efforts pour conserver une allure de tortue, au point que je pense qu’il va exploser. Mais ce n’est pas une mauvaise idée, car ensuite sur plusieurs kilomètres, le GR reste à flanc de coteau.  Le coefficient de la pente vers le Col du Portet d’Aspet est faible. Il faut franchir un petit col, près d’une ferme. Le propriétaire, en voyant ma prothèse, ne tarit pas d’éloge à mon endroit. Le matin, quinze kilomètres auparavant, il m’a dépassé en voiture et il m’a remarqué. La traversée des forêts de montagne est un enchantement et l’arrivée sur le village du Portet d’Aspet me laisse un vif souvenir, comme si elle avait été bien méritée.
Le coefficient de la pente vers le Col du Portet d’Aspet est faible. Il faut franchir un petit col, près d’une ferme. Le propriétaire, en voyant ma prothèse, ne tarit pas d’éloge à mon endroit. Le matin, quinze kilomètres auparavant, il m’a dépassé en voiture et il m’a remarqué. La traversée des forêts de montagne est un enchantement et l’arrivée sur le village du Portet d’Aspet me laisse un vif souvenir, comme si elle avait été bien méritée.
Article suivant, entre le Col du Portet d’Aspet et Saint-Bertrand de Comminges