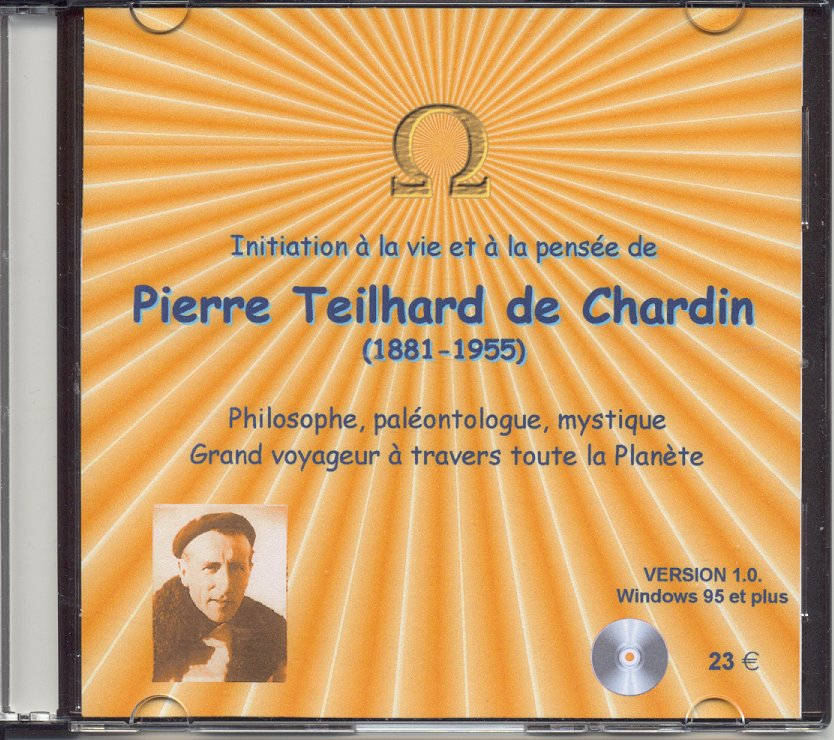CONTENU : papillon de nuit.
- (1) Qu’est-ce qu’un lépidosophe ?
- (2) Chenille dans son cocon.
- (3) Chrysalide dans le vent.
- (4) Butinages.
- (5) Un papillon ne doit pas s’approcher du feu.
- (6) Papillon de nuit.
Job. Étonnante figure biblique. Le passage récent chez nous d’une grande amie de jeunesse a réveillé le personnage enfoui. Elle m’a confié un petit livre très intelligent, lu la nuit et le matin, écrit par une théologienne qui confronte une expérience personnelle de grande souffrance avec le Livre de Job. J’ai perdu l’habitude de lire des ouvrages de théologie et moins encore des possibles ouvrages de spiritualité, si ce mot veut dire quelque chose. La plupart d’entre eux cachent un désir secret d’apologétique, de contrôle des consciences, voire simplement un égocentrisme qui ne veut pas se dire. Je préfère un témoignage vivant, comme celui de cette théologienne qui parle à la première personne, comme un ami parle à un ami.

A priori, la figure de Job n’est pas philosophique, puisqu’elle appartient au corpus biblique. Les mauvaises langues diraient que glisser la Bible dans une réflexion philosophique, ne serait-ce que celle d’un lépidosophe, est une ouverture vers le religieux qui n’a pas sa place. Bon, ce jugement est discutable, puisque la philosophie doit intégrer toutes les expressions de l’histoire humaine, religion comprise, même si elles sont récupérées par ailleurs par des institutions, des rites et des clergés. Mais ajoutons un point pour ceux qui ne connaissent pas la Bible. En dehors de la référence au Dieu d’Israël, Elohim ou El Shaddaï, l’histoire de Job est indépendante des aventures et mésaventures du peuple dit élu et de ce que les traditions juives et chrétiennes nomment l’Histoire Sainte, avec un grand H et un grand S (qualificatif stupide à mes yeux… Soit tout est saint, soit tout est profane, il n’y a pas séparation, du moins sur notre Planète Terrestre). Alors pourquoi est-ce que j’introduis le personnage de Job dans une méditation lépidosophique qui, depuis le début, essaie de s’affranchir de la chrysalide religieuse ? Il y a d’abord une simple raison littéraire. Job est un personnage connu de plusieurs civilisations, en Assyrie et en Babylonie, qui déborde la sphère biblique. J’y reviendrai. La figure de Job est une des personnalités qui m’a le plus accompagné au long de mon histoire, autant que Teilhard, que Whitehead, que Prigogine et Stengers, que Hegel, que Jean-de-la-Croix… Et objectivement, je suis loin d’être le seul à le penser, le Livre de Job est un des plus, si ce n’est le plus, pertinents et percutants écrits pour aborder la question du mal, de l’absurdité de la souffrance de l’innocent, et de la théodicée (concept de Leibniz pour essayer de concilier l’existence d’un Dieu juste et bon face au mal et à la violence).

Oh, Job n’offre pas de réponse intellectuelle, philosophique et même pas religieuse, à cette question du mal. En revanche, à mes yeux, il invite à changer le regard, quelles que soient nos convictions. Certaines traditions chrétiennes affirmeront que la Passion du Christ Jésus répond à la question de Job. Je n’en suis pas si sûr. La Passion du Christ, telle qu’elle a été le plus couramment interprétée, offre plutôt un écho historique et moral au personnage mythologique de Job, et elle ajoute, c’est vrai, une signification à la mort. Manière de dire que la figure de Job est devenue inutile après Jésus. Je ne sais pas, mais je suis persuadé qu’il serait dangereux d’oublier Job dans la contemplation du Christ souffrant. Pourquoi ? Une des caractéristiques de la modernité est d’avoir fait glisser la question de la condition humaine, du registre du salut (religieux) au registre de l’être (existentiel). L’important est moins « Comment serai-je jugé ou comment serai-je sauvé ? », que « pourquoi j’existe, pourquoi cette existence est-elle marquée par la souffrance et la mort ? ». Question mythologique rétrograde, ai-je entendu dans la bouche de théologiens. Ah bon ? Je pense surtout que cette question échappe au pouvoir des clercs et à la puissance des rites. D’un autre côté, je suis mal-à-l’aise quand des philosophes ou des moralistes évacuent cette question sous prétexte qu’elle serait dépassée ou qu’il n’y aurait pas de réponse. La célèbre phrase de Marx « Jusqu’ici, les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde, ce qui importe, c’est de le transformer » est insatisfaisante, et de toutes façons, elle se heurte aujourd’hui à l’irruption de l’imprévisible dont j’ai parlé dans les articles précédents, et à l’entropie qui ronge la Planète. Pas de réponse intellectuelle ou morale ? certainement. Et là, je puis comprendre la position du grand Karl, même si je ne la partage pas, quand il estime que les philosophes ont souvent parlé de choses non expérimentées.
Le Livre de Job fait changer le regard et le mouvement naturel de la pensée, comme cette intrusion d’une force extérieure qui fait changer le mouvement. Dynamisme contre inertie, ai-je écrit dans un article précédent, inertie de la vision du progrès héritière des Lumières et du rêve de la raison toute puissante. Cette intrusion dynamique dans nos bavardages intérieurs et dans nos bonnes raisons change l’arrière-plan des catégories de pensée et des présupposés. En gros, la question première n’est plus celle du bien et du mal, celle du juste et de l’injuste, mais celle de la vie et de la mort. Cette vie… et cette mort… que le papillon philosophe côtoie en permanence, aujourd’hui menace toute l’humanité et est inscrite dans la fragilité même de l’univers au sein des turbulences entropiques.
Cela dit, qu’on n’imagine pas que les questions de la justice, de la liberté, de la fraternité, des combats pour une meilleure existence humaine m’importent peu. Bien au contraire. Elles sont toutes aussi essentielles, mais elles sont secondes. Pas secondaires ou accessoires, mais secondes. Elles doivent être rapportées à la question de la vie et de la mort, à celle de la condition humaine qui ne peut empêcher la souffrance de l’innocent, qui elle, est première au regard du lépidosophe. Donc à la question de l’être et du non être, à celle du sens ou du non sens, à celle de l’absurdité possible de l’existence face à la souffrance. Pas n’importe quelle souffrance, toutefois. On le verra plus loin… Et là, le Livre de Job a quelque-chose à dire, quoiqu’en pensent d’un côté exégètes et théologiens, d’un autre côté les philosophes de la fuite en avant. Je vais donc y revenir. Mais auparavant, le lépidosophe a continué à papillonner et à doucement planer avec de moins en moins d’énergie, entre 2002 et aujourd’hui où il écrit ces lignes.
*

En 2002, je sors de dépression, liée en grande partie à ma désillusion par rapport au monde catho et au manque de reconnaissance universitaire. Peut-être aussi, comme je l’ai exprimé dans l’article précédent, m’étais-je brûlé les ailes. Bon, je sais, ce n’est pas un échec local qui doit justifier une proposition générale par rapport aux cathos et à la religion chrétienne. Un hoquet peut-être au sein de l’immense respiration de l’histoire. Toutefois, l’invasion progressive des intégristes dans toutes les religions et dans toutes les anti-religions (les nouveaux anti-cléricaux primaires), m’a conforté dans la prise nécessaire de distance. Après avoir suivi une passionnante formation informatique qui m’a notamment initié aux réseaux open source et alternatifs, j’ai créé un atelier informatique. C’était l’époque finissante des start up. Trois ans d’activité indépendante peu rentable au moment où toutes les grandes surfaces s’emparaient du marché de la micro-informatique.

Plusieurs deuils tragiques dans la famille et parmi des amis de longue date ont rappelé la fragilité de nos vies. Puis, entrecoupés de temps de chômage, je suis allé enseigner la physique dans un lycée talmudique privé, faire des audits énergétiques dans des entreprises, avant de retomber dans les rets de l’Église Catholique en travaillant un peu plus de trois ans dans un institut de recherche théologique. Institut lentement infiltré par des intégristes… que j’ai quitté une fois de plus avec beaucoup d’amertume et de désenchantement. Aujourd’hui, à l’exception d’une formation donnée justement sur la question du mal, je ne rappelle même plus ce que j’ai bien pu y faire. Beaucoup d’air agité, sans doute. La seule formation citée ci-dessus, sur le mal, la souffrance et la théodicée, à Bourgoin-Jallieu, a commencé avec une trentaine de personnes pour finir avec sept ou huit intéressés. Peut-être était-elle trop gênante, sans doute n’étais-je pas à la hauteur de la situation ? Avec le recul, je reste assez fier de son contenu. Il anime les pages présentes. Trois collaborations avec l’Église Catholique, trois chutes. Au risque de se répéter, le papillon, qui aime revenir sur ses fleurs et qui aime bien Voltaire aussi (Voltaire et voltige, ça sonne bien ensemble), sait qu’il vaut mieux avoir affaire à Dieu qu’à ses saints. Je n’ai pas abandonné l’esprit de recherche. Ces dernières expériences ont dégagé les ailes du papillon des dernières peaux de la chrysalide, même si ces ailes se sont alourdies de fatigue et ont vieilli. J’ai toujours autant d’appétit à la vérité, plus que jamais dégagé la contemplation silencieuse des pesanteurs de la culpabilité, de plus en plus d’émerveillement devant ce monde mystérieux, de plus en plus d’aspiration à la sagesse. Les marches vers Santiago de Compostela fignolent les subtilités de la sculpture de la vie… Oh pardon ! Pas trop d’image statique ! Elles multiplient les variations du thème et développent ses couleurs et ses tempi.

Durant ces années de vol en douce vrille, j’ai écrit plusieurs livres et des articles, offert plusieurs récitals de piano, participé à des activités littéraires et multiplié les amis. J’ai cessé d’être conseiller municipal, ce n’est pas mon truc. La santé s’est améliorée, en raison de l’abandon de tous les médicaments, grâce aux progrès de l’orthopédie et à la médecine. Seul souci latent, les attaques de panique qui se sont apaisées après les années 2006 suite à des séances de sophrologie. Lors d’un grave malaise une nuit de janvier 2006 où j’ai failli mourir, j’ai été appareillé pour dormir avec un masque, ce qui ne fait que multiplier les prothèses. Il reste toutefois un fond de fatigue qui me conduit à, en général, être passif, épuisé et improductif dans l’après-midi. Les papillons aussi doivent faire la sieste. Les épreuves, notamment mon départ mouvementé de l’Institut Théologique de Grenoble, m’ont permis de discriminer les faux des vrais amis. Les faux amis sont ceux qui ne voient en vous qu’un personnage public, celui qu’on salue parce qu’il représente une institution… et qui disparaissent quand vous chutez. Ils ont été nombreux. Les vrais amis sont ceux qui restent fidèles au cœur de l’épreuve et après l’épreuve. À ma grande surprise, il y en a eu plus que prévu et il en est même apparu de nouveaux. Aujourd’hui, je participe discrètement, sans animation, à plusieurs groupes de réflexion et diverses activités culturelles (musique, cinéma…), et cette troisième vie qui débute, celle dite de la retraite, s’annonce sous des auspices prometteurs : marcher, écrire, prier, jouer de la musique et accompagner des musiciens, aider à la vie associative, écouter ceux qui sont dans le feu de l’action, à commencer par mes proches… et se préparer au retrait, à partir un jour définitivement.
*
Mais le lépidosophe ne peut pas finir la réflexion sans revenir sur Job. Sur Job, sur Teilhard, sur ceux qui l’ont inspiré, sur ses propres recherches, sur l’avenir de la Planète, sur la question existentielle du sens de la vie et de la mort. Un bien lourd programme pour un si léger papillon.

S’il est une conviction profonde qui m’habite, si tant est qu’un philosophe papillon puisse être profond, c’est qu’une personne qui n’a pas côtoyé la mort, la peur, le dénuement, la souffrance de près, ne voit que la moitié du réel. Teilhard de Chardin, lui pourtant homme d’action, de voyage, d’ouverture au monde, précise que cette première moitié, l’ensemble de nos activités et de nos risques, ne représente que la moitié la plus petite de la vie… un peu comme aujourd’hui, les cosmologistes découvrent une énergie et une matière noire qui composent plus de 70% du réel. Énergie et matière noire dont on mesure les effets, mais dont on ne sait pas grand chose.C’est une analogie, naturellement ! Qu’on en déduise pas des inférences métaphysiques ! Le papillon butine en superficie, mais comme il est philosophe, il connaît et essaie d’intérioriser sa fragilité. La seconde moitié est donc celle que le jésuite appelle « les passivités », au sens de ce que chacun subit. Teilhard parle de « divinisation des passivités », expression qui m’a toujours fortement impressionnée. Dans l’idée de passivité, il différencie les passivités dites « de croissance », c’est-à-dire les réactions, les rétroactions subies lorsqu’on est dans l’action… par exemple les baffes qu’on se prend quand on veut innover ou réformer, le travail nécessaire pour s’instruire et communiquer ou les douleurs qu’on supporte lorsqu’on s’entraîne à une activité sportive ou qu’on s’exerce sur un piano ou un violon. Mais il y a aussi les passivités « de diminution », celles qui inéluctablement nous mènent à la déchéance, à la mort, via les maladies, les deuils, les impuissances, la vieillesse.
Or, continue Teilhard, ces « diminutions » peuvent être divinisées. Il faut être foutrement gonflé pour affirmer ce genre de propos, mais nous pouvons imaginer le jésuite, compagnon de Jésus donc, contempler pendant des heures la Passion du Christ… La Passion (écho à passivité) du Christ a trop été interprétée du côté des passivités de croissance plus que du côté des passivités de diminution. Jésus était jeune, il n’a pas connu la maladie, la vieillesse. Il est mort pour les péchés des hommes, dit la tradition chrétienne, c’est-à-dire qu’il a été tué par des méchants, par des haineux, par des réactionnaires, dirait-on aujourd’hui, toutes choses morales et politiques que j’accepte, mais qui sont, comme je l’ai écrit, secondes… et qui ont bien aidé les clergés, les idéologues, les moralistes de droite et de gauche, à exercer un pouvoir sur les peuples et les petites gens, pour le meilleur parfois, pour le pire bien plus souvent. « Le cauchemar du bien imposé », écrivait Nicolas Berdiaev. N’oublions pas que Jésus a été condamné par des religieux, et exécuté par les politiques. Mille excuses, les moralistes et les clercs ont aussi aidé à bâtir des institutions et des lois pour prévenir avant de guérir. Ne soyons pas trop négatifs. OK.

Or la question des limites, de la fragilité, des pertes et diminutions est bien plus fondamentale. Une des sécurités, que les hommes ont bâties, a consisté à noyer le problème de la condition humaine individuelle dans le destin collectif… sous toutes sortes de formes : messianiques, utopiques, religieuses, nationales, communistes. Malheureusement, et ce fut un des axes de ma propre recherche, non seulement les personnes, mais aussi les équipes, les communautés, les nations, les cultures, les civilisations, les écosystèmes, les espèces vivantes, les biosphères… et l’Univers entier sont sous le sceau de la fragilité et de la dégradation, sous le risque de la mort. Cette condition déborde les bavardages anthropocentriques, moralisateurs et politiques sur le bien et le mal, sur le juste et l’injuste, sur le progrès et la régression, sur la révolution et la réaction… Ah oui, pardonnez-moi de m’excuser : Et Auschwitz par exemple, et toutes autres abominations de l’histoire humaine ? Ne nous contraignent-elles pas à nous interroger fondamentalement sur les valeurs éthiques, et donc sur le bien et le mal ? Bien d’accord. Mais je ne suis pas sûr que ce soit premier. D’ailleurs, la plupart des penseurs marqués par l’horreur de la Shoah ne se sont-ils pas interrogés sur l’existence même possible d’une telle monstruosité, et pas seulement sur le fait que ce soit bien ou mal (qui relève encore des passivités de croissance) ? Je marche sur des œufs en écrivant ces lignes. Ce que je veux dire, c’est qu’on quitte le registre du bien et du mal pour entrer dans celui de la signification de l’existence, sur la question de l’être (To be or not to be), à l’intérieur desquelles se situe le mystère de nos diminutions et de la mort. Auschwitz a interrogé la notion même d’humanité.
J’ai lu quelque part récemment que le tremblement de terre de Lisbonne, à l’époque des Lumières, avait interrogé d’une manière parallèle les penseurs de l’époque. La célèbre diatribe entre Voltaire et Rousseau, indépendamment de la position confortable de ces deux bourgeois qui ne l’avaient pas vécu de l’intérieur, est significative. Voltaire porte l’interrogation sur la condition humaine et sur l’existence d’une divinité qui pourrait accepter de telles horreurs. Rousseau ramène la question à la responsabilité des hommes qui ont bâti des villes n’importe comment et dont le séisme rappelle la stupidité. Rousseau est plus moraliste que Voltaire. Les deux positions sont aussi vraies, mais j’estime qu’à partir d’un certain seuil, la position de Rousseau est seconde (pas secondaire, je rappelle). L’histoire a donné raison à Rousseau, puisque le ministre chargé de la reconstruction de la ville a réussi à rebâtir Lisbonne, avec les précautions anti-sismiques de l’époque, en quelques mois… Sacré tour de force. Et ce furent aussi les premières techniques en ce sens. Bravo. Mais la question de Voltaire reste sous-jacente, quoiqu’en disent les femmes et les hommes d’action. La position de Rousseau peut apparaître comme une sorte de résistance, de refus de la condition humaine mortelle, de sa finitude… Magnifique projet. Toutefois, si on hypertrophie ce refus, je marche toujours sur les œufs, le refus de la finitude peut se transformer en un culte de la mort (pour ne pas l’affronter existentiellement), comme les nazis l’ont mis en place ou comme les terroristes actuels le pratiquent. Le culte de la mort n’est-il pas un refus de la vie, dans toutes les composantes qu’elle propose, finitude comprise. La fascination envers la mort n’est peut-être que la face cachée du prométhéisme de la philosophie de l’action qui domine notre temps… et qui ne sait pas arrêter la machine folle de notre production et de notre consommation. Le culte de l’immortalité, celui des transhumanistes extrémistes par exemple, est un refus de la condition humaine et même de la simple réalité biologique et cosmique.

On l’aura compris, j’espère, il y a dialectique entre souffrances de croissance et souffrances de diminution, la première renvoyant à nos responsabilités éthiques et politiques, la seconde à l’acceptation de la condition humaine (et cosmique, ajoutai-je), condition qui rappelle que même nos plus belles réussites sont sous la coupe d’un déclin ou d’un effondrement. C’est une des raisons qui m’a fait pencher ma méditation vers la contemplation du monde et les interrogations posés par son être, plus que vers l’action… à laquelle je ne m’oppose pas, comprenons-le bien. Ce serait un comble quand même, que sous prétexte que nous diminuons, il faille ne rien faire pour améliorer notre situation. Je ne suis pas pour la dépression et la neurasthénie, encore moins contre les progrès médicaux, scientifiques et sociaux. Ma santé, ma condition de handicapé et ma petite carrière professionnelle, m’ont incliné vers l’interrogation sur notre fragilité. C’est tout. Et la suite de la méditation présente permettra de mieux cerner ce que je veux expliquer. Teilhard ne reste pas sur le terrain des constats et des oppositions, bien au contraire. Il parle avec une audace incomparable de divinisation de ces passivités éthiques ou existentielles. Et si cette divinisation commençait avec « Voir » ! « Voir » est le prologue de son grand ouvrage d’hymne à l’Évolution, à la Vie, à l’Univers et à la grandeur de l’homme, « Le Phénomène Humain ». « Voir »… dans tous les sens du terme.
Dans son petit concentré de vie spirituelle, « Le Milieu Divin », Teilhard propose, après l’exposé sur la divinisation des activités et celle des passivités, un plongeon dans ce « Milieu divin ». Le Milieu Divin est habité de paradoxes, d’apparentes contradictions, de complexités tissées entre elles. Les mots du jésuite chantent une hymne à la vie, au vivant, qu’ils unifient dans la figure du Christ souffrant, mort et ressuscité.

Tout le monde n’est pas obligé d’aller jusque là. C’est la raison pour laquelle je reviens sur Job. Je vais essayer de montrer que le Livre de Job, loin de promouvoir une culpabilité qui nous obligerait à l’action éthique et politique, fait changer le regard. Voir donc, changer de vision. Pour les lecteurs qui ne connaissent pas le Livre de Job, voici quelques éléments de rappel. Il s’agit d’un des livres de la Bible qui appartient aux courants dits de la Sagesse, reconnu à la fois par les juifs et par les chrétiens. Le Coran parle aussi de Job, mais la présentation du personnage est bien palote, bien en deçà du message biblique. Cela dit, je relis ce livre à partir de ma propre histoire et de mes yeux ouverts sur aujourd’hui, ce qui signifie que les aspects mythologiques, la représentation du monde divin, le dénouement apparemment heureux de l’aventure de Job, m’apparaissent accessoires. Il s’agit d’un conte, et comme les contes de Perrault, de Grimm, d’Andersen, ce qui est caché (énergie et matière noire) est le plus essentiel.
Le conte de Job raconte que Dieu et un des membres de son conseil, Satan, font un pari : celui de la fidélité du juste dans l’épreuve. Je transpose : que vaut un homme, une femme, que vaut l’homme (au sens d’humain en général), face à l’expérience de la souffrance, voire de la diminution ? Je transpose aussi l’expérience de Job d’un point de vue social, par analogie bien sûr, car les lois du groupe ne sont pas réductibles à celle de l’individu, ni à la somme des individus. Que vaut une entreprise, une société, une civilisation, face à l’épreuve ? Job, homme riche et bien portant dans son enclos, possède des terres, des troupeaux, est heureux avec sa femme et ses nombreux fils et filles. Il a bien « réussi » sa vie. Première épreuve : il perd tous ses biens, sa femme et ses enfants meurent. Le récit raconte que Job continue à louer Dieu et à lui être fidèle. Pas très sympa pour sa femme, ses filles et ses fils ! Et le deuil ? Et la révolte face à l’injustice qui lui est faite, lui l’homme intègre ? Mon amie, celle qui m’a fait lire le livre de la théologienne, a perdu ses parents, ses sœurs et surtout son jeune mari, tragiquement ! Ce n’est pas rien !

J’ai côtoyé dans ma famille des anciens combattants qui se rappelaient la perte de leurs camarades, des frères, dans les tranchées : terrible ! Lorsque j’enseignais dans le lycée talmudique, un de mes frères a disparu dans les Pyrénées. L’épreuve familiale a donné lieu à des partages profonds avec les juifs qui dirigeaient le lycée, à propos de la Shoah. Je leur ai évoqué la disparition des corps dans les tranchées de Verdun, ils m’ont répondu en remémorant la même volatilisation dans les camps d’extermination… et donc la signification du deuil. Les restes de mon frère ont été retrouvés plusieurs mois plus tard. Je me souviens de ce qu’est la souffrance, celle de son épouse et de ses enfants, nos neveux et nièces, quand elle dure. La Bible est, semble-t-il, un peu expéditive quand elle écrit en quelques lignes rapides que Job est toujours fidèle à sa foi. Bon, c’est un conte. Passons.
La seconde épreuve est celle de la maladie. Cette fois le corps est touché. Job n’est plus atteint dans ses biens, dans ses amours, dans sa filiation, mais dans son être même. Là, le registre change et les enjeux deviennent beaucoup plus ambigus. Le texte ne dit pas que Job maudit Dieu, mais il défaille, maudit le jour de sa naissance, crie l’absurdité de sa propre existence, aurait voulu ne pas vivre, plaint sa mère, « pourquoi ne suis-je pas mort dans le sein de ma mère ? »… Pourquoi ce Dieu auquel je crois pique-t-il ses fidèles ainsi, pourquoi « donne-t-il la lumière à celui qui souffre, qui espère en vain la mort…» Le chapitre 3 du Livre de Job est bouleversant : il n’y a plus de place pour la justification, pour la raison, pour la volonté, pour las trucs et astuces psy, médicaux, bio, qui guérissent, dirait-on aujourd’hui. J’entends les cris de Job, et que le lecteur le sache, je sais de quoi il parle.

Voici trois amis. Des vrais amis qui ne l’abandonnent pas dans la difficulté. Au moins, Job n’est pas seul. Ils essaient de le consoler et surtout de comprendre ce qui se passe. Mais leurs consolations dérivent vers des explications religieuses bien connues : Dieu est juste, donc si tu souffres, c’est de ta faute, ou de la faute d’un de tes proches ou d’un de tes ancêtres. Ou alors c’est une épreuve… Enfin bref, toutes ces sottises bien « rassurantes ». Rassurantes pour qui ? Pour celui qui les prononce ? Moi-même, je les ai entendues quand j’étais malade, sous des formes pas très différentes. Une épreuve ? Oui, c’est courant, sauf que je ne vivais pas une préparation militaire ou un entraînement sportif. Telle tante me raconte qu’un amputé des deux jambes a traversé la jungle tropicale. Ben voyons ! Il a aussi traversé le Pacifique à la nage, sans doute ? Souffre avec le Christ, me disait une autre parente pieuse. Ouais, mais je ne suis pas le Fils du Père. Les culpabilités, là aussi, on les entend : tu ne te nourrissais pas bien, tu étais négligent envers toi-même, tes parents ou ton école ne te soignaient pas bien non plus, tu geins alors que tu coûtes cher à la Sécurité Sociale (entendu en raison des produits qu’on m’a injectés pendant des mois en 1972 et 1973, lors d’un appareillage très coûteux et également quand j’étais en dépression en 2002) et que des soignants s’occupent de toi (pas toujours très bien, quand j’étais hospitalisé). Etc. J’ai tout entendu. Je ne parle pas ici de ce que mon épouse rencontre dans l’EHPAD, maison de retraite médicalisée, où elle travaille. Retour à la Bible. Un quatrième ami , plus jeune et plus fougueux, vient à son tour parler à Job, et le ramène à un autre niveau : question de foi, fais confiance. Non pas confiance en toi ou confiance envers ceux qui te soignent, mais confiance en ton Créateur.
Que le lecteur me pardonne, mais je pourrais écrire des pages et des pages… Ce que je désire mettre en évidence, c’est que Job crie son innocence et son incompréhension. La souffrance est absurde. Là est la vraie question : toutes les réponses explicatives ou consolatrices deviennent à ce niveau des réponses toxiques. Elles replient les interlocuteurs vers leur propre confort, vers leur petite sécurité. Pire encore, ceux qui affirment, du haut de leur confort spirituel ou dogmatique, que la souffrance est rédemptrice, horreur qu’on entend encore !
Mais où sont les yeux ouverts ? Qui a les yeux ouverts ?
Le conte de Job se termine par ce qu’on appelle dans le jargon une « théophanie ». Une manifestation externe de Dieu, El Shaddaï. On peut la lire comme une illumination de Job, comme ce changement de regard qui saisit celui qui a gardé les yeux ouverts. Dieu apparaît. Il renvoie les amis de Job à leurs cinémas intérieurs, moraux, religieux, etc. et explique que Job est le seul à bien avoir parlé de Lui. Étonnant quand même ! Puis ce Dieu devient un Dieu de l’Univers. Il déploie, dans un des plus beaux textes de la Bible, les merveilles de la Création, son mystère aussi (« étais-tu là, quand j’ai créé l’Univers ? »), un extraordinaire hymne à la vie, aux énergies du monde, à la puissance d’être, à l’existence. Il fait écho, à mes yeux, à ce qu’écrivaient Prigogine et Stengers sur le réenchantement du monde. D’ailleurs, il suffit d’ouvrir une encyclopédie scientifique pour être pris de vertige. Ouvrir, ouvrir les yeux, et se laisser emporté par le flux prodigieux de la vie.

Nombre de théologiens, d’exégètes, de philosophes, expliquent que la théophanie finale du Livre de Job n’est pas une réponse. J’en conviens, elle n’est pas une réponse. Ceux qui me lisent savent que je me méfie des réponses. Pas une réponse à la souffrance de l’innocent, au mal, à l’injustice, à l’absurdité… à la cruauté démesurée des hommes, des gouffres infinis où elle semble parfois nous emmener. Et alors ? Serions-vous satisfaits d’avoir une réponse ? J’ai ma propre vision (« voir ») sur cette question. Je vais tenter de l’expliquer, mais là encore, que le lecteur n’espère pas une réponse… ou si c’est une réponse, elle se situe dans le changement de regard.
*
Teilhard écrit « Voir », quand d’autres invitent à fermer les yeux, voire à se boucher les sens. Voir est une nécessité première. Mais plus on ouvre les yeux, plus on entre dans la nuit… ou plus la lumière est aveuglante. Quand les astronautes quittent l’atmosphère terrestre, la lumière solaire ne se diffracte plus dans l’air et la nuit enveloppe le vaisseau, la navette ou la station spatiale. J’ai appris récemment par Pesquet, notre spationaute national, que les étoiles ne scintillent plus comme des petits vers luisants vivants. L’obscure clarté des étoiles n’éclaire pas, même la nuit, que Corneille me pardonne. En revanche, elles offrent des repères.

J’aime cette image de sortie de la sphère terrestre, de la plongée dans l’infini de l’Univers, de la perception de la fragilité de la Planète (qu’il faut préserver le plus longtemps possible, SVP). Sortir, s’évader… S’étonner, écrivent les philosophes, s’émerveiller, chantent les poètes contemplatifs, exister, crie le vivant. Ce « E » (É-tonner, É-merveiller, Ex-ister) est une sortie. Sortie de soi, comme on sort du sein maternel. Non une fuite, mais une nouvelle position qui permet de changer de regard, d’envelopper notre vision, d’intérioriser nos antécédents. Le plongeur qui sort de l’eau, quitte un milieu et en découvre un autre. « Sortir de » signifie que je ne suis pas premier, que je viens de quelque-chose qui est antérieur à moi-même pour entrer dans un autre qui est plus vaste que moi-même. Exactement ce que dit El Shaddaï, le Dieu de Job : « où étais-tu ? ». En écrivant cela, je nage à contre-courant de tout ce que la modernité proclame depuis quatre siècles : « je pense, donc je suis », je suis mon propre maître, je suis la source de mon existence, mais encore, je suis le maître des choses qui ne sont que matière et sources d’énergie, je me libère de ma nature. Face aux contestations possibles et nécessaires, je réponds en général que la liberté n’est pas d’abord l’indépendance à l’égard de nos déterminismes (elle l’est aussi), mais la connaissance et la reconnaissance de ces déterminismes. Connaissance qui permet d’agir sur eux (telle est la vocation des sciences et de la médecine, par exemple), reconnaissance qui permet de conserver l’altérité et la fécondation possible (par intériorisation). Sortir de soi, non pour rejeter l’être qui détermine, mais pour le contempler, pour s’en étonner, s’en émerveiller… et, parce que l’être se présente comme une vaste dérive dynamique vers plus de vie et de conscience, pour y participer. C’était d’ailleurs l’attitude d’Einstein à la fin de sa vie : ce monde est mystérieux, étrange à ses yeux, il a participé à l’approfondissement de ses secrets. É-trange.
Dans le mouvement de reconnaissance qu’il est préférable d’anticiper pour l’inscrire en soi avant que les forces de diminution ne nous menacent ou nous submergent, il y a celui de la vie… celui que nous sommes des vivants. La vie est donnée. Tant qu’on essaie de la conquérir, qu’on est dans une phase ascendante, on ne s’en aperçoit pas. Donnée par les parents, par la nature, par notre environnement social et culturel… donné au sein de contraintes ontogénétiques (celles de notre être) et phylogénétiques (celle de notre génération), écrirait Teilhard. Des dons parfois douloureux : une famille meurtrie ou inexistante, une apparence physique disgracieuse, un handicap, des limites nerveuses, intellectuelles et même morales, une condition économique ou sociale misérable, une nation dirigée par un dictateur et une police indigne, des administrations kafkaïennes, etc. Soit.

Le don de la vie a du prix, écrivait Dietrich Bonhoeffer, cet étonnant et courageux pasteur protestant pendu par les nazis, ne la gaspillons pas. Dans ces configurations, nous ne sommes pas seuls : le paradoxe positif de la culture occidentale est d’avoir à la fois libéré le sujet et offert les outils rationnels et institutionnels de solidarité. Mais cette conquête ne doit pas faire oublier le don de la vie. À mon tour, j’espère la transmettre à d’autres pour qu’ils existent à leur tour, et se détachent de moi.
Ce qui est vrai des individus l’est aussi des entreprises, des groupes humains, des civilisations même. Hegel le rappelle. Aucune civilisation n’est éternelle. Elles meurent et transmettent, consciencieusement ou à leur insu, la vie à celles qui suivront. C’est une nécessité propre aux vivants : plus ils se diversifient, plus ils se transmettent aux suivants, plus la vie s’enrichit. La génétique le confirme. L’Univers lui-même repose sur cette loi, et la montée de l’entropie n’a jamais empêché les évolutions improbables, les diversifications des êtres célestes, et l’inventivité de la Vie. Avec un grand V. de l’Étre avec un grand E. Du Réel, du Vrai, avec un grand R, avec un grand V. La réalité est plus créative que la fiction. La vie est plus surprenante que les images. Nous en sommes qu’aux débuts de nos découvertes.

Ouvrir les yeux, courir le risque d’exister, sortir de soi et du Soi, s’étonner, recevoir l’existence comme un don ne sont pas des réponses à la question du mal et de la souffrance innocente. Je le sais. Je l’ai écrit. Le problème n’est pas dans la réponse, surtout quand ces réponses sont précipitées d’un point de vue religieux, moral ou athée. Je l’ai écrit : accepter d’entrer dans la nuit. Accepter de n’être informé que par des étoiles, à partir d’une certaine altitude quand la lumière de nos raisons ne suffit plus pour guérir les maux, pour lutter contre l’injustice, pour apporter un peu de confort et des mots pour les angoisses. Les étoiles, peut-être faut-il les chercher plus loin. Mais quelle que soit la profondeur de notre recherche, profondeur que le philosophe papillon ne peut pas sonder à la place des autres, il en apparaîtra toujours de nouvelles pour signifier notre propre existence. Et si ce n’est pas moi, si ce n’est pas nous, ce seront d’autres qui prendront le relais.
… et qui sait ? Peut-être derrière la première sortie de soi, de son enclos, de son atmosphère (et quelque temps de repos dans sa navette), derrière l’étonnement et la conscience du don de la vie, y a-t-il une nouvelle sortie ? Non une fuite, mais une re-création. Mes restes de théologie chrétienne m’ont découvert quelques autres étoiles : je ne les écris pas ici. Chacun son chemin. Je laisse ces questions ouvertes.
Le papillon se retire maintenant avec toutes ces interrogations. Il se sent toujours philosophe, lépidosophe, ami de la Sagesse. Mais il n’est pas la Sagesse ! Attention. L’ami seulement.
————————————————————
- (1) Qu’est-ce qu’un lépidosophe ?
- (2) Chenille dans son cocon.
- (3) Chrysalide dans le vent.
- (4) Butinages.
- (5) Un papillon ne doit pas s’approcher du feu.
- (6) Papillon de nuit.
————————————————————