 L’article est très long.
L’article est très long.
Vous pouvez le télécharger en format pdf
Format A4 ou Format A5
Les quelques premières lignes sont importantes. Si vous désirez aller jusqu’au bout, ne les lisez pas en diagonale, SVP. Merci.
*
L’auberge et le chemin.
« Pourquoi est-ce que je ne suis pas catho ? » ou : « pourquoi est-ce que je ne suis plus catho ? » Ces derniers mois, je me suis posé la question dans les deux formulations. J’ai relu des pages dans les carnets de méditation que je tiens depuis plus de quarante ans, et à ma grande surprise, ces interrogations sont récurrentes. J’oserais même écrire qu’elles sont invariantes : l’exposé ci-joint reprend ces invariants dans les dernières lignes. Soyons patients. C’est la première interrogation qui va faire l’objet de la méditation, même si la seconde apparaît parfois en filigrane.
Durant plus de vingt ans, j’ai travaillé au service de l’Église Catholique. J’en ai fini à la fois désillusionné et dilaté. Toujours, je me suis situé en marge, aux frontières, là où le risque, l’interrogation et les doutes sont permanents, là où les combats intellectuels se déroulent, là où la reconnaissance de ses pairs, confortablement installés dans leur université ou leur institution, est difficile, voire impossible. À ces vingt ans, doivent être ajoutées sept années de formation théologique chrétienne à presque plein temps, comme laïc, à mes frais (je travaillais les week-ends ou les soirées), et six années d’une thèse transdisciplinaire (théologique-philosophique et scientifique), suivie par quatre directeurs de thèse différents et non compétents. La thèse n’a jamais été achevée.
Au cours de ces sept ans, trois années ont été exceptionnelles : deux années à Fribourg, à l’École de la Foi de Jacques Loew, créateur de la Mission Pierre et Paul destinée aux favelas et aux communautés de base ; et en gros une année à travers un temps au contact de jésuites. Sur la perception du reste de ces années d’études théologiques et philosophiques, je reviendrais plus bas.
L’inachèvement de la thèse symbolise au fond mon expérience de vie : autour de moi, certains s’en désolent. Je m’en suis désolé moi-même puisqu’à une époque, les différents directeurs de thèse ont eu des difficultés à suivre mon travail. Ce n’est plus le cas aujourd’hui : elle correspond à mon inadéquation au monde universitaire et institutionnel, et à la quête de sens et de vérité qui ne peut se contenter de se reposer sur des acquis, que ce soient les siens ou ceux d’une institution à laquelle on appartient.
*
Rappelons-le pour le lecteur qui ne ne me connaît pas : je suis amputé de la jambe droite, suite à une erreur médicale (médecins qui s’étaient trompés de médicament) et atteint d’une ALD (Affection de Longue Durée) depuis l’âge de 17 ans. De plus, je traîne quelques autres casseroles, conséquences des pathologies initiales : douleurs du membre fantôme (extrêmement douloureux, je ne les souhaite à personne) ; spasmes et attaques de panique (heureusement apaisées depuis une quinzaine d’années) ; masque respiratoire pour la nuit (suite à des arrêts respiratoires, dont l’un où j’ai failli perdre la vie en 2006), etc. Il n’est pas un matin où je ne m’éveille, étonné d’exister, étonné de vivre encore.  Depuis huit ans, grâce à une prothèse électronique de la jambe, je chemine, seul, sur les Chemins de Compostelle. Je marche durant des semaines, voire des mois entiers. Actuellement : 4200 km en plus de 300 jours. Il m’est aussi arrivé de cheminer, seul ou avec mon épouse ou l’un de mes enfants, sur d’autres chemins : montagnes et rizières de Chine, Bretagne (sentier des douaniers), Bolivie, Chemin des Huguenots (Vercors, Diois, Trièves), Sicile, et autour de notre lieu de vie, Chartreuse, Vercors, montagnes diverses.
Depuis huit ans, grâce à une prothèse électronique de la jambe, je chemine, seul, sur les Chemins de Compostelle. Je marche durant des semaines, voire des mois entiers. Actuellement : 4200 km en plus de 300 jours. Il m’est aussi arrivé de cheminer, seul ou avec mon épouse ou l’un de mes enfants, sur d’autres chemins : montagnes et rizières de Chine, Bretagne (sentier des douaniers), Bolivie, Chemin des Huguenots (Vercors, Diois, Trièves), Sicile, et autour de notre lieu de vie, Chartreuse, Vercors, montagnes diverses.
La chance m’a permis de partager mon existence avec une épouse exceptionnelle, et d’avoir donné naissance à des enfants qui ont l’énergie pour se battre dans un monde qui n’a pas été préparé pour eux. Plus les années permettent ces belles et parfois douloureuses marches, plus m’est devenu capital le constat vivant de l’alternance entre le temps du mouvement, du surgissement de la nouveauté et des surprises, et le temps du repos et de la relecture.
Comment exprimer l’alternance entre mouvement et repos ? Un seul point de vue ne suffit pas pour conceptualiser une intuition, en aucun domaine du reste. Autrefois, j’expliquais aux étudiants qu’avoir plusieurs cultures permet d’inférer un dialogue permanent dans l’esprit. Être convaincu de la solidité de son savoir et de son expérience est une chose. Tel est le lieu du repos. La conviction est comme le toit qui abrite après la marche, comme le lieu nécessaire pour goûter la pause et composer le récit de ses journées. Par exemple la nuit dans une auberge isolée dans un village. Dans le texte suivant, j’utilise aussi volontiers d’autres analogies : l’image de la navigation par exemple, ayant eu la chance dans ma jeunesse de participer à des croisières en voilier autour d’îles bretonnes ; l’image de la plongée sous-marine que j’ai eu le bonheur de pratiquer durant plus de vingt ans. J’imagine aussi une navigation dans l’obscurité de l’Univers infini, avec l’étonnante analogie du vaisseau (spatial). La conviction est comme la tranquillité d’un port ou d’une crique sauvage après une navigation loin des côtes, ou comme le partage avec ses compagnons de palanquée après une plongée ou peut-être, comme dans les récits de science fiction, une étape dans la conquête de l’espace sidéral. La conviction est essentielle, mais elle n’est pas suffisante pour une quête de vérité et de sens. L’expérience non plus, du reste, même celle de la marche.
La conviction et l’expérience ne suffisent donc pas pour se remettre en route, pour repartir à l’aventure : là, il est préférable de cantonner son savoir et ses certitudes dans un coin de l’esprit, s’en servir comme expérience (mais pas plus), avant de se risquer dans l’inconnu ; quitter l’auberge confortable ; s’éloigner des côtes que l’on voit pour naviguer en pleine mer, en pleine incertitude ; descendre dans le noir des abysses ou dans la nuit du Cosmos, par delà les certitudes de surface ; laisser ses convictions se déplacer, voire se décomposer. Se décentrer. Pourquoi ? Voyager sans risque conduit à laisser échapper l’événement imprévisible, la part de hasard essentielle à l’existence du monde. Et si l’on n’y croise pas l’angoisse de la solitude ou la surprise de l’événement inattendu, c’est que l’on est resté enfermé dans son cockpit, à l’abri du vent et des embruns, du noir et des rencontres non recensées, des créations non contenues dans les potentialités. Les convictions et les expériences peuvent servir d’outillage, mais elles s’usent et parfois elles trompent.
De plus, la dualité mouvement-repos est une illusion. Le repos et la stabilité ne sont que des états transitoires possibles dans un monde balayé par des énergies et des flux divers (flux d’informations compris). J’en reparlerai dans les pages de réflexion plus systématique, à la fin de cet écrit. Mais gardons-la pour la clarté de ce qui suit et pour les analogies que j’utilise.
*
Le rétropédalage de l’Église Catholique depuis une trentaine d’années, après les belles ouvertures, promesses et espérances des années 1960 à 1980, en a découragé plus d’un. Je n’arrête pas de rencontrer d’anciens cathos, militants de ces années-là, ou enfants de ces cathos, qui sont devenus soit athées, soit agnostiques, voire combattants anti-religieux : aujourd’hui, moins de 40 % des français se disent catholiques, contre plus de 80 % dans les années 60. L’évolution est profonde et irréversible. Face à ce phénomène d’ampleur historique, on voit surgir ici et là d’étranges nouveaux cathos qui rêvent d’un retour à un catholicisme ancien et fantasmé, peuplé de prêtres en soutane, de structures re-cléricalisées et de rites latins anachroniques. Ce phénomène de retour en arrière ressemble-t-il au repos dans l’auberge après la marche, ou à la nuit dans la crique tranquille ? Non, je ne le pense pas. Il est plutôt un repli, comme un besoin de retourner dans un sein maternel fantasmé ou projeté (qui du reste est très différent de ce qu’on en imagine). Un retour où on n’a rien appris. Peur de continuer le chemin et de prendre des risques. On pourrait en rire s’il n’y avait des pouvoirs en jeu. Toutes les religions ou presque sont aujourd’hui devenues des remparts conservateurs ou des puissances réactionnaires. Il n’est pas un jour où les médias ne nous apprennent quelque méfait d’un groupe ou d’une institution religieuse !
Face à ce phénomène d’ampleur historique, on voit surgir ici et là d’étranges nouveaux cathos qui rêvent d’un retour à un catholicisme ancien et fantasmé, peuplé de prêtres en soutane, de structures re-cléricalisées et de rites latins anachroniques. Ce phénomène de retour en arrière ressemble-t-il au repos dans l’auberge après la marche, ou à la nuit dans la crique tranquille ? Non, je ne le pense pas. Il est plutôt un repli, comme un besoin de retourner dans un sein maternel fantasmé ou projeté (qui du reste est très différent de ce qu’on en imagine). Un retour où on n’a rien appris. Peur de continuer le chemin et de prendre des risques. On pourrait en rire s’il n’y avait des pouvoirs en jeu. Toutes les religions ou presque sont aujourd’hui devenues des remparts conservateurs ou des puissances réactionnaires. Il n’est pas un jour où les médias ne nous apprennent quelque méfait d’un groupe ou d’une institution religieuse !
Cependant, je n’écris pas : « j’ai perdu la foi » ou « je ne suis plus catho », mais plutôt « je ne suis pas catho ». L’ai-je seulement été ? Mon tempérament est celui d’un chercheur et d’un aventurier : culture scientifique dans la planète familiale, puis à travers une dense fréquentation de physiciens, de chimistes et d’ingénieurs, via des études de physique fondamentale et grâce à une activité de chercheur et d’assistant (mes plus belles années professionnelles, en dépit de conditions de travail indignes) ; un chouia en lien avec la philosophie et des groupes de philosophes et de militants politiques, une activité de « lépidosophe » exactement (voir mon site internet), à travers quelques années d’enseignement, d’accompagnement et d’écriture ; relation avec des théologiens catholiques, souvent savants, mais peu disposés à partager leur place. Du reste, je n’ai été que moyennement convaincu de la méthode et des contenus théologiques.
Je suis également pianiste, médiocre certes, mais passionné : la musique est mon langage premier. Le cerveau droit m’interpelle quand le gauche délire. Ma vie de mélomane a consisté à passer du temps à apprendre des pièces nouvelles, à découvrir des territoires inconnus ou difficiles à appréhender a priori. La prière silencieuse aussi, selon une conviction acquise d’expérience, relève plus du cerveau droit et d’un plan de conscience « terrestre », que du cerveau gauche égaré dans les « nuées » des spéculations intellectuelles et morales. La prière est la fidèle compagne de la marche et de la gravitation. Les psaumes bibliques représentent une deuxième nature de ma vie intérieure.
Bref, mon univers de pensée n’est pas celui du militantisme, du prosélytisme ou de l’esprit missionnaire. Il n’est pas non plus celui des conforts des institutions et des centres académiques. Combien de fois me suis-je heurté à des intellectuels plus prompts à défendre leur petit carré ou l’idéologie de leur institution ou de leur parti, qu’à se remettre en route après avoir acquis quelques certitudes sur leur savoir. J’ai adopté l’image de Hegel selon laquelle la chouette de Minerve prend son vol à la tombée de la nuit.  Comme l’oiseau, je vole après, en dehors et au-dessus des combats, parfois légèrement condescendant, souvent étonné, avec l’ambition de voir dans l’obscurité ce que les acteurs du jour, vivants ou morts, n’ont pas vu : et je suis loin de tout voir, naturellement. Puis je continue à voler, bien sûr, sans savoir ce qui sera vu plus tard et plus loin. Ayant été gravement malade et étant handicapé physique, je sais que la part la plus importante de l’existence, celle de la souffrance, de l’absurdité du mal innocent et de notre finitude, est souvent occultée parmi les intellectuels et les universitaires. Sans cesse, le silence, celui de l’exil ou celui de la nuit, celui des espaces qui se dilatent tandis que le regard essaie de s’élargir, celui des nouveaux paysages que j’espère et parfois crains, se rappelle à mon souvenir. Job, le juste innocent qui souffre, est toujours caché derrière mes méditations.
Comme l’oiseau, je vole après, en dehors et au-dessus des combats, parfois légèrement condescendant, souvent étonné, avec l’ambition de voir dans l’obscurité ce que les acteurs du jour, vivants ou morts, n’ont pas vu : et je suis loin de tout voir, naturellement. Puis je continue à voler, bien sûr, sans savoir ce qui sera vu plus tard et plus loin. Ayant été gravement malade et étant handicapé physique, je sais que la part la plus importante de l’existence, celle de la souffrance, de l’absurdité du mal innocent et de notre finitude, est souvent occultée parmi les intellectuels et les universitaires. Sans cesse, le silence, celui de l’exil ou celui de la nuit, celui des espaces qui se dilatent tandis que le regard essaie de s’élargir, celui des nouveaux paysages que j’espère et parfois crains, se rappelle à mon souvenir. Job, le juste innocent qui souffre, est toujours caché derrière mes méditations.
*
Parole de Dieu parce que parole d’homme et de femme.
Les relectures m’ont permis de repérer quelques uns des présupposés qui ont enveloppé les invariants (doutes, combats et certitudes) que je crois avoir perçu dans ma recherche. Je relève trois présupposés, à la fois méthodologiques et épistémologiques. Ils ont tous les trois une origine biblique. Il en est d’autres, mais qui relèvent plus d’une méthodologie philosophique. Je n’en parle pas ici.
Le premier de ces présupposés est ma prudence, parfois méfiante, de tout ce qui a trait à « l’idolâtrie ». Quand je parle d’idolâtrie, je ne songe pas seulement au Veau d’Or dans la Torah biblique ou aux fétichismes des religiosités naturelles et païennes. Je pense à toutes les attitudes qui hypertrophient ou absolutisent une idée, un point de vue, une position intellectuelle, au point de cacher la réalité concrète qui s’y réfère, ou l’infini actif qui y agit en cachette. Je suis réservé à l’égard de la notion, très à la mode, de « sacré », surtout quand elle est une pure production humaine : et Dieu sait combien les religions, mais aussi la modernité, crée spontanément du « sacré ». Idéologie rime presque avec idole. Certains contesteront avec raison le rapprochement étymologique. L’idolâtre se mire dans le miroir de son idole, l’idéologue se complaît dans le reflet de ce qu’il croit vrai. L’adorateur du sacré renonce à son humanité pour se fondre dans un objet ou un espace qui n’ont ni yeux, ni oreilles, ni mains.
Les orientaux orthodoxes ont travaillé la différence entre idole et icône. L’icône est une image qui invite à voir au-delà de ce qu’elle représente. D’ailleurs, elle nous regarde plus que nous ne la regardons, disent-ils. Elle signifie aussi l’horizon concret, tangible, que l’échange de regard (entre l’icône et le priant) permet de dépasser. L’idole, elle, empêche de voir plus loin et pétrifie le regard. Il en est de même de l’idéologie : elle aveugle par sa fausse lumière. Tel le Soleil qui cache l’Univers des étoiles et des galaxies que l’on ne peut contempler que la nuit… et qui demande aussi l’aide de prothèses pour être élargi au-delà des sens (la technologie, les lunettes astronomiques) et du savoir des autres. Nombre de catholiques fonctionnent comme des idolâtres ou des idéologues. Ils ne sont pas les seuls : je les rencontre dans d’autres espaces religieux, dans les milieux d’activisme politique ou écologique et peut-être aussi dans le monde de la technocratie et dans celui de l’art.
Il n’est pas un centimètre carré de terre ou de l’univers qui ne soit différent d’un autre. Quand l’idéologie ou la dualité sacré-profane prend le dessus et élimine l’infinie richesse du réel, la terre semble se dissoudre et perdre sa couleur, sa saveur et sa musique. N’imaginons pas que le bleu du ciel signifie que le ciel est bleu.
Un corollaire qui complète cette prudence à l’égard de l’idolâtrie est ma méfiance encore plus grande à l’égard de toute magie. C’est-à-dire de toute manipulation des personnes au nom du sacré, du pouvoir, voire même du savoir. Je ne développe pas, toute la suite de la réflexion présente en apporte quelques aspects.
*
Le second des présupposés de ma réflexion est également d’origine biblique. Mon histoire personnelle m’a permis de rencontrer la « bibliothèque » biblique, espace de vie, dès l’âge de 18 ans. Elle a été renforcée par les deux années d’études bibliques à Fribourg, au contact des recherches exégétiques et œcuméniques (les seuls lieux où je vois un avenir intellectuel possible à l’Église Catholique, et au Christianisme en général). Cet acquis s’est renforcé ensuite par certaines traditions juives qui m’ont passionné plus tard.
S’il est un seul qualificatif que j’attribue à la Bible, c’est celui de « vie ». La Bible est une vie. Le mot « vie » est à prendre dans tous les sens du terme. Celle de la biologie, comme celle de la biosphère qui recouvre nos pierres et habite nos eaux. Celle qui maintient l’activité et l’unité du corps face à la décomposition mortelle. Celle qui sait se nourrir, mais qui sait aussi discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais pour l’organisme. Celle qui fertilise, qui permet les fécondations, les engendrements, les êtres nouveaux. Celle qui redonne un sens concret, créatif et grave aux fumées des idées, et qui réveille ou féconde les rationalités closes, scientifiques ou non, ou les produits stérilisés d’artistes qui ont perdu leur imagination. Celle qui nous débarrasse des affectivités étouffantes et des manipulations au nom de l’amour ou de la tendresse. Celle qui met en route quand on est fatigué, qui remet debout quand on est couché, qui redonne de la joie quand on est déprimé. Celle qui commence avec la naissance et qui se termine avec la mort, tout en se transmettant à d’autres dans l’aventure de l’existence. Celle qui qualifie le Dieu de la Bible : « Je suis un Dieu vivant, pas un Dieu de morts, pas un concept ou une idole qui ne parle pas », même si celui-ci fait trop souvent silence, voire disparaît dès qu’on veut le saisir et l’enfermer dans une image, une idéologie ou une doctrine, dans le sacré ou le tabou. D’ailleurs la vie est insaisissable : les biologistes qui, au siècle dernier, ont voulu la trouver en disséquant des cadavres (donc morts), ont fait fausse route.
*
Troisième présupposé : ma réserve à l’égard du substantialisme et mon refus de l’essentialisme. Bon, ce n’est pas très biblique, me diront certains. Si, si ! Il n’y a pas de substance matérielle, spirituelle, spatio-temporelle dans la Bible. Ni de nature divine ou humaine. Tout cela est de la spéculation postérieure : parfois nécessaire (dans le cas des débats trinitaires, par exemple, qui ont permis de faire émerger des concepts aussi fondamentaux que ceux de « personne » ou « d’existence »), souvent stérile (je ne donne pas d’exemples, ils pullulent). Dans les épopées bibliques, il y a des hommes et des femmes, des personnes qui développent des relations, qui vivent des expériences, qui chutent et se relèvent… Il y a des histoires, des temporalités, des paroles qui se heurtent et se comprennent, des rencontres qui se fécondent, des chemins qui s’ouvrent, parfois sur des abîmes et des déserts, souvent dans des plaines et des vallées verdoyantes ; il y a de la pensée, mais jamais figée, toujours relue, réinterprétée, voire critiquée ; il y a de la guerre, de la violence et des viols aussi, sans fuite ou hypocrites, et de la paix et des pardons qui se cherchent sans toujours se trouver… Mais il n’y a pas de grandes idées généreuses et fixées dans le ciel des substances éternelles. Pas de « liberté-égalité-fraternité » manifestées dans des sculptures dessinées sur des frontons (je préfère libération, fraternisation et justice). À titre personnel, ces beaux concepts sont des outils pour une fin qui est encore à rencontrer : ils n’ont pas à être sacralisés indûment pour nos petits conforts personnels ou pour manipuler des peuples et des individus.
Derrière le substantialisme, je vise aussi les dualismes qui empoisonnent nos perceptions modernes du monde et que l’on ne retrouve pas uniquement dans les discours religieux : esprit-matière, corps-âme, nature-culture, ciel-terre, public-privé, en-deça et au-delà, etc. J’y reviens souvent. La vie réelle est d’une part entre chaque pôle de ces dualités abstraites, d’autre part, au-delà de ces dualités.
*
De même, en est-il de l’essentialisme. C’est quoi ce gros mot ? La langue française est ainsi faite que l’on qualifie aisément des réalités, des noms ou des concepts, qualités ou attributs, « prédicats » pour être un peu snob, qui expriment en fait des relations ou des actions. Ainsi on appellera une personne « voleuse », alors qu’elle a volé, ou « pianiste » quelqu’un qui joue du piano. Et ne parlons pas des noms d’oiseaux que s’envoient des femmes et des hommes dans les réseaux sociaux pour « disqualifier » l’un ou l’autre : lui, c’est un « fasciste », elle c’est une « communiste », alors qu’en réalité, lui agit selon des codes qui peuvent rappeler le fascisme ou le nazisme des années 30, ou elle a un discours lié à des ouvrages ou des événements qui relèvent du communisme.
D’ailleurs, plus généralement, comme l’a fort bien démontré le philosophe anglais Alfred North Whitehead, presque la totalité de nos qualificatifs et de nos attributs désignent en fait des interactions. Il donne l’exemple de la notion de couleur qui ne désigne pas la teinte d’un objet, mais un échange d’information entre cet objet et un observateur, via l’onde lumineuse : le même objet qui paraît vert dans telle configuration deviendra rouge dans telle autre. J’en ai souvent fait l’expérience en ramenant des algues en surface après une plongée. Le philosophe anglais n’a aucune difficulté à étendre cette observation à l’ensemble des phénomènes perçus et souvent essentialisés, compte-tenu de l’évolution des sciences du Vingtième Siècle (notamment la physique quantique, la relativité et les théories de l’information). Le réflexe essentialiste, il le nomme « le sophisme du concret mal placé ». Son interprétation, du reste, est très différente de la vieille opposition cartésienne entre les qualités premières et les qualités secondes… Les grands qualificatifs, il les nomme « objets éternels », ils désignent des potentialités et non des réalités, et ils deviennent réels à travers des interactions ou des relations, des « process ». Attention, la pensée de Whitehead, de ses disciples ou du contexte général de sa philosophie n’est pas une opinion ou une théorie parmi d’autres, mais une figure et un moment de l’aventure du sens et du vrai, qui rendent caduques les vieilleries platoniciennes, aristotéliciennes ou cartésiennes.
Mais chacun me pardonnera de préférer ne pas développer, pour ne pas embrouiller le lecteur. Que celui-ci m’excuse, mais la démonstration de Whitehead est beaucoup plus subtile. Ici, j’induis cette réserve à l’égard de l’essentialisme, dans l’exemple de personnes que l’on qualifie de voleurs, d’assassins, de menteurs, alors qu’en réalité il serait plus correct de dire : elles ont volé, elles ont assassiné, elles ont menti… ou inversement que l’on qualifie de médecins, de prêtres ou de pianistes, alors qu’en fait, elles pratiquent la médecine, un sacerdoce ou jouent du piano. Une personne ne se réduit pas à sa fonction ou à l’attribut qu’on lui donne socialement, et réciproquement, une fonction ne définit pas une personne. Mais ce qui paraît pertinent à l’échelle humaine l’est également à presque tout l’ensemble des réalités du monde qui nous entoure. Une réalité existe parce qu’elle est en interaction avec une autre ou avec un environnement, et non par elle-même : grande illusion de la pensée classique, voire antique. La conscience est une interface, pas une qualité. L’esprit également.
De même, on ne se définit pas à partir de soi-même ou par rapport à soi-même : c’est absurde. La conscience de soi nécessite le choc avec la réalité et avec l’altérité. Elle commence dès le plus jeune âge. La seule essence que je veux bien accepter de moi-même est d’être Nicolas : et encore, ce prénom m’a été donné par mes parents. Ce que je suis aujourd’hui est lié à ma nature et son conditionnement initial, à mon histoire, à mes interactions, aux événements voulus ou aléatoires qui me sont arrivés. Or cela est plus biblique et théologique que l’on ne le pense. Déjà la langue hébraïque ne fonctionne pas ou très peu avec des qualificatifs, alors qu’inversement les pronoms personnels et les verbes d’action ont une importance considérable. Le Dieu de la Bible n’est pas une divinité pleine d’attributs essentialistes, mais une force active qui intervient çà et là, puis disparaît : on ne le voit que de dos, écrit le Livre des Rois, quand Il est passé.
Et qu’en est-il d’un point de vue chrétien, si nous acceptons le mystère trinitaire selon la belle tradition de Basile de Césarée  : les personnes divines n’existent qu’à partir de leurs relations aux autres. Elles n’existent pas par elles-mêmes. Le monothéisme pur est à mes yeux la pire des idolâtries et la plus dangereuse. Le concept de Dieu, lui-même, est ambigu, s’il désigne une entité éternelle, universelle, essentielle au sens de la philosophie essentialiste (les notions d’espace, de temps et de matière ont du reste explosé le siècle dernier). De fait, l’univers biblique est peuplé de dialogues, de combats, de rencontres, d’alliances, de contrats… Les éventuels attributs divins se justifient dans un cadre rituel ou dans celui de la prière, c’est-à-dire d’un point de vue interactif. Si un esprit s’avise d’y croiser des conceptualisations essentialistes (comme le font abusivement les Credos de nos églises et plus encore les catéchismes transmis aux enfants), il risque d’être bien vite écrasé par les événements et par l’histoire. J’ajoute que ce dernier point m’a rendu sensible à la tradition juive, à sa capacité d’interprétation, ses targums et ses midrashs. Tout bouge, tout peut être sujet de relecture et d’herméneutique. Malheureusement, je n’ai pas trouvé d’équivalent dans la tradition chrétienne. Ou alors par défaut : on s’excuse presque d’avoir des visions différentes dans le Christianisme, et plus encore dans le Catholicisme ! Ah, ce maudit besoin d’être d’accord pour éviter l’aventure et le risque !
: les personnes divines n’existent qu’à partir de leurs relations aux autres. Elles n’existent pas par elles-mêmes. Le monothéisme pur est à mes yeux la pire des idolâtries et la plus dangereuse. Le concept de Dieu, lui-même, est ambigu, s’il désigne une entité éternelle, universelle, essentielle au sens de la philosophie essentialiste (les notions d’espace, de temps et de matière ont du reste explosé le siècle dernier). De fait, l’univers biblique est peuplé de dialogues, de combats, de rencontres, d’alliances, de contrats… Les éventuels attributs divins se justifient dans un cadre rituel ou dans celui de la prière, c’est-à-dire d’un point de vue interactif. Si un esprit s’avise d’y croiser des conceptualisations essentialistes (comme le font abusivement les Credos de nos églises et plus encore les catéchismes transmis aux enfants), il risque d’être bien vite écrasé par les événements et par l’histoire. J’ajoute que ce dernier point m’a rendu sensible à la tradition juive, à sa capacité d’interprétation, ses targums et ses midrashs. Tout bouge, tout peut être sujet de relecture et d’herméneutique. Malheureusement, je n’ai pas trouvé d’équivalent dans la tradition chrétienne. Ou alors par défaut : on s’excuse presque d’avoir des visions différentes dans le Christianisme, et plus encore dans le Catholicisme ! Ah, ce maudit besoin d’être d’accord pour éviter l’aventure et le risque !
Cela dit, je veux bien convenir que dans la conversation quotidienne, on ne peut se passer de bavardage essentialiste : bref de qualifier des objets, des situations, des êtres vivants, des personnes… ou de donner des attributs éternels et universels à ces mêmes entités. Moi le premier. C’est plus facile, et nos langues s’y prêtent. Mais il faudra savoir que derrière nos mots, le réel est bien différent. Il est préférable de penser que toute la réalité est interactive, non seulement entre le monde et notre conscience, mais encore au cœur du monde lui-même. La réalité de Dieu comprise. Sous cet angle, on s’apercevra avec le recul que les seuls entités essentielles, ce sont les personnes, et que la notion de nature n’est qu’une manière pratique de désigner le lieu des interfaces potentielles ou actuelles. Ceci fait exploser nos petites égos individualistes et nos réductionnismes conceptuels ou linguistiques. Je développe ces points dans d’autres articles du blog.
Bref trois points dirigent la petite méthodologique présente : la prudence face à l’idolâtrie et les idéologies ; la vie plus forte que les idées ; la connaissance de soi à travers le choc du réel, des interactions et interfaces et celui de l’altérité (entre consciences et sujets). Trois présupposés de ma méditation et source de la découverte des invariants, ces interrogations qui n’ont pas trouvé de solution. Je préfère les navigateurs et les aventuriers aux clercs et aux universitaires.
*
Réponse sans solution.
Est-il raisonnable de se lancer dans une méditation du style « pourquoi est-ce que je ne suis pas catho », un peu en contrepoint d’un livre comme celui de Jean-Claude Guillebaud « pourquoi je suis redevenu chrétien ». Maintenant affirmons-le plus nettement : je n’écris pas « je ne suis plus catho », mais « je ne suis pas catho ».
La question, surtout si elle se termine par une réponse hâtive, peut paraître comme un manque de courage ou plus exactement une fuite, face à la peu brillante situation de l’Église Catholique ces dernières décennies, et plus encore dans le cadre de notre France républicaine et laïque. Les rats fuient-ils le navire qui sombre ? Oui, peut-être. J’y reviendrai. Paradoxalement, on sent un frémissement d’attente vers le Catholicisme de la part de certains penseurs, ces derniers mois, même parmi les plus opposants. Catholicisme, pas Christianisme, précisons-le. Encore moins « Judéo-Christianisme ». La confusion est fréquente chez les intellectuels français. Certains médias continuent à mettre sur le compte du « Judéo-Christianisme » l’ensemble des maux du monde contemporain. L’accusation de « Judéo-Christianisme » est le carrefour de tout le bêtisier intellectuel actuel. La sympathie nouvelle de ces penseurs vers le « catholicisme » semble plutôt se fonder sur la nostalgie d’une culture et d’un monde qui n’existe plus : nostalgie de la messe en latin, nostalgie de l’Église Catholique pré-conciliaire, ignorance de l’exégèse moderne et de la synergie œcuménique (même si celle-ci semble bien silencieuse aujourd’hui), défense obsolète d’un patrimoine religieux, sentimentalisme appelons-le « culturel » au sens où l’Église Catholique aurait représenté une polarité de la France, la vraie France, entendent-ils : celle du bras de fer entre républicains et catholiques (confondus avec un monarchisme ou une tendance réactionnaire). Cela m’amuse un peu, je l’avoue. Je me souviens d’un article de la Revue Études se moquant de certain philosophe médiatique, athée et ardent anti-religieux, lequel critiquait le catholicisme, un catholicisme qu’il décrivait dans un langage d’avant le Concile Vatican II, et qui dernièrement s’est fait le défenseur des positions les plus intégristes des cathos. Le fait que l’Église Catholique se soit ouverte quelque temps aux autres églises, aux autres religions et aux femmes et hommes de bonne volonté dans les années 70, semblait déplaire à ce philosophe athée bien connu, tout autant qu’aux intégristes et traditionalistes qui se font beaucoup entendre ces derniers temps. Et pas que dans les religions chrétiennes !
Oui, tout cela est vrai, mais je vais quand même risquer de répondre à une telle question, au risque de passer pour un rat. Réponse, dis-je, pas solution ! La différence est très fondamentale à mes yeux. La réponse est de l’ordre de la parole, de l’échange entre sujets et des retours en nouvelles questions. La solution, elle, résout un problème… au risque de le dissoudre, du reste. Il y a des problèmes qui trouvent des solutions : en mathématiques, en ingénierie, dans les sciences formelles et dans quelques situations concrètes de nos vies. Mais sorties de ces domaines délimités, les solutions sont insuffisantes… Dès qu’il s’agit de la vie et des questions sociales, religieuses ou existentielles, il est préférable de passer au niveau de la « réponse ». Réponse et « responsabilité » : responsabilité signifie capacité de répondre. Le texte qui suit se situe par conséquent dans l’ordre de la question et de ses potentialités de réponses, et non dans celui des recherches de « solutions », sauf cas particuliers.
La question « pourquoi je ne suis pas catho », est liée à mon histoire personnelle depuis plus de 40 ans, et aux événements récents. Elle est aussi liée à la structure historique et théologique de l’Église Catholique. « Pas catholique » ? L’Église Catholique est une grosse machine à culpabiliser : il est normal de souffrir pour elle, entend-on, de même que le Christ Jésus a souffert pour nous. Sous certain angle, ce discours se justifie et explique le témoignage offert par nombre de saints et de penseurs qui, persécutés par l’Église Catholique, sont malgré tout restés fidèles : Jeanne d’Arc, Ignace de Loyola, Galilée, Albert Lagrange fondateur de l’École Biblique de Jérusalem, Pierre Teilhard de Chardin bien sûr, les prêtres ouvriers des années 1950, ou récemment Hans Küng. Il existe en effet une conception organique et mystique de l’Église (avec un grand É) qui recouvre nos petites amertumes et déceptions personnelles. Je ne sais pas quoi en penser.
Le souci n’est pas dans le fait que des personnages exceptionnels aient souffert pour leur cause, se soient identifiés au Christ souffrant et persécuté, mais dans le fait qu’on en fasse une règle obligatoire de vie chrétienne : il faut souffrir, voire mourir, pour sauver ceux qu’on aime ou promouvoir les belles idées à laquelle nous croyons. Que l’Église Catholique propose un idéal de vie est acceptable, qu’elle transforme un appel libre en obligation morale, spirituelle et souffrante, est plus discutable. Certes, il y a la Passion, mais la spécificité chrétienne est plutôt dans la Résurrection et l’action de l’Esprit Saint.
Cette idée de la souffrance obligée a contaminé un grande partie de notre modernité : il faut souffrir et travailler pour l’entreprise, pour le parti, pour la cause. Comme si le mal et la souffrance étaient des fatalités imposées par des divinités manipulatrices, voire par un Dieu qui exige l’épreuve ! Elle a ses raisons, même sous l’angle de la « vie » que je défends. Mais cette idée se heurte aussi à d’autres convictions et visions. Certaines plus optimistes : pourquoi ne pas croire à la capacité humaine de vaincre nombre de souffrances, et qui estime que le combat contre le mal est plus fort que la soumission à la fatalité ; d’autres plus existentielles qui sont ébranlées par la condition humaine et qui n’ont de réponse ni dans l’action, ni dans la raison : peut-on justifier le mal, la souffrance, et plus encore la souffrance de l’innocent ? À titre personnel, je suis très souvent prudent à l’égard des tentatives de donner raison au mal, raison religieuse comprise. Bref, je risque, malgré tout, d’aller jusqu’au bout de la question initiale, avec la précaution, peu glorieuse je sais, du « pas catholique » plutôt que du « plus catholique ».
 Beaucoup seront étonnés de me voir poser une telle interrogation. En effet, comment écrire « je ne suis pas catho », après sept années d’études théologiques, sans compter les six années supplémentaires du doctorat inachevé, après plus de vingt ans au service de cette Église, après les 4200 kilomètres marchés sur différents chemins de Compostelle, après divers écrits, articles, etc. Pour éclairer le lecteur, je partage cet écrit en trois parties : les raisons personnelles, les raisons conjoncturelles et les raisons structurelles, notamment théologiques et philosophiques, de mon interrogation. Chacune de ces raisons a ses incertitudes, parfois même ses mensonges ou ses oublis, j’en conviens… La marche au sein de l’inconnu et l’imprévisible est ainsi faite.
Beaucoup seront étonnés de me voir poser une telle interrogation. En effet, comment écrire « je ne suis pas catho », après sept années d’études théologiques, sans compter les six années supplémentaires du doctorat inachevé, après plus de vingt ans au service de cette Église, après les 4200 kilomètres marchés sur différents chemins de Compostelle, après divers écrits, articles, etc. Pour éclairer le lecteur, je partage cet écrit en trois parties : les raisons personnelles, les raisons conjoncturelles et les raisons structurelles, notamment théologiques et philosophiques, de mon interrogation. Chacune de ces raisons a ses incertitudes, parfois même ses mensonges ou ses oublis, j’en conviens… La marche au sein de l’inconnu et l’imprévisible est ainsi faite.
*
Entre enfer, désillusions et émerveillements
Des raisons personnelles, j’en parlerai peu. Trop peut-être au goût de certains ? Gardons à l’esprit que le souvenir est un mauvais historien.
J’ai le souvenir d’avoir toujours prié. À la différence de nombre de prêcheurs et d’apôtres, je ne suis pas un converti. En revanche, mon histoire est constellée de petites et grandes lumières, de luttes, d’échecs et de victoires, de doutes et de déplacements intérieurs, d’espérances et de désillusions.
Quand j’avais entre 9 et 11 ans, interne dans une institution catholique de Caen, au cours des confessions obligatoires, j’ai subi les fantasmes sexuels d’un prêtre qui se frottait contre moi, m’écrasait de sa sueur et de son odeur fétide (qui me reste encore dans la tête). Jamais il n’est allé jusqu’à me tripoter, comme cela est arrivé à d’autres, mais le martelage de ses obsessions a imprimé des marques qui ont empoisonné une grande partie de ma vie future, sexuelle et affective notamment, sociale aussi. Plus généralement, flottait dans cette institution un brouillard de culpabilisation malsaine. N’oublions pas que les confessions étaient obligatoires. Un jour, j’ai fugué hors de cette institution et on m’a retrouvé plus tard, marchant sous la pluie et frigorifié, quelque part sur une route de Normandie. J’avais 11 ans. Un des effets de cette abomination devenue ensuite une phobie a été une perte de parole (malgré une logorrhée que me reprochaient mes proches) et un besoin viscéral de silence. Inversement, à l’âge de 12 ans, un peu plus tard donc, j’ai un jour été saisi d’une immense paix que j’oserai écrire « métaphysique » où tout a pris sens autour de moi, avec une clarté que je n’ai retrouvée que progressivement.
Plus tard, à partir de l’âge de 16 ans, maladie, convalescence et rééducation, où j’ai côtoyé la mort (mort de proches aussi), deuil de mon propre corps, souffrances à la fois physiques et affectives (à quelques exceptions près, mon entourage a exprimé peu d’empathie à mon égard), ont cassé mon existence naturelle et sociale, celle que tous les jeunes de mon âge vivent sans trop de vicissitudes. Ceci durant des années. Or un matin, il m’est arrivé comme l’éclair une singulière illumination. Tel le Soleil qui jaillit en quelques secondes de derrière la montagne, j’ai été inondé d’une lumière incomparable où le mystère de l’existence et de l’histoire du monde (ma mienne comprise) a pris sens à mes yeux (bien plus que l’expérience de l’âge de 12 ans). Une véritable vision, je ne crains pas le mot. Cela a commencé lors de fiançailles d’une de mes cousines, à Pâques 1978, en Dordogne, puis s’est continué plusieurs jours. Une des nuits suivantes, j’ai écrit des dizaines de pages enflammées pour tenter de retraduire cette incroyable expérience. J’ai gardé ce secret et ne l’ai révélé qu’à deux personnes depuis 44 ans… jusqu’à maintenant où je le confie au lecteur sagace ou étonné.
Quelques mois plus tard, j’ai brûlé ces écrits de la nuit. Pourquoi ? J’étais, à l’époque, lecteur de Jean-de-la-Croix, de Grégoire de Nysse (« La Vie de Moïse ») et de Pierre Teilhard de Chardin. Leur lecture me rendait très très prudent à l’égard de tout ce qui peut paraître un peu trop « surnaturel ». J’ai plus tard compris, grâce à la spiritualité ignatienne, cette réaction un peu brutale à l’égard de l’illumination qui m’était arrivée. En effet, l’histoire, le récit personnel a plus de valeur que les expériences dites « spirituelles » : ceci, du reste, est très biblique. Regarder le ciel ? Pas sûr que cela apporte plus de réponse que son bleu ou ses nuages. Je ne renie rien pour autant, puisque la suite de mon épopée s’est souvent inspiré de ce qui s’est passé ces jours-là.
Une autre explication s’impose : lorsque j’étais malade, un psychiatre m’a un jour dit que ma maladie engendrait des phénomènes mystiques, comme si les sensations dites spirituelles avaient pour cause des traumatismes psychosomatiques. le propos du psychiatre m’a immédiatement mis en garde, dans la ligne des intuitions de Jean-de-la-Croix que j’avais intériorisées. J’ai encaissé la remarque du psychiatre comme un avertissement et un nœud au fond de la gorge. Quelques années plus tard, en évoquant les mots du psychiatre, un ami jésuite m’a expliqué que c’était une chance d’avoir une foi qui avait traversé les diverses faces de cette épreuve : que ce soit du côté de la maladie, du handicap, des perturbations psycho-somatiques, ou que ce soit du côté des illuminations et des ressentis affectifs de l’expérience religieuse. En fait, les deux ont raison : d’une part, je suis devenu extrêmement réservé à l’égard du mot « mystique ». Ces dernières années, c’est même le mot « spiritualité » que je suspecte, et qu’il faut soumettre au crible de la raison : raison philosophique, scientifique et psychologique, raison théologale. D’autre part, j’ai compris que vérité, sens, et saisie de l’existence sont des choses trop sérieuses pour être confiées à des affects, des impressions ou des sentiments.  Là, la pensée de Pierre Teilhard de Chardin a été celle d’un grand sauveur et d’un maître. Quant à la Bible, œuvre divine parce que profondément humaine, elle est devenue ma compagne.
Là, la pensée de Pierre Teilhard de Chardin a été celle d’un grand sauveur et d’un maître. Quant à la Bible, œuvre divine parce que profondément humaine, elle est devenue ma compagne.
J’ai évoqué les deux extraordinaires années de Fribourg, à l’École de la Foi de Jacques Loew. Cette école se situait dans la ligne des nouvelles communautés de base qui se développaient alors en Amérique Latine, en Afrique et en Extrême Orient. J’y ai rencontré la Planète entière, des personnes qui venaient de tous les continents, Chine et Inde comprises, toutes et tous désireuses de dépasser leur univers. C’était aussi le temps des espérances au sein de l’Église Catholique, celles des théologies de la libération, de l’arrivée des églises du Tiers-Monde comme on l’appelait à l’époque. C’était aussi le temps de l’œcuménisme, des rencontres entre églises, religions et même pensées non religieuses. Un temps de joie et de promesses. Nous faisions l’expérience rapeuse de la vie communautaire, avec ses exigences et ses contraintes, mais aussi celle de la rencontre irréductible de sujets, de personnes. On dit souvent que chaque personne est unique. Mais je complète en pensant que les relations interpersonnelles aussi sont uniques. L’École de Fribourg m’a également enraciné dans l’approfondissement biblique et une solide prière d’inspiration monastique, loin de tout fondamentalisme et de toute moralisation.
Malheureusement, j’ai assisté aussi à la décomposition de cette belle école, quand le cléricalisme s’en est petit à petit emparé, quand les évêques et le clergé local s’en sont mêlés. Ce temps me semble loin loin loin aujourd’hui… J’ai constaté, dès Fribourg, avec des larmes, le retour quasi victorieux de mouvements réactionnaires et faussement spirituels, comme les intégristes d’Écône, les Frères de Saint-Jean, les Légionnaires du Christ, l’Opus Dei, ou bien des communautés charismatiques. Puis, voulant continuer des études théologiques, j’ai rencontré la médiocrité de nombre de milieux paroissiaux, de beaucoup de séminaristes (j’ai enseigné dans un grand séminaire) et d’un clergé purement masculin et trouble. Pas tout le monde, naturellement. J’ai aussi noté l’exclusion des femmes et leur manipulation par le clergé, alors que celles-ci étaient en première ligne, à la fois dans l’organisation et dans la formation. J’ai milité quelque peu dans la ligne d’un féminisme catholique, avec l’impression d’être un petit poisson qui se heurte à une falaise, en compagnie d’autre poissons qui n’étaient pas de mon espèce. 

Toute cette aventure m’a conduit à préférer la proximité des grandes traditions religieuses (les plus solides, j’entends), comme les jésuites, les dominicains, les carmes, les moines et moniales bénédictins, cisterciens… et la tradition orientale. Une de mes filles m’a un jour dit que quinze siècles de vie monastique avaient quand même plus de poids que celui de nombre de petites communautés nouvelles, prétentieuses et prosélytes (je ne parle pas des communautés de base dans d’autres parties de la Planète). Plus récemment, les marches sur les Caminos de Compostela m’ont démontré que la solidité du sol permet d’avancer plus sûrement que la fluidité des nuages, dans le cas où on voudrait s’y accrocher en s’imaginant qu’ils vont nous entraîner.
Mon compagnonnage avec l’Église Catholique a ensuite été l’occasion de grosses désillusions : exploitation professionnelle à la Catho de Lille où j’étais moins payé que mes collègues sous prétexte que j’étais handicapé physique, malade, et que je touchais une allocation. J’y exerçais une activité interdisciplinaire, à la fois comme assistant de physique dans le Supérieur (écoles d’ingénieurs et faculté des sciences) et animateur de groupes de recherche à cheval entre sciences formelles, sciences humaines et sciences religieuses. « Nicolas, c’est un saint ! » avait osé dire le directeur de l’institut à un collègue, en faisant allusion à cette injustice. Je l’ignorais. Une syndicaliste de la CFDT, elle-même handicapée, a révélé l’abus. J’ai été meurtri et j’ai beaucoup perdu de ma confiance. Je suis alors allé travailler pendant plusieurs années dans la formation professionnelle dans des entreprises, avec des conditions de travail assez déficientes là aussi.
Plus tard, je me suis retrouvé professeur de philosophie à la Catho de Lyon, suite à une démission. C’était l’époque où j’avais repris une thèse. Malheureusement, j’ai été remplacé par un prêtre, en raison de la fantaisie de l’Archevêque qui voulait caser ce prêtre dont il ne savait que faire. J’étais alors marié et papa de quatre enfants (curieusement, ce prêtre est aujourd’hui au cœur du cyclone pédophile) ; cette déconvenue a été suivie de contrats bancals, de l’impossibilité d’un vrai travail de recherche et s’est achevée sur une grosse dépression et une nouvelle hospitalisation – dont les effets professionnels ont été désastreux par la suite, et dont ma famille et mes enfants se sont difficilement remis –. Deuxième pause à l’égard du monde catho : je suis parti faire de l’informatique, ai créé ma société. Puis j’ai arrêté faute de réussite et en raison de deuils familiaux. J’ai continué en offrant un peu d’enseignement scientifique dans le secondaire.
Troisième chute : depuis des années, je collaborais à des activités écologiques, d’un point de vue politique et associatif. Ceci m’a conduit à être embauché dans un Centre de Théologie à Grenoble qui m’avait engagé pour reprendre avec sérieux une philosophie de la nature, vue sous l’angle à la fois scientifique, théologique et philosophique. Malheureusement au bout de plusieurs années, j’ai subi le matraquage et le harcèlement moral de la part d’un directeur intégriste, et arrêté pour souffrance au travail, suivi d’un licenciement déguisé (suite à une pression et des menaces). J’y ai découvert ce que je soupçonnais auparavant sans y avoir été mêlé : l’Église Catholique est habitée par des factions souterraines et des réseaux brumeux, pour ne pas dire marécageux et troubles, qui exercent le vrai pouvoir. J’ai vu comment des formations qui avaient été appréciées par les participants ont été salis ensuite par des clercs et des personnages que je ne connaissais même pas. J’ai reçu des menaces, des avertissements infondés (à mes yeux naïfs).
Plus généralement, j’ai expérimenté le mépris de la gente intellectuelle catholique et du clergé à mon égard et à l’égard d’acteurs cathos et laïcs (les femmes notamment). Pas étonnant : je n’étais pas du sérail, « je n’étais pas né quelque part ! ». J’ai été traité de Tartuffe, d’individu superficiel, de papillon. On m’a dit que je jouais avec la victimisation… J’ai le souvenir d’une remarque d’un évêque me disant, la bouche en cœur, qu’il ne faisait pas confiance aux théologiens laïcs, qu’il préférait ses prêtres, ou d’une lettre méprisante et humiliante d’un Cardinal romain de la Curie, écrite à ma mère, à mon sujet (Cardinal également mêlé à des sombres histoires de sexualité bizarre au Vatican, ces dernières années). Elles s’ajoutent à nombre d’autres attitudes condescendantes, souvent tranquilles et hypocrites de la part de personnes protégées par leur institution. Il n’est pas bon d’être seul et d’être un éternel voyageur. Arrêtons ici : ce n’est finalement pas très important. Je ne suis pas le premier à qui arrivent de telles mésaventures et elles ne sont pas spécifiques au monde catho.
 Que le lecteur ne se méprenne pas. Même s’il y a de la colère rentrée dans ces lignes, aujourd’hui, je suis plus paisible. Effets de la marche de Compostelle, sans doute, du déplacement du regard sur l’existence, aussi, effet de l’amour inconditionnel de mon épouse certainement. Mais paix ne signifie pas oubli.
Que le lecteur ne se méprenne pas. Même s’il y a de la colère rentrée dans ces lignes, aujourd’hui, je suis plus paisible. Effets de la marche de Compostelle, sans doute, du déplacement du regard sur l’existence, aussi, effet de l’amour inconditionnel de mon épouse certainement. Mais paix ne signifie pas oubli.
À la décharge de ces désagréments, je dois avouer que je suis d’un tempérament quelque peu lâche et peureux. Il s’est conjugué avec la maladie, le handicap et les désordres affectifs et mondains qui s’en sont suivi : il a certainement déçu nombre de mes collègues et responsables. Je ne sais pas bien parler, encore moins me défendre face aux calomnies et aux médisances. J’aime le silence et la solitude. J’aime l’aventure. Je suis réservé, voire déstabilisé, face aux beaux parleurs et aux brillants orateurs. Le handicap engendre des infirmités sociales et affectives et pousse à l’isolement, s’il ne trouve pas de reconnaissance. Il m’a été longtemps impossible de parler de ce dont j’ai souffert. De vive voix, j’entends. De moins en moins aujourd’hui, heureusement. Avec l’écrit, la musique et à travers la prière, j’ai beaucoup limé l’empreinte de ces années douloureuses. Le soutien d’amis et de proches a permis de circonscrire ces blessures. Mais de même qu’on n’a jamais vu une jambe repousser à Lourdes, il est des plaies qui ne guérissent jamais.
Aujourd’hui, je l’avoue, je suis pas capable de pardonner à ceux qui m’ont fait du mal. Pardonner au sens évangélique du terme, j’entends. Non par haine ou ressentiment, mais paradoxalement par réalisme. Peut-être par simple balbutiement de sagesse. En cela, aucun doute : je ne suis pas catho. Le Christ Jésus a placé le pardon au sommet de son message. Mais nombre de cathos utilisent le pardon avec facilité et désinvolture (certains pardonnent même à Hitler ou à Poutine), et cela est insupportable : « qui suis-je pour juger ? », entend-on trop souvent. Mais si, il faut juger dans maintes situations : et à défaut de juger, moralement ou pénalement j’entends, il faut garder la place pour la dialectique et la compréhension. Même si le tréfonds des cœurs est inaccessible. L’univers est Process, écrit un philosophe que j’aime (voir ci-dessus) : « process » dans les deux sens du terme, processus et procès. Pardonner sans justice, sans vérité, sans confrontation au mal, au préjudice, à la scélératesse, sans combat, est une imposture. Je comprends et partage l’attitude du futur apôtre Simon-Pierre, dans les Évangiles, quand il répond à Jésus qu’il est impossible de pardonner septante fois sept fois. La réponse de Jésus « c’est possible à Dieu » est certes convaincante, mais peu valable à l’échelle humaine, personnelle ou politique.
*
Il faut être juste dans l’appréciation de ces blessures. Dans l’Église Catholique, j’ai rencontré des personnages exceptionnels. Avant tout, je songe naturellement à Jacques Loew, déjà évoqué, qui, à Fribourg, a perçu en moi des capacités que je n’avais pas remarquées. Jacques Loew était un homme d’écoute et d’amitié comme on en croise rarement, tout en étant un grand bâtisseur d’idées prometteuses et de structures nouvelles. Son rayonnement prophétique sur notre temps me paraît évident, 40 ans plus tard. Je songe également à un prêtre, chimiste, chercheur et directeur d’un laboratoire au CNRS, ancien recteur d’une université, capable d’une écoute et d’une confiance à l’égard des chercheurs qu’il chapeautait et encourageait, comme je n’en ai jamais rencontrées depuis lors. Quatre ans de travail avec lui. Mes larmes coulent quand je me souviens de lui. Il m’a stimulé et souvent réconforté, durant les années où je travaillais dans son laboratoire. Je pense aussi à différents jésuites qui ont été là juste au moment où j’étais mal, qui m’ont fait confiance et qui ont guidé mon chemin intérieur. La tradition ignatienne, qui n’est pourtant pas fondamentalement ma spiritualité la plus intense, reste une de mes références dans maintes situations personnelles et sociales. Et puis, le vice-recteur de la Catho de Lyon m’a défendu en son temps, quand j’ai été remplacé par un prêtre, suite au bon plaisir de l’archevêque d’alors : ce vice-recteur, décédé aujourd’hui, a avoué que les étudiants me préféraient à celui qui m’a remplacé d’autorité. Le prêtre en question faisait plus de catéchisme que de philosophie dans ses cours, m’a-t-on rapporté. Néanmoins, je ne me suis pas fait de véritable ami dans les milieux d’institution catholique, au long de ma carrière professionnelle, et ils m’ont rarement semblé désintéressés. Mes rares amis catholiques sont ou ont été soit des moines, soit des religieux, soit des personnes rencontrées dans d’autres contextes.
Ici, s’arrêtent les considérations concernant les déboires professionnels et personnels, à travers les handicaps et quelques désillusions.
*
Suis-je seul dans cette galère ?
Venons-en aux raisons conjoncturelles. Ce que j’exprime ici est loin d’être exhaustif. Je ne voudrais pas non plus donner l’impression de tirer sur une ambulance.
Les dernières révélations sur la pédophilie des prêtres ne m’ont pas choqué. Lorsque j’avais 9-11 ans, dans une institution religieuse, j’ai été harcelé, comme je l’ai signalé plus haut, par un prêtre, obsédé sexuel, qui profitait des confessions obligatoires pour exsuder ses fantasmes et se frotter contre moi : j’ai encore son odeur écœurante dans la tête. Les dégâts psychologiques ont été importants. J’en ai parlé dans un long courrier envoyé à la CIASE, dans le cadre de l’enquête vers le Rapport Sauvé. Aujourd’hui, je ne crains pas de penser que certaines causes psychosomatiques de la maladie et de mon caractère sont un effet du comportement de ce prêtre. Pas la seule cause, sans doute, mais déterminante quand même. Peut-être même que ma recherche de spiritualité, de philosophie et de théologie, m’a expliqué le psychiatre que j’évoquais, a-t-elle exprimé un désir de compensation à ce désastre. Aujourd’hui, je suis presque guéri de cette vieille histoire, grâce à mon épouse et notre belle aventure familiale, grâce aux marches et à la réappropriation du corps, et sans doute aussi, grâce au soulagement apporté par les révélations de ces dernières années. Elles ont démontré l’ampleur du désastre et le nombre de jeunes touchés bien plus gravement.

Alban Berg, un de mes musiciens préférés
À Fribourg, j’ai eu un très grand ami américain, religieux. Nous faisions de la musique ensemble, du piano, nous partagions de longues conversations existentielles sur le sens de nos engagements. Il ne comprenait pas la musique de Debussy, de Ravel, de Berg ou de Stravinsky que j’adorais : je lui expliquais. C’était une vraie amitié. Il est aujourd’hui en prison aux États-Unis pour pédophilie et abus sur des enfants. Or il m’avait avoué que la grande difficulté de son choix de religieux était de ne pouvoir avoir d’enfants : la question des femmes n’était pas son souci. Plus tard, j’ai eu un autre ami, pianiste également, dans une de ces communautés nouvelles apparues dans les années 70, qui est aussi en prison pour pédophilie. Le fléau de la pédophilie est catastrophique, mais pas illogique dans une société où l’on vit au-delà de 80 ans et à qui on demande à des individus un célibat et une chasteté atemporelle, et donc l’impossibilité de transmettre la vie… Transmission de la vie, thème si fondamental de l’univers biblique ? Il y a quelque chose de tordu, ici.
Bien plus grave sont les abus sexuels et psychologiques perpétrés par des individus de l’Église Catholique, à la réputation de haute spiritualité, sur des femmes et des religieuses, et parfois des adolescents et des enfants, au nom même de l’amour du Christ ou d’une théologie perverse. La pédophilie évoquée dans le paragraphe précédent, est un mal qui relève à la fois de la justice pénale et de la thérapie. En revanche, ce deuxième cas de figure relève d’une perversité autrement plus scandaleuse, puisqu’elle relève de la manipulation religieuse et « spirituelle ». Au passage, je rappelle que le mot « spirituel » est un des concepts dont je me défie le plus ! On est sur ses gardes face à un pédophile, on ne se méfie pas d’un loup déguisé en agneau, ou de l’ombre malfaisante d’un être apparemment rayonnant. Que de tels personnages, morts en odeur de sainteté ou parfois encore vivants, aient pu obtenir l’oreille d’évêques et même de papes est insoutenable : quand ceux-ci ne se révèlent pas complices de ces personnages ou des spiritualités pernicieuses qui enveloppent leurs pratiques ! Qu’ils aient pu aveugler tant de gentils  cathos bien sages et pleins de bonnes intentions a quelque chose de diabolique (qu’on croit au diable ou pas !). Curieusement, les médias parlent beaucoup moins de ces abus sexuels sous couvert de spiritualité, que de la pédophilie. Y aurait-il un malaise dans le monde médiatique ?
cathos bien sages et pleins de bonnes intentions a quelque chose de diabolique (qu’on croit au diable ou pas !). Curieusement, les médias parlent beaucoup moins de ces abus sexuels sous couvert de spiritualité, que de la pédophilie. Y aurait-il un malaise dans le monde médiatique ?
Par ailleurs, les groupes de pression, d’influence et de culpabilisation pullulent dans les couloirs des centres diocésains, pontificaux, ainsi dans les sacristies et les centres paroissiaux. L’enracinement territorial des églises l’explique en grande partie : il y a plus de féodalité que de Christianisme chez nombre de responsables cathos. Occupation de territoires, comptabilité statistique. Ayant déménagé 19 fois dans ma vie sans pouvoir circonscrire mes origines, j’en ai été victime, et j’en sais quelque chose. En plus de l’enracinement local, s’ajoutent les traditions, au mauvais sens du terme : on a toujours fait comme ça et ça marche ! Un écrivain chrétien que j’apprécie a récemment écrit qu’il y a deux catholicismes inconciliables dans l’Église Catholique de France, aujourd’hui : l’un est moins chrétien et évangélique que l’autre. Je partage son avis. Le catholicisme le moins chrétien est en train de prendre progressivement le pouvoir depuis une vingtaine d’années. La canonisation hâtive de Jean-Paul II par exemple, sous la pression de groupes zélés et actifs, a toujours été pour moi une source d’incompréhension, au sein d’une institution réputée pour sa prudence et sa lenteur. Le Pape polonais mérite certes d’être admiré et ses combats sont louables et encourageants. Mais de là à en faire un saint et un modèle précipité, alors qu’un Charles de Foucault, une Madeleine Delbrêl ou un Oscar Romero sont encore en attente d’une minime reconnaissance, ceci mérite d’être analysé. « Selon que vous serez puissants ou misérables », etc. On connaît la fable.
On objectera que les groupes de pression existent dans toutes les institutions et toutes les entreprises. J’en conviens. Néanmoins, la chape plombée du silence au sein de l’institution Église Catholique n’a rien à envier à celle qui recouvrait la Russie stalinienne ou les conspirations nazies, en d’autres temps. Un ami jésuite entrait un jour dans une réunion en s’écriant : « je viens de lire un super traité d’ecclésiologie ! ». « Comment s’appelle-t-il ? », ont demandé les participants. « Il s’appelle : Voyage au pays du Parti Communiste » !

Une des tortures de l’Inquisition (photo prise au Musée de Granada)
Il faut apprendre à pardonner : le pardon est un des foyers des Évangiles. Alors OK. Après tout, je ne suis peu concerné sur le thème des manipulations spirituelles qui ont couverts des abus sexuels sur des religieuses et des femmes. Ceci peut donner l’impression d’un pardon facile… à la différence des humiliations et blessures personnelles. Mais l’église catholique, comme organisme, est comme atteinte d’un cancer : invisible dans un premier temps, mortel dans un second. Durant des années, j’ai été perturbé par des doutes, car je me doutais de ces pratiques. Mais je me sentais isolé. Aujourd’hui, j’attache moins d’importance à ces déviations et perversions. L’ouvrage récent d’une journaliste « La trahison des Pères », a dénoué bien des nœuds qui me ligotaient et qui expliquent en partie l’écriture de ce texte. La lecture du best seller « Sodoma » (en dépit de son parti pris), qui révèle les pratiques sexuelles de nombre d’individus et de groupes au Vatican et les justifications, « spirituelles » encore, de ces pratiques, n’a guère arrangé mon opinion.
Le mal est profond. Cependant l’histoire de quinze à vingt siècles de Christianisme rappelle les moments et les figures peu glorieuses de corrupteurs, de manipulateurs, d’abuseurs de pouvoir, d’inquisiteurs et de fauteurs de guerres, qui les ont traversées. Peut-être ces moments sombres sont-ils une nécessité de l’évolution, le mal et le négatif révélant le positif, la « phénoménologie de l’esprit », pour reprendre les concepts de Hegel ? Je ne sais pas. Toutefois une conviction s’ancre en moi depuis des années : plus on s’approche du vrai et du bon, plus le mal et le mensonge deviennent actifs… C’est souvent l’inverse de ce qu’on croit quand on réfléchit naïvement sur l’évolution humaine.
*
Des raisons conjoncturelles qui explique mon exotisme par rapport au monde catho, il en existe bien d’autres : financières, politiques, sociales. Tout le monde connaît l’histoire tortueuse du Christianisme, et donc du catholicisme : pogroms contre les juifs, conflits ariens et emprise de l’Empire Romain, Croisades, Inquisition, Guerres de religion et Guerre de Trente Ans, colons (colonialistes) avec des missionnaires dans les bagages -ou l’inverse-, connivences avec les puissances d’argent, etc. Je ne développe pas, tout le monde ou presque connaît cette histoire, et c’est aussi la nôtre, qu’on soit catholique, chrétien ou non. L’état de crise est un état permanent de l’histoire humaine et de l’évolution naturelle, et il engendre presque naturellement des troubles. En chaque instant, des moments critiques et des risques de dérive mortifère existent, dès le sein maternel, dès la moindre perturbation climatique, dès le moindre processus de mutation, dès la moindre pensée subversive… J’admets aussi qu’il est plus facile de critiquer 2000 ans d’histoire que 50 ans ou que 20 ans d’histoire récente, hors contexte. « Les vieux ont toujours plus de choses à se reprocher que les jeunes », a écrit Pasternak dans Docteur Jivago. À se faire reprocher, aussi.
*
Finitude, infinitude et condition humaine.
Le troisième ensemble de raisons de l’affirmation « pourquoi je ne suis pas catho », je l’appelle « structurel », histoire de l’enraciner plus durablement dans l’espace de ce que l’on pourrait appeler « le paradigme catho ». Un paradigme est un ensemble de présupposés, inconscients ou non, qui orientent une pensée, une pratique, une théorie, une confession, souvent à l’insu de celui qui pense, qui aime ou qui agit. Par exemple, les historiens qui partagent l’histoire en quatre phases (Antiquité, Moyen âge, Renaissance et Modernité), suivent un paradigme : le Moyen âge n’a jamais existé et le concept de Renaissance est une invention romantique. Les scientifiques qui opposent objectivité et subjectivité suivent également un paradigme : celui qui oppose sujet et objet. Subjectivité et objectivité sont des abstractions, fabriquées dans l’histoire pour une cause, certes efficace en théorie et pour la technologie, mais coupée du concret. Ne parlons pas des paradigmes cachés de la philosophie… Mais au moins, là, les vrais philosophes en sont conscients et cherchent à les repérer et les nommer.
En fait, les petites fissures que j’ai aperçues dès le début des études théologiques, sont devenues aujourd’hui comme des précipices autour de plateaux, ou comme des océans turbulents autour d’îles. Nombre de croyants et de pratiquants se croient en sécurité sur leur plateau ou sur leur île, surtout s’il est entouré de murailles. Ces failles et ces petits ruissellements, que dans ma naïveté de petit théologien et philosophe en herbe je pensais recouvrir de terre divine, sont aujourd’hui dans mon esprit des abîmes et des flots insondables. Curieusement, elles me perturbent moins que dans ma jeunesse, car entre-temps ma pensée s’est systématisée. J’intègre ces béances sans solution à travers l’acceptation de l’insondable. Quand on est jeune, on pense que le savoir et la science vont apporter des solutions aux interrogations existentielles. Mais non : Pierre Teilhard de Chardin, toujours lui, a écrit des pages remarquables et inspirantes sur l’intériorisation de ces faces obscures. Elles sont moins connues que les caricatures qui ont été faites de sa pensée. Il n’est pas le seul penseur à les rappeler et nombre de grands spirituels et penseurs ont écrit sur le langage de la nuit et de l’inconnu.
La plupart des failles vertigineuses, ou des profondeurs abyssales (que chacun choisisse l’image qu’il préfère), je les évoque dans les investigations trinitaires sur mon site personnel. Et là, il faut évoquer un piège : n’imaginons pas que les questions intellectuelles, philosophiques, théologiques ou éthiques, n’ont aucune efficience sociale, politique, scientifique ou psychologique. Rites, pratiques, méthodes, activités, institutions et organisations, naissent d’abord dans les esprits, la plupart du temps pour le bien des individus, des communautés et des peuples, parfois aussi pour leur malheur. En ce qui concerne l’histoire du Christianisme, personne ne peut ignorer l’influence de Saint Augustin, par exemple, sur toute une tradition de pensée théologique et philosophique, mais aussi sur la liturgie, sur l’échelle des valeurs morales, sur l’organisation des églises, voire sur les présupposés de l’ensemble de la culture occidentale. On pourrait dire la même chose d’Origène, d’Arius, d’Athanase ou de Basile de Césarée. Quant au Christianisme dans ses sources, aucun penseur honnête ne pourra nier son impact social, à partir des évangélistes et de Saint Paul. Là aussi, pour le meilleur et pour le pire. J’ai toujours été impressionné de la vitesse avec laquelle le Christianisme s’est répandu autour de la Méditerranée.
On ne peut contourner non plus le personnage de Luther pour analyser les grandes bifurcations qui ont mené à la fois à des guerres et à des bouleversements culturels, économiques et sociaux dans nos nations. On peut dire la même chose de nombre de personnages chrétiens, mais en général de tous les penseurs, grandes femmes et grands hommes qui ont, par le passé, façonné les différentes civilisations.
*
Pour ceux qui ignorent le contenu, l’histoire et la forme de la théologie, voici trois critères d’analyse qui m’ont paru significatifs, entre autres, auxquels j’ajouterai un nœud pire à dénouer que le nœud gordien d’Alexandre. Ceci permettra de mieux cadrer la suite du propos.
« Théologie » signifie « savoir sur Dieu », éventuellement « science de Dieu ». La question de se demander ce qui est contenu ou ce qui est douteux dans le concept de « Dieu » fait partie de ce savoir. Les théologies juives et chrétiennes se penchent sur la possibilité de la divinité ou des divinités de se faire connaître, que ce soient dans les formes païennes, naturelles, panthéistes, ou que ce soient à travers une révélation historique : la Torah, le prophétisme, le messianisme… et la figure du Christ bien sûr pour les chrétiens. Et pourquoi pas la révélation musulmane. S’en suivent les conditions historiques et sociologiques de ces révélations, puis les impacts religieux, sociaux, politiques, juridiques, culturels et institutionnels qu’elles ont occasionnés, et bien sûr l’évolution de la pensée religieuse et celle des pratiques rituelles qu’elles ont engendrées à travers les siècles.
Je propose trois critères qui vont encadrer mes interrogations. Le premier des critères théologiques proposés est celui du rapport entre Dieu et le monde. En gros, deux pôles orientent l’espace de cette relation. D’une part, les théologies soucieuses du salut des hommes ; d’autre part, les théologies soucieuses de la création du monde. Les premières sont assez pessimistes, souvent très anthropocentriques, elles ont une vision tragique de l’humanité pécheresse qui a besoin d’être sauvée : en bonne théologie catholique, on parle plutôt de « rédemption » que de salut. Elles sont prépondérantes en temps de crise et de danger, comme par exemple à l’époque des persécutions, à celle de la désagrégation de l’Empire Romain ou de la fin de ce que les historiens appellent le Moyen âge. Elles ont repris du poil de la bête lors des deux derniers siècles. Les secondes sont plus optimistes, plus rationnelles aussi, et se fondent sur l’étonnement, voire l’émerveillement devant la beauté de l’univers et sur les capacités des hommes à participer à cette création. Les théologiens des Douzième et Treizième Siècle semblent y être plus sensibles, par exemple, et il ne manque pas d’exemples dans l’histoire chrétienne de ces théologiens soucieux de la montée de la création vers son achèvement divin. J’ai eu le bonheur de suivre un cours sur ce thème, lors de mes études, avant à mon tour de m’y intéresser.
En réalité, la presque totalité des courants théologiques intègrent les deux polarités, mais mettent la priorité sur l’une ou sur l’autre… voire parfois une hypertrophie sur l’une au profit de l’autre. À titre personnel, je penche plutôt pour la seconde vision, celle de la création et de la confiance dans les capacités de l’humanité à évoluer et à créer. Mais mon souci à la fois social et empathique envers la souffrance me rappelle à l’ordre et me souffle qu’il vaut mieux être prudent à l’égard d’une vision trop optimiste de l’histoire humaine. Ceux qui ont lu d’autres articles sur mon blog savent les nœuds cruciaux que représentent à mes yeux le personnage de Job dans toutes mes spéculations (la souffrance innocente), la violence intellectuelle et morale qu’impose l’événement Auschwitz et le chemin explosif que représente la rupture de l’homme avec son environnement (voire la croyance de sa supériorité et de sa capacité à dominer la nature). S’étonner de la richesse de l’univers et de la vie, croire en sa capacité créatrice est une chose, se rappeler de sa cruauté et de l’absurdité de la souffrance et du mal en est une seconde à ne jamais omettre. De plus, Job, l’innocent qui souffre sans raison, demande un défenseur et non un sauveur.
Le second des critères proposés est celui de la représentation du Dieu des différentes confessions religieuses ou philosophiques, ou de la représentation du divin… Ou image de Dieu, si vous préférez. Globalement, les courants théologiques se divisent entre ceux qui sont sensibles à l’infinité de Dieu et à l’impossibilité de le représenter, et ceux qui estiment que l’incarnation, les incarnations (pourquoi pas) ou les manifestations divines (théophanies ou révélations) ouvrent des portes aux possibilités d’une représentation sensible, rationnelle, symbolique. Les extrêmes vont de l’iconoclasme (destruction de toute image et de toute représentation divine) aux excès du Baroque religieux et parfois aussi à ceux des grands systèmes théologiques rationalistes clos sur eux-mêmes.  En ce qui me concerne, je navigue entre les deux : le fait que les grandes religions confessent que le créateur de ce monde ait la possibilité de parler dans l’histoire et dans les consciences capables de l’entendre (qu’on y croit ou non), et le fait qu’il agisse silencieusement par son Esprit, me rendent sensible aux capacités humaines de se représenter Dieu ou au minimum quelque manifestation de sa créativité dans la nature et dans l’histoire. Ou au minimum un visage ou plusieurs visages divins. Mais les abus de « spirituels », de clergés, de faux mages, voire de pouvoirs politiques et prosélytes, qui manipulent les chercheurs et les petites gens à partir d’images perverses ou idolâtriques de Dieu, me font comprendre, sans les approuver, les excès iconoclastes. L’homme fait Dieu à son image, n’est-ce pas ? Pour être certain de ne sombrer ni dans le rationalisme, ni dans l’iconoclasme, on comprendra l’intérêt que je porte vers le symbolique, le récit et le dialogue… et la Bible en est une des portes assurées.
En ce qui me concerne, je navigue entre les deux : le fait que les grandes religions confessent que le créateur de ce monde ait la possibilité de parler dans l’histoire et dans les consciences capables de l’entendre (qu’on y croit ou non), et le fait qu’il agisse silencieusement par son Esprit, me rendent sensible aux capacités humaines de se représenter Dieu ou au minimum quelque manifestation de sa créativité dans la nature et dans l’histoire. Ou au minimum un visage ou plusieurs visages divins. Mais les abus de « spirituels », de clergés, de faux mages, voire de pouvoirs politiques et prosélytes, qui manipulent les chercheurs et les petites gens à partir d’images perverses ou idolâtriques de Dieu, me font comprendre, sans les approuver, les excès iconoclastes. L’homme fait Dieu à son image, n’est-ce pas ? Pour être certain de ne sombrer ni dans le rationalisme, ni dans l’iconoclasme, on comprendra l’intérêt que je porte vers le symbolique, le récit et le dialogue… et la Bible en est une des portes assurées.
Le troisième de ces critères est celui du rapport de la théologie à l’écriture dite « sainte » dans les traditions chrétiennes et juives (l’Islam, je ne le fréquente pas suffisamment). Certains théologiens s’en éloignent beaucoup trop au risque de préférer leur système rationnel à la rudesse des textes bibliques, d’autres collent tellement aux textes qu’ils refusent toute rationalisation possible et transforment ces récits en règles morales ou politiques, ou pire, basculent vers le fondamentalisme, le créationnisme et autres sottises. En fait, là encore, le gradient qui va d’un ensemble de courants théologiques à l’autre est large et varié. Personnellement, je récuse à la fois les fondamentalistes d’un côté, et les excès spiritualistes ou rationalistes de l’autre, non en tant que chercheurs, mais quand ils deviennent dogmatiques, qu’ils refusent la dialectique et l’aventure. Rester dans son auberge ou son île. La Bible est une bibliothèque qui prend son sens dans la mesure où elle révèle une histoire passionnante et vivante, qu’elle ne cache rien des grandeurs et des misères humaines, et qu’elle a permis et permet encore à des communautés de vivre et de progresser dans la connaissance des hommes et du divin. En ce sens, elle est inégalable : aucun texte antique n’intègre à la fois la durée des événements et des témoignages, et la variété des espaces possibles d’herméneutique. Même la tragédie grecque, même l’Iliade et l’Odyssée. L’interprétation immédiate et l’interprétation globale des textes mettent en valeur les multiples contradictions et ouvertures de sens, explicites ou cachés. Plus nous lisons la Bible, non pas celle qui nous arrange, mais celle qui est aussi épaisse que la vie des hommes et du monde, plus nous devenons un peu plus humbles dans nos convictions et nos sécurités.
*
À ces trois dimensions, il faudrait ajouter, bien sûr, les interfaces de la théologie chrétienne avec d’autres savoirs (sciences, philosophies, arts, autres religions), avec la modernité technique, économique et sociale, avec les différentes formes d’athéisme et d’agnosticisme. Ce sont des lieux que j’ai beaucoup fréquentés, parce que je me suis toujours senti plus à l’aise dans les frontières et les champs d’exploration qu’à l’intérieur de forteresses ou de cités protégées par des certitudes. À partir de ces trois critères et compte-tenu de ma position toujours incertaine dans des vallées marécageuses ou sur des lignes de crêtes, je vais essayer d’expliquer les raisons structurelles de mon affirmation initiale.
J’ai parlé d’un nœud plus crucial que tous les nœuds. Je l’ai rappelé ci-dessus, il s’agit de celui e l’interrogation face à la souffrance innocente. Le Christ crucifié, vu comme simple sauveur, ne répond pas à mes yeux à l’interrogation de Job, le sage douloureusement éprouvé. Je renvoie à mes méditations sur le personnage. Voilà encore une raison pour laquelle je ne suis pas catho.
*
Vagabondages.
Avant d’évoquer en quelques propos fluides les failles évoquées plus haut, je dois reconnaître là aussi l’immense apport intellectuel et « spirituel » que m’ont apporté l’histoire et la méditation chrétienne, voire aussi la réflexion de l’histoire humaine et de la philosophie.
Rappelons, que les concepts de « personne », « d’existence », de « dignité », si essentiels aujourd’hui, jusqu’à inspirer la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme par exemple, sont apparus dans le contexte des disputes autour de la Trinité et de leur relecture médiévale. Le concept de « liberté », au sens moderne du mot, notamment dans sa dimension de liberté de conscience et de responsabilisation personnelle dans l’histoire, doit beaucoup à la Bible, plus encore qu’à la philosophie grecque qui a plutôt défini la liberté du citoyen et la liberté politique. La libération des hébreux de l’esclavage d’Égypte par Moïse, ou le retour de Babylone des juifs exilés, préfigurent toute la réflexion sur la liberté intérieure continuée par les livres sapientiaux de la Bible ou la dénonciation des oppressions par les prophètes. L’Antiquité religieuse et philosophique restait sous l’emprise des mythologies pour lesquelles les femmes et les hommes sont gouvernés à leur insu par des dieux (se rappeler l’Épopée de Gilgamesh, l’Odyssée ou le théâtre de Sophocle). Tout le contraire de l’espace biblique où le Dieu passe son temps à appeler les personnages à leur responsabilité, voire à se retirer dans son silence afin de laisser ces mêmes personnages seuls face à eux-mêmes et face aux événements. Quant à la liberté des cœurs et des consciences proposée par le Christ Jésus, proposée encore par Paul, mais aussi par toutes les traditions qui enveloppent et interprètent les histoires bibliques, elle est juive et chrétienne. Cette liberté recouvre également la distance de chaque conscience à l’égard des doctrines et des pratiques religieuses, et la priorité de la vie sur les idées et les rituels. La sainteté et la justice sont plus fondamentales que le sacré.
Je pourrais aussi évoquer la multitude des saints et des grands spirituels chrétiens, qu’on les aime ou non, qui ont marqué les esprits et les cœurs et inféré par leur vie et leur action des axes sociaux et éthiques. À titre personnel, je ne peux contourner Grégoire de Nysse (j’ai été passionné par « la Vie de Moïse »), Maxime le Confesseur (dont je possède un petit livre offert par mon ami américain devenu pédophile, malheureusement), Thomas d’Aquin, Ignace de Loyola, Thérèse d’Avila et Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux et Bernadette de Lourdes, et plus récemment Pierre Teilhard de Chardin, Madeleine Delbrel, Jacques Loew (déjà évoqués), ou encore en ce qui concerne les chercheurs aujourd’hui, Jean-Baptiste Metz, Karl Rahner, Alexandre Ganoczy, John Meier et combien d’autres ; Du côté du Protestantisme récent, Jurgen Moltmann, Dietrich Bonhoeffer ou John Cobb ; du côté de l’Orient récent, Vladimir Lossky, Olivier Clément, Vladimir Soloviev ou Nicolas Berdiaev. Sans oublier les exégètes ! Je fais jouer ici ma mémoire, mais si j’allais exciter cette mémoire en parcourant ma bibliothèque en bas dans le salon, ou en songeant aux livres que j’ai donnés ici et là (notamment après mes marches sur le Chemin de Compostelle), bien d’autres magnifiques personnages me reviendraient à la conscience.
N’oublions pas bien sûr, à l’origine, Jésus, Paul, Jean et tous les témoins de Pâques et tous ceux qui ont appartenu aux premières générations chrétiennes, avant que le Christianisme n’explose dans des directions différentes.
Plus largement, l’histoire chrétienne appartient à la belle épopée humaine, celle de la Noogénèse où on retrouve combien d’autres personnages fascinants : celle des personnalités aussi fortes  et variées que Moïse, Élie, David, les prophètes et sages de la Bible, ou encore Lao Tseu, le Bouddha Gautama, Socrate, Platon, Mani, Maïmonide, Mahomet, Averroès ou Abd del Kader. Élargissons encore la belle aventure humaine : celle des sciences, de la médecine, des arts, de la musique, de la littérature, du droit, de l’architecture et de l’urbanisme ! Combien de personnages admirables ont été les sujets de discussion et de débat avec la religion chrétienne.
et variées que Moïse, Élie, David, les prophètes et sages de la Bible, ou encore Lao Tseu, le Bouddha Gautama, Socrate, Platon, Mani, Maïmonide, Mahomet, Averroès ou Abd del Kader. Élargissons encore la belle aventure humaine : celle des sciences, de la médecine, des arts, de la musique, de la littérature, du droit, de l’architecture et de l’urbanisme ! Combien de personnages admirables ont été les sujets de discussion et de débat avec la religion chrétienne.
J’ai mes petites préférences et elles inclinent ma méditation dans telle ou telle direction. Attention, que l’on soit clair : j’essaie de ne pas avoir de préférences au sens où elles me plairaient (narcissisme intellectuel). L’inverse n’est pas non plus sain (masochisme intellectuel qui consiste à lire systématiquement ce qui nous déplaît). Mes préférences évoluent dans la mesure où elles naissent comme questions et dérangement de mon confort : celles qui me remettent en chemin. Puis elles se dirigent vers les pensées qui essaient de donner sens au monde qui se présente à nous, quand je suis déstabilisé : celles qui, après la marche, me donnent le désir de me reposer et de relire. Mouvement et repos, les deux pôles indiqués au début de ce texte. Par exemple, l’image du réel induite par les sciences et les progrès des connaissances humaines, du point de vue des théories comme de celui des expériences et de l’histoire, changent nos vieilles visions. Je lisais il y a quelques jours l’obsolescence des notions de « ciel » et de « terre » confessées dans le Credo chrétien (élaborés dans un contexte ptoléméen), et la difficulté de les actualiser.
Dans cette recherche de sens, j’avoue que la littérature et la musique m’ont aussi beaucoup apportées, dans la mesure de mes petites capacités. Par exemple, un Isaac Azimov ou un Dan Simmons m’ont autant inspiré dans ma recherche qu’un Dostoeivski, un Pascal ou un Thomas Mann. Au risque de passer pour un plouc ! Anecdote : un jour, j’ai montré, à un théologien lyonnais parmi mes collègues, un passage d’un roman de Stephen King qui m’avait inféré de belles intuitions. Celui-ci m’a regardé avec un mépris dont j’ai encore le vif souvenir. J’ai perdu ce jour-là toute crédibilité à ses yeux.
Pareil pour la musique : Bach est incontournable, je l’admets, mais Stravinski, Debussy ou Alban Berg m’ont apporté des émotions et des intuitions théologiques toutes aussi religieuses que celle du Cantor. La structure globale des quatre premières symphonies de Gustav Mahler m’ont plus inspiré, théologiquement parlant, que bien des traités écrits. Bon j’arrête là le catalogue des noms et des références, car je sais d’expérience qu’il en agace certains. Le catalogue représente un espace de possibilités infinies où j’essaie de puiser du sens. Nietzsche, Marx, Freud ou Russell pourraient aussi faire partie du catalogue ! J’ai plus lu le premier que les autres, et il me sert souvent de garde-fou contre les extrémismes et les fanatismes…
Une des raisons de l’affirmation selon laquelle je ne suis pas catholique (et non pas « je ne me sens plus catholique »), est lié à ce que le théologien Paul Tillich appelle la « provincialisation de l’Église Catholique » (et des autres églises, par la même occasion). L’Église Catholique représente 15 % de la population mondiale. Et comme il apparaît que la possibilité d’autres planètes habitées est très vraisemblable, la revendication de « vérité » que les autorités catholiques aiment proclamer paraît bien relative. Cette dernière remarque mérite un gros travail sur le concept de « vérité ». J’en ai déjà parlé ailleurs. Pour simplifier, on oppose souvent « vérité » et « erreur », avec l’idée que vérité signifie exactitude ou objectivité. Approche purement rationaliste. Cette confusion embrume les mentalités, même si elle est acceptable dans des domaines très particuliers, les sciences formelles par exemple ou des sciences d’observation immédiate. Et encore ! Gros débat qui m’entraînerait trop loin. Vérité s’oppose aussi à mensonge, approche plus éthique, plus religieuse aussi, et elle marque l’accord entre l’esprit et la parole. Mais nous pouvons aller plus loin. Le Christ Jésus, dans l’Évangile de Jean, ne dit pas « j’ai la vérité », mais « je suis la vérité », déplaçant la notion de l’univers des représentations, de la nature des choses et de la morale vers celui de la présence physique et de la personne (très important), et donc des relations interpersonnelles et de la confiance. Bref, la relation de personne à personne, de sujet à sujet, à travers le verbe, a la priorité sur les idées, les théories et les doctrines. Bien que la Bible soit trop riche pour être réduite à ce point, une de ses richesses est de montrer la capacité de l’homme à parler face à face avec son Dieu. Est-il nécessaire de le montrer ?
 L’Église Catholique s’est trop longtemps appuyée sur une doctrine qu’elle disait vraie pour être compréhensible et crédible aujourd’hui. 15 % de prétendue « Vérité » de l’espace catholique sur la Planète Terre signifient que 85 %, Chine, Inde, Japon, monde musulman, monde juif, monde animiste et monde chrétien non catholique, sont à l’extérieur de la « Vérité », voire non sensibilisés. Et je ne parle pas des agnostiques et athées qui progressent dans nos contrées, d’autant plus que les statisticiens les placent parfois dans les 15 % (il n’y a pas d’athées en monde musulman et en monde hindouiste).
L’Église Catholique s’est trop longtemps appuyée sur une doctrine qu’elle disait vraie pour être compréhensible et crédible aujourd’hui. 15 % de prétendue « Vérité » de l’espace catholique sur la Planète Terre signifient que 85 %, Chine, Inde, Japon, monde musulman, monde juif, monde animiste et monde chrétien non catholique, sont à l’extérieur de la « Vérité », voire non sensibilisés. Et je ne parle pas des agnostiques et athées qui progressent dans nos contrées, d’autant plus que les statisticiens les placent parfois dans les 15 % (il n’y a pas d’athées en monde musulman et en monde hindouiste).
Les seuls discours reconnus qui peuvent prétendre à l’universalité, sont celui de la démarche scientifique, même si elle relève de paradigmes à la fois naturalistes et rationalistes, et celui de branches de la philosophie comme la métaphysique, l’épistémologie (philosophie de la connaissance) ou la phénoménologie, à condition dans les trois cas d’en accepter les présupposés.
Le concept de « métaphysique » est mal vu par les scientifiques, je sais, surtout quand il a la prétention d’envelopper la physique (et donc les sciences). Mais l’objectif des grands systèmes métaphysiques est la recherche de la vérité de l’être et la conjugaison de l’universalité et du sens. Les sciences, elles, ne proposent pas de sens, du moins pas à première vue : c’est leur méthodologie traditionnelle. Elles fonctionnent jusqu’au XIXème siècle dans le champ des causes efficientes, en vue du développement technologique, comme l’ont bien exprimé Descartes, Bacon et Galilée. Elles excluent toute finalité et ne s’intéressent pas au pourquoi de l’être. En revanche, les sciences dessinent un monde qui en élimine d’autres et qui rend caduque bien des conceptions cosmologiques, biologiques et anthropologiques d’autrefois. Il est sûr qu’avec le développement actuel rapide des conceptions scientifiques, la possibilité d’une métaphysique est plus incertaine. Mais pourquoi y renoncer par principe ?
Elles excluent toute finalité et ne s’intéressent pas au pourquoi de l’être. En revanche, les sciences dessinent un monde qui en élimine d’autres et qui rend caduque bien des conceptions cosmologiques, biologiques et anthropologiques d’autrefois. Il est sûr qu’avec le développement actuel rapide des conceptions scientifiques, la possibilité d’une métaphysique est plus incertaine. Mais pourquoi y renoncer par principe ?
Cela dit, l’universalité ne fait pas tout, j’en conviens. C’est un autre atout de la Bible que de révéler que l’absolu divin, l’Éternel, Adonaï, enfin bref ce que chacun veut, se rencontre aussi dans la singularité et dans l’échange interpersonnel.
Pour en revenir à l’universel, je reconnais éprouver une grande confiance aux sciences formelles (logique, mathématiques et sciences quantitatives), et aux sciences empirico-formelles, c’est-à-dire la physique et toutes celles, sciences de la nature surtout, qui s’inscrivent dans son paradigme ou sa proximité méthodologique. Ces sciences anticipent les bouleversements paradigmatiques qui se distillent ensuite dans les autres disciplines. Ainsi en est-il, par exemple, de la conception du temps et de l’espace, ou des paradoxes du hasard et des probabilités, de la représentation de l’univers et des cosmologies qu’elle induit. Les sciences humaines et les sciences historiques reposent sur des méthodologies moins certaines et des paradigmes hérités parfois d’un autre âge : celle du mécanisme post-newtonien, par exemple, voire quelquefois pré-newtonien. Je n’en fais pas reproche. De ce point de vue et indépendamment de la méthodologie herméneutique, elles sont en retard sur les sciences de la nature. Or nombre de théologiens ignorent les sciences de la nature ou les sciences formelles, et continuent à penser à l’intérieur de présupposés désuets venus des sciences humaines, d’une vision très approximative de l’histoire et de la nature, réalités infiniment complexes, et parfois même d’une connaissance des mathématiques et de la logique formelle. Un théologien catho de mes collègues à Lyon se moquait un jour devant ses collègues (dont moi-même) d’un étudiant qui avait écrit que la valeur d’un angle plat (disait-il) était Pi. Je lui ai fait remarquer que cet étudiant avait raison (Pi radian) : il s’est excusé et m’a dit « Nicolas, il va falloir que je prenne des cours de maths avec vous ! ». Peut-être bien aussi des cours de physique, de biologie et de zoologie ? Petite précision toutefois : je ne suis pas très bon en maths.
La part herméneutique des sciences dites humaines, beaucoup plus étendue et moins circonscrite que celle des sciences de la nature, me les fait considérer comme moins pertinentes en ce qui concerne la théologie de la création : le risque est de réduire la théologie à une affaire historique, psychologique et politique. C’est dommage. Cosmologie, physique, biologie et évolution, géologie et géographie, et pourquoi pas biologie et écologie, infèrent des axes et des dynamiques d’une représentation du monde qui font exploser bien des catégories qui encadrent les sciences humaines. Relativité, physique quantique, évolution, chaos, théories de l’information et des systèmes, complexité, n’y sont pas intégrées. Le philosophe anglo-saxon de la « Process Philosophy », Alfred North Whitehead, déjà évoqué ci-dessus, ainsi que ses disciples, m’ont beaucoup aidé à discerner les plans de réflexion… Chose amusante, nombre d’entre eux sont croyants, à leur manière, voire théologiens (j’ai évoqué Jobb Cobb, mais il en est bien d’autres) : une foi très solidement construite sur une rationalité inspirée des sciences de la nature, sans créationnisme, ni « Intelligent Design », sans « Deus ex Machina ». Complexité et « process » (intraduisible en français), créativité et organicité du réel, sont quatre clés de la pensée de la philosophie et de la théologie du « Process ». Isabelle Stengers, la solide et fougueuse philosophe de Bruxelles, athée pourtant, écrit que Whitehead est le meilleur contrepoison à Heidegger, dont se gargarisent nombre de théologiens catholiques, et dont la pensée nauséabonde s’insinue par capillarité dans les consciences.
Le bon Michel Serres a écrit un jour qu’on donnait trop de poids dans la philosophie à l’histoire au détriment de la géographie. J’interprète : trop de poids à l’anthropocentrisme au détriment du cosmos, du chaos, de la terre (Terre) et des organismes non humains. En théologie, trop de poids au Christ au détriment de l’Esprit Créateur (c’est un de mes dadas !).
*
Je le répète : j’ai beaucoup appris de la théologie chrétienne. Elle m’a aidé à mieux saisir l’humain, ses sagesses et ses délires. Homo Sapiens et Homo Demens, aspiration à la vérité et besoin d’intimité. Mais face à l’infiniment grand, face à l’infinie complexité des écosystèmes, face à la question de l’injustice du partage des existences, face aussi à l’innocent qui souffre (Job, toujours), face au déchaînement froid de haines (Auschwitz), face à l’indifférence condescendante et statistique de techniciens et aux monstres qu’ils engendrent (Hiroshima), elle ne m’a pas apporté ce que j’en attendais. Les réponses christologiques et surtout sacramentelles sont lapidaires et précipitées et contournent la situation existentielle de nombre de nos contemporains : la condition humaine sous tous ses angles est caricaturée ou s’appuie sur des présupposés d’un autre âge. Faire de la théologie ne devrait pas consister à boucher les trous. Son anthropologie, corps-esprit-âme, par exemple, est trop simpliste pour être crédible. Et je ne parle pas de tous les dualismes catastrophiques qui circulent : esprit et matière, religion et science, corps et âme, objet et sujet, église et monde, et le pire, Dieu et le monde… Ajoutons que la mode « Dieu est Amour » que j’entends à tire larigot dans les sermons et les catéchismes, amour confondu avec tendresse et mièvrerie, je la ressens comme une agression. Que ces prêtres et autres bavards songent aux camps d’extermination ou aux catastrophes naturelles, avant de déblatérer avec désinvolture sur l’amour de Dieu… ou pour rejoindre mon expérience personnelle, qu’ils aillent voir ce qui se passe dans une unité de réanimation dans un hôpital. Qu’ils relisent le livre de Job (en faisant abstraction des premiers et derniers versets). Il est absurde de parler d’amour sans justice et sans vérité. Naturellement, ces thèmes sont débattus dans des cercles intellectuels restreints… Mais en sortent-ils ?
À l’heure où j’écris, l’exégèse biblique (et la Bible bien sûr), les grands débats qui ont précédé la rupture entre Occident et Orient, avant l’apparition de l’Islam, de la scolastique médiévale et de la Réforme, restent les domaines envers lesquels je garde ma plus grande confiance. J’ai aussi apprécié les formations en éthique fondamentale, parce que là, je reconnais que l’Église Catholique et les églises protestantes, comme de vieilles grand-mères auprès du feu, ont souvent quelque chose à dire de juste et de sage. Sauf en éthique sexuelle, en ce qui concerne les cathos ! En revanche, les sermons et discours sur les sacrements, sur la structure de l’institution église, sur des absurdités comme l’infaillibilité du Pape, et sur bien des points de doctrine, me paraissent oiseux, obsolètes et parfois carrément débiles. L’ecclésiologie et la théologie des sacrements m’ont toujours profondément ennuyé, et plus encore lorsqu’elles justifient des sottises (comme la discrimination des femmes, par exemple) ou induisent des attitudes de magie et de superstition (substantialisme du « Saint Sacrement », entre autres, sacralisation d’objets du culte, génuflexions dans l’axe de l’autel, peu différents des signes de croix des joueurs avant des matchs de foot, etc.). Certains font des thèses sur ces thèmes ! Je les félicite. Qui les lira, sinon les clercs déjà convaincus ? Qu’en est-il par exemple des revendications féministes légitimes et autrement plus graves, surtout en un temps de montée des intégrismes religieux ? Qu’en est-il de la réflexion engendrée par la nouvelle vision du monde qui monte ? Qu’en est-il face au village Planète et ses inévitables métissages et

Un des portraits de femmes exceptionnelles qui on contribué à l’évolution de la Bolivie. Toute une rue de La Paz leur est consacré.
rencontres ? J’attends. Pas grand-chose dans les discours et sermons. Tout cela me fatigue et ne m’intéresse plus. Pour cette raison, je ne suis pas catho.
Par ailleurs, toujours dans la ligne des 15 % et des 85 %, les autres grandes traditions religieuses ont aussi des richesses qui m’ont passionné et qui me paraissent tout autant des vectrices de vérité et de sens. Je vais reprendre la question d’un point de vue de ma chronologie personnelle. Pardon de mes répétitions.
Du côté chrétien, la grande tradition orthodoxe m’a beaucoup touché. Sans développer, en voici quelques traits marquants : d’une part, dans la ligne de la philosophie grecque, l’univers orthodoxe est plus ouvert au sens de la beauté associée à la grandeur du cosmos et de l’humanité (on ne voit pas de Christ torturé, comme dans l’iconographie catholique et protestante) ; d’autre part, la spiritualité orthodoxe ne culpabilise pas, ou moins que les sermons catholiques. Elle invite, certes, à une ascèse personnelle et à des pratiques morales à exercer sur soi-même, mais en vue d’une communication avec la Trinité qui n’est pas réservée à des saints ou à un clergé. Les récits du Pèlerin Russe ont transformé ma vie de prière et mes états d’âme théologiques. Ma vision est celle que je garde des jeunes années, et elle n’est sans doute pas réelle sur le terrain : je n’ai pas eu l’occasion de vérifier. La vision trinitaire ouvre un espace considérable à l’action créatrice et « personnifiante » de l’Esprit (« L’Esprit vous rendra libres »), presque complètement abandonnée par les traditions occidentales (sauf dernièrement). En Occident, l’Esprit a abandonné la théologie pour vagabonder dans la philosophie, et nous pouvons remercier Hegel au passage. Le monde orthodoxe, très vaste, que je ne connais qu’à travers quelques lectures clé, présente aussi de gros défauts, vu depuis mon petit balcon, notamment sur le plan politique et social… Ce qui se passe ces derniers temps entre les églises de Russie et d’Ukraine fait tâche. Mais ce point ne m’arrête pas. Ma prière personnelle est fondée en grande partie sur la tradition hésychaste, la philocalie, et j’ai beaucoup d’admiration pour Grégoire Palamas, par exemple (que l’Église Catholique a condamné, je me demande bien pourquoi !).
Le monde protestant, surtout celui des Réformés et des Luthériens, m’a également beaucoup apporté, je l’ai écrit ci-dessus. Je lui dois la liberté de lecture à l’égard de la Bible, ouverte par le travail des exégètes : les catholiques ont suivi, mais un peu tard. De plus, les protestants sont plus proches de l’esprit scientifique qui est une des empreintes de mon éducation et de ma culture. En revanche, l’excès moralisateur qui se voit dans quelques communautés qui appartiennent aux courants protestants et évangéliques, notamment de l’autre côté de l’Atlantique, est plutôt un repoussoir. Les théologiens allemands de la Réforme sont des références plus sûres.

Dietrich Bonhoeffer
Parmi eux, je ne peux contourner deux personnages, certes bien différents, mais très symboliques : le premier est Dietrich Bonhoeffer, l’admirable pasteur réformé condamné et exécuté sur ordre personnel d’Hitler (qui voyait en lui un de ses pires ennemis), qui sut insuffler dans les églises l’intuition biblique de résistance et de libération. Face à Bonhoeffer, il est difficile de ne pas rester sans voix. Admiration totale. L’autre théologien est Jürgen Moltmann dont j’ai lu presque tous les livres, ainsi que ceux de son épouse : il est souvent vingt ans en avance sur les autres et clarifie des interrogations qui aujourd’hui semblent aller de soi. Questions écologiques ou œcuméniques, par exemple, mais aussi rapport à l’histoire récente, là où l’Allemagne a failli.
Parmi la tradition dite protestante (mais l’est-elle ?), j’ai déjà avoué ma dette à l’égard de la philosophie et de la théologie du Process. Celle-ci est la seule théologie sérieuse que j’ai vu adopter de l’intérieur les révolutions scientifiques de ces derniers siècles et surtout du Vingtième Siècle. Seul reproche : la coquetterie rationaliste et parfois excessive de certains théologiens du Process.
Les juifs ? Je me demande souvent pourquoi je ne me suis pas converti au Judaïsme. Nombre de chrétiens voudraient que les juifs se « convertissent » au Christianisme. Il me semble que c’est le plutôt l’inverse qui devrait se produire : que les chrétiens se « convertissent » au Judaïsme. C’est incroyable tout ce que je dois au Judaïsme : à travers les écrivains que j’ai lus et travaillés, à travers la liberté herméneutique, targums et midrashs, lectures et relectures, qui est le sang de la pensée, de l’activité et de la créativité juives. Liberté même à l’égard du concept de Dieu ou de la forme de la prière. La plupart des penseurs auxquels je me réfère la plupart du temps sont des juifs, quand sur des thèmes semblables (rapport à l’existence et au temps, rapport à la philosophie, rapport aux sciences), philosophes et théologiens chrétiens m’ennuient souvent. J’apprécie la multiplication infinie de la parole et son rapport avec le silence et l’écoute : « Shema Israël ». Il n’y a pas d’inquisition dans le Judaïsme, ni de « doctrine officielle ». On lit, on relit les textes, parfois en collant, parfois en traversant, parfois en spéculant, avec la seule limite proposée, en gros, par le Décalogue. Et encore ! Il faudrait creuser ! Le Judaïsme semble donner à la parole et à l’écoute ce que les orthodoxes donnent à l’Esprit. Il ne se fonde pas sur une foi ou un savoir, mais sur l’écoute. Le Judaïsme repose sur le « Écoute Israël » (Shema), là où le Christianisme repose sur la confession individualiste « Je crois » (Credo).
 J’avoue avoir été fasciné par les intuitions mystiques d’Isaac Luria, via l’interprétation de Gershom Scholem et de quelques autres, et plus largement par les spiritualités de l’Exil qu’on n’hésite pas à subsumer en Dieu lui-même. Le théologien et rabbin André Neher avoue qu’à ses yeux, la Bible est davantage le livre du « Silence de Dieu » que celui de la « Parole de Dieu ». Ainsi par ce silence divin, les femmes et les hommes sont renvoyés à la responsabilité et à la capacité créative que leur offre cette liberté souveraine. L’homme seul face à sa liberté. Le biologiste athée Jacques Monod s’en émouvait dans son best-seller « Le hasard et la nécessité ». Eh oui, le Dieu biblique et chrétien paraît bien trop souvent silencieux : mais l’interprétation juive et l’interprétation athée de ce silence partent dans deux directions opposées. Voir ci-dessous, en ce qui concerne l’athéisme.
J’avoue avoir été fasciné par les intuitions mystiques d’Isaac Luria, via l’interprétation de Gershom Scholem et de quelques autres, et plus largement par les spiritualités de l’Exil qu’on n’hésite pas à subsumer en Dieu lui-même. Le théologien et rabbin André Neher avoue qu’à ses yeux, la Bible est davantage le livre du « Silence de Dieu » que celui de la « Parole de Dieu ». Ainsi par ce silence divin, les femmes et les hommes sont renvoyés à la responsabilité et à la capacité créative que leur offre cette liberté souveraine. L’homme seul face à sa liberté. Le biologiste athée Jacques Monod s’en émouvait dans son best-seller « Le hasard et la nécessité ». Eh oui, le Dieu biblique et chrétien paraît bien trop souvent silencieux : mais l’interprétation juive et l’interprétation athée de ce silence partent dans deux directions opposées. Voir ci-dessous, en ce qui concerne l’athéisme.
J’ai cherché si dans l’Islam, cette même apologie, interprétative, religieuse et politique, de la liberté se retrouvait. Malheureusement, il m’a semblé que dans l’Islam, l’herméneutique reste très pratico-pratique et juridique, et que l’espace théologique est fermé. L’Islam, même dans sa mystique, ne m’a jamais beaucoup intéressé. Lors d’une réunion de partage religieux, un de mes amis musulmans a dit que plus on se rapproche de Dieu, plus on perd sa liberté… ce qui a fait bondir une amie en recherche de sens. Exprimait-il l’essence de l’Islam ? Je n’en sais rien.
Quant à l’Extrême Orient, Taoïsme, Confucianisme, Bouddhisme, Hindouisme, Shintoïsme, je n’ai pas pris le temps de les creuser. La médiation de Pierre Teilhard de Chardin, de jésuites divers, d’Alexandra David Néel (qui a un magnifique portrait de Teilhard, sur son bureau, à Digne), a entrouvert des portes, mais je n’ai pas franchi les seuils. Récemment, un texte de Simone Weil a éveillé mon attention autour du fait que les religions de l’Orient auraient développé une dimension impersonnelle du divin qui rééquilibre l’excès personnel du Dieu des religions monothéistes et polythéistes. Peut-être. C’est intéressant si l’on veut creuser l’aspect naturel d’une théologie de la création. Il faudrait voir : je creuserai cette terre, si Dieu me prête vie. L’univers religieux de l’Extrême Orient représente plus de 60 % de la Planète. Soyons sérieux. La part de vérité doit être considérable dans ces lieux insuffisamment explorés.
*
L’athéisme, je pourrais en parler plus longuement. Il m’a tenté à certaines périodes de ma vie et habite certains espaces de ma conscience. Son côté idéologique d’une part, son absence de sens d’autre part, ont plutôt séduit ma face dépressive. Aux Dix-Huitième Siècle et au Dix-Neuvième Siècle, face au pouvoir écrasant des églises dans nos nations, l’athéisme était courageux. Au Vingt-et-Unième Siècle, je le trouve plutôt prétentieux et racoleur. Les abominations de l’athéisme, dans l’Allemagne nazie, dans les goulags staliniens, les prétendues révolutions maoïstes, cambodgiennes, le cynisme athée, manipulateur et moqueur de nombre de puissants capitalistes, l’inculture méprisante de scientistes ou de mauvais positivistes, m’ont refroidi. J’ai dans mes notes un texte de Teilhard de Chardin, encore lui, qui balaie avec vigueur et intelligence ce snobisme athée. On attend des athées un peu plus d’humilité et une vraie alternative à la question du sens.
En revanche, l’apport principal de l’athéisme a été de remettre les religions à leur place, dans un esprit laïc justifié et démocratique, et je m’en réjouis. Le silence de Dieu est une preuve de son inexistence, pense Sartre. La pensée juive en fait plutôt le fondement de notre liberté et d’un jeu de parole-réponse authentique avec le divin. Mais en soi, l’athéisme n’apporte pas grand-chose à l’humanité, en dehors de sa dimension méthodologique et sociale. Ah si ! Marcel Gaucher, athée fort pertinent, parle du Christianisme comme la « religion de la fin des religions » (correction : il semblerait que cette expression soit de Dietrich Bonhoeffer). L’athéisme est apparu dans un monde juif et chrétien. Les chrétiens du Troisième et Quatrième Siècles étaient appelés athées par les empereurs romains. Je partage l’opinion de Marcel Gaucher, mais dans un esprit disons « juif ». Interprétons, interprétons : si une religion ou des rites apportent un bien, ou un mieux vivre, à une personne, à une communauté, dans tel ou tel lieu, dans telle ou telle circonstance, pourquoi pas l’écouter ? Dans ce cas, une religion peut être une bonne compagne. Le religieux est au service de l’homme, pas l’inverse. Si une religion détruit ce que l’histoire, les sciences, les arts, le droit et l’expérience éthique et sociale ont apporté aux hommes, pourquoi y rester ? Les deux émotions de base du sentiment religieux, à savoir l’émerveillement devant la vie d’une part, la peur de la mort et du mal d’autre part, une fois distillés dans le langage et la pratique, peuvent accompagner le travail de ciment social et de parole culturelle que l’athéisme n’apportera pas : ou peut-être par le triomphe peu enthousiasmant d’une société robotisée et purement technique ? Wall E, quoi !  Ou par un prométhéisme éperdu qui se terminera par un Sysiphe épuisé et imposé à tous ? Ou encore par la juxtaposition d’individus dépressifs et revendicatifs pour l’éternité ? La solution « nous avons toute la vie pour nous amuser, toute la mort pour nous reposer », ou celle de la jouissance totale jusqu’à la mort sont-elles si jouissives ? Je ne sais pas. Peut-être est-ce que je me trompe ? La question est ouverte à jamais. Aujourd’hui toutefois, l’athéisme ne me tente plus beaucoup.
Ou par un prométhéisme éperdu qui se terminera par un Sysiphe épuisé et imposé à tous ? Ou encore par la juxtaposition d’individus dépressifs et revendicatifs pour l’éternité ? La solution « nous avons toute la vie pour nous amuser, toute la mort pour nous reposer », ou celle de la jouissance totale jusqu’à la mort sont-elles si jouissives ? Je ne sais pas. Peut-être est-ce que je me trompe ? La question est ouverte à jamais. Aujourd’hui toutefois, l’athéisme ne me tente plus beaucoup.
Il reste l’agnosticisme. Pourquoi pas là non plus ? L’agnosticisme semble proposer la meilleure méthode pour progresser dans la sagesse et la connaissance. Face à certaines questions existentielles, celui qui affirme qu’il ne sait pas paraîtra plus sage que ceux qui débitent des réponses toutes faites, issues de leur doctrine religieuse ou de leur idéologie (une fois passée l’illumination de ce qui rassure). Certains dressent un parallèle entre certaines mystiques de la nuit et la démarche agnostique. Oui, peut-être. Pourquoi pas ? À titre personnel, je suis trop « gnostique » pour être agnostique (et réciproquement). J’admire les chercheurs de vérité, de sens, voire même parfois les penseurs qui se risquent dans des systèmes rationnels ou symboliques (je préfère Hegel à Kant). J’aime les compositeurs de symphonies autant que les moines dans leur silence contemplatif. L’agnosticisme, tout-à-fait louable a posteriori, m’apparaît comme une attitude paresseuse, celle de celui qui se repose et ne veut plus se remettre en marche. La paresse de celui qui est fatigué et qui a du mal à se réveiller le matin, après des journées difficiles ou des nuits de cauchemar. Cela dit, une méthode, sans doute ? Oui, l’agnosticisme est préférable pour la démarche scientifique ou pour la gouvernance politique. Face à un scientifique agnostique ou un scientifique religieux, je choisirai de préférence être ami avec l’agnostique. Mais l’agnosticisme comme finalité ? Bof.
J’aime les compositeurs de symphonies autant que les moines dans leur silence contemplatif. L’agnosticisme, tout-à-fait louable a posteriori, m’apparaît comme une attitude paresseuse, celle de celui qui se repose et ne veut plus se remettre en marche. La paresse de celui qui est fatigué et qui a du mal à se réveiller le matin, après des journées difficiles ou des nuits de cauchemar. Cela dit, une méthode, sans doute ? Oui, l’agnosticisme est préférable pour la démarche scientifique ou pour la gouvernance politique. Face à un scientifique agnostique ou un scientifique religieux, je choisirai de préférence être ami avec l’agnostique. Mais l’agnosticisme comme finalité ? Bof.
*
Une infinité de tourbillons dans une multitude de flux.
 À partir de là, je voudrais, sans développer, revenir sur les îles isolées au milieu des flots turbulents ou sur les plateaux entourés d’abîmes que j’ai évoqués au début de cet article. Analogie au choix du lecteur. J’essaie de me pencher sur les précipices, en dépit des vertiges, dans l’espoir de trouver quelque aile pour m’envoler, la nuit, après les combats. Je voudrais, en dépit de légitimes craintes, m’embarquer sur quelque esquif suffisamment solide pour voguer, mais suffisamment ouvert pour accepter d’être éclaboussé, voire mouillé dans l’orage. Pour cela, je vais m’aventurer dans les trois infinis évoqués par Pierre Teilhard de Chardin qui complètent les deux infinis de Pascal, tout en navigant entre les quatre humiliations que l’homme (occidental surtout) a subi depuis cinq siècles, dont parle Edgar Morin pour compléter les trois humiliations vues par Freud. J’ajouterai volontiers une cinquième-.
À partir de là, je voudrais, sans développer, revenir sur les îles isolées au milieu des flots turbulents ou sur les plateaux entourés d’abîmes que j’ai évoqués au début de cet article. Analogie au choix du lecteur. J’essaie de me pencher sur les précipices, en dépit des vertiges, dans l’espoir de trouver quelque aile pour m’envoler, la nuit, après les combats. Je voudrais, en dépit de légitimes craintes, m’embarquer sur quelque esquif suffisamment solide pour voguer, mais suffisamment ouvert pour accepter d’être éclaboussé, voire mouillé dans l’orage. Pour cela, je vais m’aventurer dans les trois infinis évoqués par Pierre Teilhard de Chardin qui complètent les deux infinis de Pascal, tout en navigant entre les quatre humiliations que l’homme (occidental surtout) a subi depuis cinq siècles, dont parle Edgar Morin pour compléter les trois humiliations vues par Freud. J’ajouterai volontiers une cinquième-.
Je devine que des lecteurs doivent ouvrir leurs yeux. Les trois humiliations de Freud sont les suivantes : la première humiliation est celle de Copernic et de Galilée révélant aux hommes que la Terre n’est pas au centre de l’Univers ; la seconde humiliation est celle de la découverte de l’évolution naturelle depuis la matière jusqu’à l’humanité, avec Darwin bien sûr comme verrou ; la troisième humiliation est celle que Freud s’attribue, à savoir la puissance de l’inconscient sur nos représentations, nos expressions, nos mots. Edgar Morin en ajoute une quatrième, à la fois plus sociologique et plus épistémologique : le contenu et la forme de nos discours est dépendante de nos paradigmes cachés et de logiques de pensée incomplets. Je suis très sensible à cette quatrième humiliation. J’y ajoute une cinquième humiliation, écologique celle-là : l’homme s’est cru, par son esprit, capable d’indépendance vis à vis de la matière et de la vie qui l’environne, et capable de les transformer à l’infini. Descartes est sur le grill (ou du moins les cartésiens, car Descartes est plus fin que nombre de ses disciples). Pas de chance en effet, la violence des humains contre la nature se retourne contre eux.
 Les trois infinis de Teilhard sont les suivants : l’infiniment grand dans l’espace cosmique que l’on peut conjuguer avec la première humiliation ; l’infiniment petit qui révèle les mécanismes de nos structures, qui s’enfuit dans l’explosion de nos catégories macroscopiques et qui réapparaît au plan macroscopique dans notre relation à notre environnement ; l’infiniment complexe, celui qui se développe avec la durée, plus prometteur de sens, mais plus dangereux aussi. Pascal a écrit sur les deux premiers infinis. Il n’a pas perçu le troisième. À propos du premier infini,nombre d’écrivains font référence au célèbre mot de Pascal, dans ses Pensées, pour justifier leur athéisme ou leur agnosticisme : « le silence éternel des espaces infinis m’effraie ». Ils omettent le fait que Pascal place ces mots dans la bouche d’un pyrrhonien (un athée de l’époque si l’on veut). Lui, au contraire, s’étonne de cet infini, de ces infinis et s’émerveille que les hommes soient capables de le penser, et peut-être de l’explorer. Il reste religieux.
Les trois infinis de Teilhard sont les suivants : l’infiniment grand dans l’espace cosmique que l’on peut conjuguer avec la première humiliation ; l’infiniment petit qui révèle les mécanismes de nos structures, qui s’enfuit dans l’explosion de nos catégories macroscopiques et qui réapparaît au plan macroscopique dans notre relation à notre environnement ; l’infiniment complexe, celui qui se développe avec la durée, plus prometteur de sens, mais plus dangereux aussi. Pascal a écrit sur les deux premiers infinis. Il n’a pas perçu le troisième. À propos du premier infini,nombre d’écrivains font référence au célèbre mot de Pascal, dans ses Pensées, pour justifier leur athéisme ou leur agnosticisme : « le silence éternel des espaces infinis m’effraie ». Ils omettent le fait que Pascal place ces mots dans la bouche d’un pyrrhonien (un athée de l’époque si l’on veut). Lui, au contraire, s’étonne de cet infini, de ces infinis et s’émerveille que les hommes soient capables de le penser, et peut-être de l’explorer. Il reste religieux.
Développer tous ces points dans leur interface avec la théologie chrétienne, et plus spécifiquement la théologie catholique, demanderait des volumes entiers. Beaucoup de pages ont été écrites sur mes différents blogs, dans le cadre de la thèse inachevée, dans quelques cours et conférences que j’ai pu donner, et dans divers articles et carnets personnels sur ces thèmes. Difficile d’écrire une synthèse. Elles touchent la Christologie, l’anthropologie chrétienne, nombre de points de la doctrine trinitaire et de la sotériologie (théologie du salut)… et je n’y ai pas trouvé de réponse satisfaisante, et surtout pas de solution. Mais est-ce nécessaire si l’on veut continuer à progresser ?
*
Commençons avec le premier infini, l’infiniment grand. Le Christianisme est né en monde juif et grec. Lorsque les credos et les grandes théologies sont apparues, les visions de l’Univers étaient nombreuses. Mais globalement elles étaient centrées sur l’humain. Puis certaines ont prévalu. Le Cosmos grec de Ptolémée et d’Aristote par exemple, qui est devenu jusqu’au Dix-Septième Siècle le modèle standard des cosmologistes et de l’Église Catholique, en gros jusqu’à Copernic, puis surtout Galilée, plaçait la Terre au centre. Tout l’univers tournait autour de la Terre et des hommes. Plus encore, il discriminait deux régions : l’une céleste, parfaite, lieu d’activité des anges et du divin, et l’autre terrestre, en deçà de l’orbite lunaire, lieu de la corruption. Pour n’importe qui, il suffisait de lever les yeux pour voir le ciel et le monde divin. La divinité allait de soi. Rares étaient les penseurs qui osaient imaginer un univers infiniment plus vaste : Nicolas de Cues par exemple ou Giordano Bruno qui l’a payé sur un bûcher de l’Inquisition.
 Copernic, Képler, Tycho Brahé, Galilée ont fait exploser cette vision, et le ciel angélique et divin a disparu des yeux. L’ancien Cosmos s’est élargi au point qu’aujourd’hui les astrophysiciens découvrent que la Planète Terre n’est qu’un tout petit astre, minuscule, égaré dans la banlieue d’une étoile quelconque appelée Soleil, lui-même dans la périphérie d’une galaxie de 300 milliards d’étoiles (30 fois la population humaine actuelle)… Quant à notre galaxie, la Voie Lactée; elle n’est qu’une représentante parmi les deux mille milliards (2000.000.000.000) d’autres galaxies dans l’Univers. Et les galaxies sont loin d’être les seuls objets et structures célestes… De plus, l’Univers est moins un Cosmos paisible, garant de l’ordre divin, comme l’imaginaient les anciens. Il est un « chaosmos », selon l’expression d’Edgar Morin, un chaos turbulent et énergétique au sein duquel émergent quelques systèmes plus solides ou plus structurés. Nous sommes passés du monde clos à l’univers infini, de la force tranquille à l’énergie déchaînée. L’humanité apparaît insignifiante, n’en déplaise à Pascal qui admirait le fait que nous puissions connaître l’Univers, ou à Newton qui voyait dans les lois de l’univers qu’il avait découvertes le « sensorium dei », la présence divine. Il n’y a plus de Dieu dans l’univers, du moins accessible directement par les yeux, par les sens ou par l’expérimentation scientifique : admettons-le une bonne fois pour toutes, et déplaçons le regard. Il n’y a pas de ciel et de terre. Partout dans l’univers, il y a la même matière et la même énergie, et peut-être les mêmes structures de vie (chimie organique à base de carbone ou de silicium), voire plus ou autre (indépendamment de toute science fiction).
Copernic, Képler, Tycho Brahé, Galilée ont fait exploser cette vision, et le ciel angélique et divin a disparu des yeux. L’ancien Cosmos s’est élargi au point qu’aujourd’hui les astrophysiciens découvrent que la Planète Terre n’est qu’un tout petit astre, minuscule, égaré dans la banlieue d’une étoile quelconque appelée Soleil, lui-même dans la périphérie d’une galaxie de 300 milliards d’étoiles (30 fois la population humaine actuelle)… Quant à notre galaxie, la Voie Lactée; elle n’est qu’une représentante parmi les deux mille milliards (2000.000.000.000) d’autres galaxies dans l’Univers. Et les galaxies sont loin d’être les seuls objets et structures célestes… De plus, l’Univers est moins un Cosmos paisible, garant de l’ordre divin, comme l’imaginaient les anciens. Il est un « chaosmos », selon l’expression d’Edgar Morin, un chaos turbulent et énergétique au sein duquel émergent quelques systèmes plus solides ou plus structurés. Nous sommes passés du monde clos à l’univers infini, de la force tranquille à l’énergie déchaînée. L’humanité apparaît insignifiante, n’en déplaise à Pascal qui admirait le fait que nous puissions connaître l’Univers, ou à Newton qui voyait dans les lois de l’univers qu’il avait découvertes le « sensorium dei », la présence divine. Il n’y a plus de Dieu dans l’univers, du moins accessible directement par les yeux, par les sens ou par l’expérimentation scientifique : admettons-le une bonne fois pour toutes, et déplaçons le regard. Il n’y a pas de ciel et de terre. Partout dans l’univers, il y a la même matière et la même énergie, et peut-être les mêmes structures de vie (chimie organique à base de carbone ou de silicium), voire plus ou autre (indépendamment de toute science fiction).
Régulièrement, des pseudo-théologiens essaient de retrouver Dieu directement dans le cosmos-chaosmos : par exemple certains confondent le Big Bang avec les premiers versets de la Genèse, comme si la Bible était un ouvrage d’astrophysique. Illusion. D’autres cherchent directement encore un « Intelligent Design », une direction privilégiée induite par l’action divine, dans le prolongement de l’intuition de Newton chrétien ou d’un Teilhard de Chardin qu’ils ont mal lu. Ils auront beau chercher, ils ne trouveront rien d’autre que de l’énergie et de la matière qui laissent ici et là apparaître des évolutions locales. À titre personnel, même si je n’adhère pas aux thèses de ces hurluberlus, je suis quand même sensible à la turbulence cosmique au sein de laquelle s’organisent, sous un risque permanent de destruction ou de volatilisation, des structures plus complexes et plus performantes. J’en parle plus bas : là, il y a une piste intéressante pour une pensée religieuse et théologique renouvelée, même si elle ne prouve rien a priori. Rien n’est sûr, tout est contingent. « Pourvu que ce monde tienne, s’écrie Elohim », dit un midrash juif à propos de ce chaos d’où surgit un monde soumis au risque et à la liberté. Mais nous sommes très éloignés du cosmos grec ou de l’univers de Ptolémée.
« Dieu sait » aussi ce qu’il est possible d’inférer par delà le Big Bang et les fluctuations quantiques, comme certains cosmologistes ont tenté de le faire (Stephen Hawking par exemple), même s’il est impossible de concevoir des expérimentations physiques des potentialités proposées par ces cosmologistes parfois un peu farfelus. « L’Intelligent Design » et a fortiori tous les créationnismes se heurteront aux mêmes problèmes. Or régulièrement, on voit apparaître des penseurs religieux attirés par l’idée qu’il y a des trous dans les explications : dans ces trous, ils essaient d’y placer du divin. Je pense à Jean Guitton ou aux Frères Bodganov par exemple, mais ils ne sont pas les seuls, notamment aux États-Unis. Fausse piste là encore. Les trous seront bouchés tôt ou tard par les sciences. La métaphysique et la théologie naturelle ne sont pas dans les trous de l’univers ou de la science, mais reposent dans le fait qu’un monde existe. La bonne question a été posée par Leibniz : « pourquoi y a-t-il un monde plutôt que rien ? », à laquelle il peut être ajouter : pourquoi sommes-nous capables de le penser ? Pourquoi a-t-il pris cette forme et pas une autre ? Trois questions de base. Une théologie catholique, voire chrétienne, centrée sur le salut des âmes paraît bien pâlotte devant ces questions. Petite île au milieu de l’océan.
Autre chose à l’échelle de l’Univers. Quand je posais la question de la possibilité d’autres univers habités à un théologien, sa réponse fut : « Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! »… et à un autre : « c’est impossible car le Christ est venu sur la Terre ». Faudra-t-il qu’arrive quelque signal intelligent dans un Univers aux dimensions vertigineuses et porteuses de vie, pour que les théologies christocentriques et anthropocentriques changent leur perspective ? Que peuvent bien signifier la passion, la mort et la résurrection d’un rabbin de Palestine d’il y a 2000 ans dans ce contexte ? Qu’apporteront le télescope James Webb et tous les scrutateurs du Cosmos quand ils sonderont les biosphères des Planètes ? J’ai commencé un roman sur ce thème il y a une quinzaine d’années, mais la réalité scientifique va plus vite que l’imagination. Il est inachevé et je ne sais pas si je le reprendrai.
À travers ces questions qui sont loin d’être les seules posées par la mise en évidence du premier infini, ce sont les christologies historiques obnubilées par le Salut, la théologie de la Création et celle de l’homme à l’image de Dieu, qui sont ébranlées. Un grand coup de balai serait nécessaire pour les repenser sérieusement. Mais là, le paradigme catho risque de s’effondrer… et je ne le défendrais pas. Je ne suis pas catho. Et pourtant je suis fasciné par ce chaosmos : si j’avais eu une seconde ou troisième vie, j’aurais rêvé de travailler dans un de ces centres spatiaux où les scientifiques contemplent la beauté à la fois merveilleuse et tragique de l’Univers dans lequel chacun d’entre nous est tombé. Quant à la théologie, chrétienne ou juive, il est temps qu’elle relativise sa polarisation sur l’histoire et sur le salut des humains.
*
Le second infini, celui de l’infiniment petit et de notre structure physique et biologique, présente aussi bien des questions : l’être merveilleux que nous sommes reste complètement dépendant de ses éléments physiques, des échanges énergétiques et des multiples niveaux d’information génétiques et sociaux. On ne peut arracher l’individu à ces conditionnements, même à travers les plus beaux miracles et les plus belles interventions divines ou à travers l’idée, obsolète, d’une survie de l’âme. Là encore, il faudrait penser autrement. Que peut bien signifier la proposition selon laquelle l’homme est à l’image de Dieu, si on en reste à des anthropologies obsolètes ? Comment penser une « résurrection de la chair » dans un sens primaire ? Comment continuer à proclamer je ne sais quelle « transubstantiation » dans un morceau de pain composé d’atomes, de molécules et de cellules organiques ? Bon je sais, bien des théologiens et des religieux vont m’objecter que je suis bien terre à terre ! Mais oui.
Du reste, dans les Évangiles et les lettres de Paul, il n’est pas écrit que le pain est le corps du Christ, mais que Jésus partagea le pain et distribua la coupe de vin en disant « voici mon corps et mon sang » : le partage est premier et signe du corps et du sang (en dimension organique), pas ce bavardage substantialiste qui conduit à des attitudes de superstition et de magie. Qu’ensuite l’Évangile de Jean ait interprété le récit dans un sens plus cru (« Je suis le pain vivant », dit le Christ Jésus) ne signifie nullement qu’il s’agit d’une substance transformée. Tiens bizarrement, on retrouve le mot Vie ! La théologie eucharistique axée sur la chose transformée m’apparaît relever d’un autre âge et d’une autre paradigmatique. J’y suis très peu sensible. C’est vrai de l’ensemble de la théologie des sacrements telle qu’elle est transmise. Parfois même l’attitude de certains spirituels sur ce plan m’inquiète. J’ai le souvenir d’une accompagnatrice très dévouée m’expliquant que son accompagnement spirituel devait emmener l’accompagné vers les sacrements de l’Église Catholique. Belle liberté que ce bien curieux accompagnement ! Eh non, je ne suis pas catho.
Ceci est-il éloigné du second infini ? Non. L’humain est un corps. Il n’a pas un corps. Cette seconde perspective, « j’ai un corps », est une construction mentale qui a eu sa nécessité pour s’affranchir affectivement et intellectuellement des conditionnements violents de la nature. Notamment de la sexualité : l’organisation ecclésiale tout autant que sa doctrine cache le paradigme de l’opposition entre le corps et l’âme, de la distinction entre substance et accident (la réalité corporelle n’étant qu’un accident de nature ou une chute de l’âme dans un corps méprisable et corrompu). Elle n’est plus acceptable aujourd’hui. Nous sommes un corps. Il n’y a pas d’âme indépendante : Aristote avait raison contre Platon et les néo-platoniciens. La femme et l’homme sont structurés par leur constitution physique, chimique, biologique, cérébrale et par l’histoire, par la biogenèse et la noogenèse, par leur condition géographique et sociale. Teilhard de Chardin parle de la « puissance spirituelle de la matière » : il a raison. Eh oh ! N’est-ce pas simplement le discours de la Genèse ? Le corps est en interaction avec son environnement naturel, et son existence est impensable sans lui.

Photo prise dans le désert d’Uyuni (Bolivie)
Il semblerait qu’aujourd’hui, il y a une petite évolution prometteuse dans la pensée catholique, d’après les derniers documents officiels. Ce n’est pas encore gagné.
Bref, les « spiritualistes » (ou plutôt « animistes » déguisés) m’ennuient et parfois m’inquiètent. Sur le Camino de Compostelle, j’ai croisé plusieurs marcheurs et marcheuses m’affirmant qu’ils cheminent dans un esprit « spirituel ». Quand je demande ce qu’ils mettent sous le mot « esprit », j’ai souvent envie de rire ou de pleurer. L’esprit, c’est le contraire de la matière ! Le monde visible et actuel n’est qu’une illusion ! Tout n’est qu’impermanence ! Mon âme, par la méditation transcendantale, la prière ou autre pratique ascétique peut s’échapper de la vallée de larmes ! Tout cela n’est que passager, l’au-delà fera passer l’ici et le maintenant ! Ben voyons. Ne vous inquiétez pas, chers amis, ai-je songé : votre corps, votre finitude, la souffrance, la douleur vous rattraperont… La maladie et la mort vous arriveront ! Le corps rappellera sa consistance physique, chimique, biologique et concrète. La réalité physique, chimique, biologique et physiologique s’imposeront. De plus, le fantôme de Job ne vous échappera pas.
La réponse à ces fuites ? Le second infini nous invite à penser selon l’angle des interactions et des échanges. À l’échelle de la conscience et de la vie sociale, elle peut être pertinente dans le témoignage de la vie et de la parole, celui de l’interaction avec le réel présent et concret et l’expérience de l’altérité, celui de l’industrie humaine et de son activité dans cet univers-là (et non au-delà), celui qui déborde les vicissitudes, les petites convictions faciles et rassurantes et les fuites dans la gélatine « spirituelle ». L’Esprit n’est pas là où on l’imagine : il n’est pas je ne sais quelle substance cachée dans le cerveau. Cherchons-le dans l’histoire, dans la matière, dans l’univers, dans le corps, qui est, qui sont « Temple de l’Esprit »… Cherchons-le aussi dans les aspects concrets et réels de la confiance et de l’espérance qui oblige à se décentrer (de l’univers certes, mais aussi de son essence, de son ego ou de son institution confortable) : n’est-ce pas le mouvement naturel de notre progression dans la connaissance du monde, du mystère du sujet et de la rencontre, et de notre humanité qui se resserre sur sa Planète-Village de plus en plus chaude ? De ceux-ci, nous ne possédons qu’une face, et rien n’est jamais gagné.

Une face-profil de Picasso
Cherchons aussi l’Esprit dans l’amitié et un véritable amour (pas celui, mièvre et mielleux, voire racoleur et inquiétant, de nombre de prêcheurs de nos églises), dans les combats pour la justice, la dignité et la créativité de la vie, dans les mille formes de l’aventure humaine et cosmique, cherchons-la dans la conjugaison entre universalité et singularité. Non dans un savoir centré sur soi et ses certitudes, mais à travers regard dérangé en permanence par le réel. Aujourd’hui, j’estime qu’avec le témoignage biblique, ce n’est pas seulement le Verbe qui s’est incarné, mais aussi l’Esprit. Le Pèlerin Russe explique que la prière authentique descend dans le corps, la respiration, les battements du cœur et la marche sur le sol solide.
Sur ces questions, j’ai émis et rédigé bien des idées et des axes de réflexion, mais elles sortent du cadre de la doctrine catholique et parfois même des différentes théologies chrétiennes les plus en vue (ou les plus puissantes, cléricalement et historiquement parlant). Mes idées demandent simplement de « provincialiser », et parfois de redéfinir ou de renoncer à nombre de points de doctrine qui sont considérées comme absolues. L’image de Dieu, du divin dans l’ensemble, a besoin d’être sérieusement dépoussiérée. Paradoxalement, je dois une fois de plus l’avouer, c’est dans la Bible (et pas forcément dans le Second Testament) que j’ai perçu des passerelles ou me munir d’ailes possibles pour franchir quelques abîmes, ou des barques pour naviguer au milieu de l’agitation des vagues. Je les ai aussi perçues telles des phosphorescences dans les multiples herméneutiques rabbiniques, patristiques, philosophiques, musicales et scientifiques… ce qui signifie qu’il me faut m’arracher au diktat des confessions de foi devenues normes. Il est un mystère biblique qui n’a pas livré tous ces secrets : c’est celui de l’Alliance… écho signifiant du mystère des relations tous azimuts.
Je ne vais pas m’étendre sur ces questions. Elles sont trop vastes à l’échelle de cet article qui s’interrogeait sur « pourquoi je ne suis pas catho ».
*
Quant au troisième infini, celui du temps et de la complexité croissante, touché lui aussi par les humiliations de Freud et de Morin, il mérite également attention.
Arrêtons-nous pour commencer sur ce point, en nous tournant vers le passé. Que peut bien signifier un salut individuel pour des individus descendants d’un primate ? À partir de quel moment l’humain peut-il être considéré comme un partenaire ou un participant à la vie divine ? Et les animaux, là-dedans ? Et les chimpanzés, les gorilles, les chiens et les tigres ? Où se situe la rupture nécessaire, dans le cadre d’une théologie qui réduit à la seule humanité le « salut » ? Cette rupture existe-t-elle à ce point ? Bien des réponses ont été tentées dans l’histoire théologique. La plupart du temps, elles manquent cruellement de charité et de solidarité, parfois elles excèdent au contraire par leur sottise : il y a toujours des exclus. Et elles ne répondent pas à la souffrance, à l’absurdité, à la mort. Le pire, c’est que les évangiles, les lettres de Paul et des autres disciples, et la patristique parfois, offrent pourtant des pistes prometteuses pour s’arracher aux catastrophiques anthropologies prétendument spirituelles et certainement très individualistes qui font le bonheur de nos prêcheurs, et le fond de commerce de nombreux moralisateurs cathos et non cathos. Bref, est-ce que la grand-mère de Lucy est sauvée par le Christ ? Ou d’un point de vue ontogénétique : est-ce que tel enfant né handicapé mental profond et inguérissable est sauvé ? Et comment ? Eh oui, ce sont des vraies questions et elles réfléchissent dans ma conscience l’océan turbulent ou les abîmes.
L’infini du passé et l’infini du futur, les deux polarités extrêmes, se heurtent à la question du temps. Mais au fait, qu’est-ce que le temps, s’interrogeait Saint-Augustin, avec des arguments qui ont vieilli. On sait depuis la relativité restreinte que la simultanéité n’existe pas et que la mesure du temps dépend du mouvement du référentiel. Alors bien sûr, à l’échelle de l’histoire du vivant, on peut estimer que la question relativiste est infime : grave erreur. La question du temps, de sa mesure, de sa perception et la question du mouvement, se densifient et se multiplient avec l’évolution de la vie vers des formes de plus en plus complexes, de plus en plus conscientes et surtout de plus en plus subjectives. De plus, le temps que les sciences formelles (ou calquées sur elles) et les philosophies essentialistes voudraient éliminer, surgit avec intensité dès qu’on se penche sur l’aventure de la vie et de la conscience.
 Tout système fermé ou proche de l’équilibre stable se dégrade. Théorème bien prouvé de la thermodynamique classique. La physique moderne a démontré que la véritable différence ne se situe pas entre la stabilité et le mouvement, ou entre repos et mouvement comme indiqué au début de cet écrit, mais entre mouvement et changement de mouvement. Il n’existe rien de stable dans la nature et les systèmes ou structures apparemment stables ne le sont qu’en raison de flux d’énergies qui le maintiennent dans cet état d’apparent repos : le tourbillon dans la nature turbulente. Héraclite avait raison : « tout est flux ». Un système stable n’est possible qu’avec des échanges d’énergie et d’information avec son milieu… et il ne le reste jamais éternellement. En revanche, la vraie bifurcation s’effectue entre mouvement et changement de mouvement, ou entre transformation et changement de transformation. Les vraies nouveautés ne sont pas dans le mouvement, dans les potentialités d’une structure en évolution, mais dans la rupture de ce mouvement, dans le surgissement de la nouveauté.
Tout système fermé ou proche de l’équilibre stable se dégrade. Théorème bien prouvé de la thermodynamique classique. La physique moderne a démontré que la véritable différence ne se situe pas entre la stabilité et le mouvement, ou entre repos et mouvement comme indiqué au début de cet écrit, mais entre mouvement et changement de mouvement. Il n’existe rien de stable dans la nature et les systèmes ou structures apparemment stables ne le sont qu’en raison de flux d’énergies qui le maintiennent dans cet état d’apparent repos : le tourbillon dans la nature turbulente. Héraclite avait raison : « tout est flux ». Un système stable n’est possible qu’avec des échanges d’énergie et d’information avec son milieu… et il ne le reste jamais éternellement. En revanche, la vraie bifurcation s’effectue entre mouvement et changement de mouvement, ou entre transformation et changement de transformation. Les vraies nouveautés ne sont pas dans le mouvement, dans les potentialités d’une structure en évolution, mais dans la rupture de ce mouvement, dans le surgissement de la nouveauté.
La nouveauté, qualités, potentialités nouvelles et complexité croissante, apparaît dans les lieux turbulents à fort échange énergétique ou sous l’action d’une cause imprévisible. Un engin spatial envoyé depuis la Terre continuera indéfiniment son mouvement, sauf si brutalement un objet céleste le heurte ou une interaction quelconque l’entraîne. A fortiori, dans les systèmes turbulents à haute énergie, les états apparemment stables et les mouvements linéaires sont sans cesse brisés par les autres systèmes en mouvement. Et là seulement, peuvent apparaître sans nécessité des qualités nouvelles, des structures plus développées, plus riches en capacités. La durée impose statistiquement la nécessité. C’est le cas au cœur des étoiles chaudes où surgissent des atomes ; celui des flux turbulents, mais aussi des systèmes biologiques (toujours instables à long terme)où apparaissent des tourbillons, des mutations des espèces vivantes et des écosystèmes riches. Sans nécessité, je le rappelle. Il en est de même des agitations d’idées et des créativités diverses dans la Noosphère, dans la sphère humaine, dans son histoire et dans sa conscience. Les épistémologues relèvent souvent cette dualité du temps et la puissance de la durée, au sens de Bergson ou de Whitehead : celle qui dégrade et celle qui crée. Un système fermé se dégrade toujours. Seul un système ouvert peut, sans nécessité oui oui, engendrer des sauts qualitatifs. Il faut de la durée, de la très longue durée : la vie n’a pu apparaître qu’après des milliards d’années, et la conscience sur la Terre, chez la femme et l’homme, n’a pu survenir qu’après d’autres milliards d’années supplémentaires. Sans certitude, rappelons-le. Or la durée et l’événement fortuit qui créent du nouveau sont difficilement accessibles par une méthodologie scientifique ou une pensée universaliste. Il y a l’imprévisible, voire le hasard, la rencontre aléatoire de processus indépendants.
Le hasard ! J’ai enseigné plusieurs années sur ce thème. Chaque existence est le produit de trois déterminismes ou de trois enchaînements, si l’on préfère : le déterminisme social et phylétique, celui qui fait de nous des hommes et des femmes, dans tel milieu, à tel moment de l’histoire, dans telle condition sociale, etc. ; le déterminisme ontogénétique, celui qui fait ce que nous sommes génétiquement, au plan de notre caractère, de notre constitution physique, de notre genre, etc. ; et troisièmement, on l’oublie souvent : les événements aléatoires. J’existe grâce à un sourire d’un soir, d’un spermatozoïde plus chanceux que les 300 millions d’autres, grâce à cette bombe qui a heureusement explosé à côté de mon grand-père dans les tranchées de la Première Guerre Mondiale… et qui en a fracassé d’autres. L’homo sapiens (et demens) existe grâce à telle mutation produite on ne sait où, ni comment, ni quand. L’espèce humaine s’est détachée du phylum préhominien par on ne sait quel conditionnement géologique ou biologique. Les mammifères prolifèrent grâce à une météorite qui s’est abattue dans le Golfe du Mexique et qui a fait disparaître les dinosaures, etc. L’aléatoire est partout, le hasard est partout. L’existence de toutes choses est contingente. Seule une vision globale et statistique peut voir a posteriori que la vie a réussi, au sein de myriades de pièges. A posteriori, j’insiste…
Alors que penser de ces discours religieux ou spiritualistes qui parlent de « destin », de Providence, de prédestination, de place prévue d’avance dans le ciel ou dans le sein d’Abraham ? Ou alors faut-il adhérer à une sorte de système réactualisé de Leibniz qui a imaginé un espèce de Dieu programmateur mathématicien (informaticien dirait-on aujourd’hui) qui a tout calculé d’avance dans son infinité ? Pour être honnête, j’ai mes idées sur la question, mais je ne les développe pas ici parce qu’elles ne sont pas très orthodoxes. Non, je ne suis pas catho. Je ne suis pas non plus naïvement déiste à la sauce leibnizienne. Je note seulement une piste : ce qui est remarquable dans l’aventure de la vie, c’est sa capacité non seulement de faire naître des êtres plus performants dans un contexte aléatoire, mais plus encore de se servir de ce hasard de l’intérieur d’elle-même pour muter et se développer. Même si cela ne se voit apparemment qu’à grande échelle. Je n’insiste pas, j’en parle ailleurs.
Là bien sûr, volent en éclats toutes les mythologies et théologies qui évoquent une manipulation divine, une prédestination des individus au pire ou une « Providence » au mieux. J’ai parlé de la contingence de chaque existence. Mais inférons dans d’autres domaines, plus proches de notre expérience : où est la Providence quand un enfant est gazé dans un camp d’extermination, quand un tsunami emporte des vacanciers tranquilles sur une plage d’Indonésie, quand quelqu’un naît dans une banlieue pauvre, au milieu de drogués, d’alcooliques ou de violeurs, quand une jeune fille voit de loin sa famille se volatiliser dans l’explosion d’une bombe atomique à Hiroshima, etc ? Oui, je me répète : mais cette ombre plane, quelles que soient nos envolées lyriques ou spéculatives.
Une de mes convictions, je le redis, en temps que réponse j’entends (pas en tant que solution), ou comme le chemin (Camino) qui repart, se situe dans le mystère de l’alliance telle que l’entrevoient de nombreux textes bibliques : tout peut être saisi dans la dynamique de l’alliance (voir un des articles de mon blog sur ce que j’appelle « l’alliance différentielle »). Elle se situe aussi dans ce que j’appelle le tourbillon trinitaire, surtout à travers les multiples dynamismes reliant parole et esprit, d’un point de vue chrétien. Petit rappel : pas de récupération rationnelle dans ce que j’écris. Chaque affirmation doit être précédée par un décentrement, par la conviction que le savoir n’accède qu’à une face visible… et que l’autre, cachée, relève de la confiance qu’induit le mystère de l’alliance. Plus fondamentalement, s’il faut réconcilier une théologie de la création, de la nature, avec une théologie du salut, il faut la penser dans le cadre d’une transformation de tout l’univers créé… et non dans la fuite de petites âmes dans un au-delà.
L’idée d’un Dieu immuable dans son ciel, vieux thème grec, ne me semble pas sérieuse. Encore moins ces ridicules imageries le représentant assis sur un nuage, comme un vieillard qui s’ennuie. Pour ces raisons entre autres, je médite sur la dynamique trinitaire qui est un vortex de vie, d’échange et de communication…. voire de création. Souvent, je songe que ce n’est pas moi qui « expérimente » le divin, mais c’est Dieu, Adonaï, Elohim, son Esprit, sa Parole, qui s’expérimentent dans leur tourbillon éternel à travers ce que je vis, à travers ce que les femmes et les hommes vivent, à travers ce que l’univers entier et toutes les créations existantes et potentielles vivent. Prenons le mot « vie » au sérieux. Quelques inversions sont nécessaires à réaliser dans les paradigmes inconscients des religions et des théologies, dans les scléroses doctrinales. Mais je préfère ne pas développer et renvoyer aux méditations de mon blog… et je n’aurais peut-être jamais le loisir, vu mon âge, de les circonscrire et de les achever. Il faut sans cesse reprendre la marche pour éviter que le repos ne devienne une mort.
Eh oui, cela n’est pas très orthodoxe, ni très catholique. Non, je ne suis pas catho.
*
Pour terminer, il y a un point que je dois à la fois à l’orthodoxie chrétienne et à l’espace biblique et judaïque, surtout depuis que j’écris mes investigations sur le tourbillon trinitaire. C’est la priorité apportée aux personnes, aux relations interpersonnelles et au triple jeu parole-réponse-silence, sur celle, philosophique  j’entends, de la nature et de l’essence des choses. Le visage a plus de poids métaphysique et théologique que les atomes et les étoiles. Les mots échangés dans l’amitié et l’amour sont plus performants que les débats d’idées. Le monde impersonnel et les images ou idées qu’on peut en inférer ont aussi leur valeur, je ne le conteste pas, mais ils sont seconds par rapport au mystère des personnes, de leur singularité, de leur interdépendance et de leur interaction dynamique. La méditation trinitaire est très féconde sous cet angle, même si j’avoue que ce que j’en médite est distant de ce qu’en écrit la Patristique et de ce que racontent les credos des églises. En mettant l’accent sur la diversification, la singularité des visages (des personnes) face à l’universalité des éléments de la nature ou des essences générales, devant l’infinie créativité et variété des relations et de la communication, le grand tourbillon divin me tourne résolument vers l’avenir, vers l’inconnu et l’imprévisible, là où la réalité se complexifie et se réalise concrètement.
j’entends, de la nature et de l’essence des choses. Le visage a plus de poids métaphysique et théologique que les atomes et les étoiles. Les mots échangés dans l’amitié et l’amour sont plus performants que les débats d’idées. Le monde impersonnel et les images ou idées qu’on peut en inférer ont aussi leur valeur, je ne le conteste pas, mais ils sont seconds par rapport au mystère des personnes, de leur singularité, de leur interdépendance et de leur interaction dynamique. La méditation trinitaire est très féconde sous cet angle, même si j’avoue que ce que j’en médite est distant de ce qu’en écrit la Patristique et de ce que racontent les credos des églises. En mettant l’accent sur la diversification, la singularité des visages (des personnes) face à l’universalité des éléments de la nature ou des essences générales, devant l’infinie créativité et variété des relations et de la communication, le grand tourbillon divin me tourne résolument vers l’avenir, vers l’inconnu et l’imprévisible, là où la réalité se complexifie et se réalise concrètement.
Bref, je ne me sens plus catho. Du reste, je ne l’ai jamais été. Les seuls qualificatifs que je me reconnais sont ceux qui me font exister comme une personne vivante, comme quelqu’un parfois reconnu, souvent anonyme, aimé ou détesté, dans le temps de la vie et l’espace de la mort. J’ai souvent évoqué la pensée de Teilhard de Chardin dans cet écrit, mais je m’en éloigne aussi, en raison de mes passions pour la Bible, pour la tradition juive du Dieu qui s’exile de lui-même, pour l’hésychasme, pour la Process Philosophy et peut-être plus encore, pour la tradition philosophique et théologique allemande… sans être exhaustives, comme le sont ces questions. Je n’ai aucune prétention d’avoir embrassé la totalité, bien au contraire. Et puis, chacun peut contester s’il le veut le ton parfois méchant et caricatural avec lequel je traite certaines positions ou convictions. Je l’assume entièrement et il fait partie de mon combat et de mon tempérament. Je ne crois pas aux bons sentiments, ni aux bonnes paroles. Mais le plus important : s’il y a une destinée humaine, dans quelle direction faut-il la chercher ? si un Dieu existe et qu’il s’intéresse aux femmes et aux hommes, de quel Dieu s’agit-il ? Serait-il caché dans son exil éternel, dans la nuée turbulente, à la fois lumineuse et obscure, où il est écrit que « Moïse parlait à Adonaï, comme un ami parle à son ami » ? Pourquoi pas ?
*
Après propos.
 Cet écrit n’a pas pour but de convaincre qui que ce soit. En revanche, il a commencé avec la marche et le repos. Peut-être, par capillarité infime, quelque propos çà et là aidera-t-il le fatigué, celui qui se repose dans son confort et n’a plus envie de quitter l’auberge, à se remettre en marche ? Inversement, peut-être peut-il redonner un sens ou une piste à celui qui se sent égaré sur le chemin (pas forcément celui qu’il a calculé en partant) ? Je ne sais pas. Il y aura toujours du risque et de l’imprévisible, il y aura toujours du flux, et dans ce flux il peut toujours survenir une vie nouvelle plus riche encore que celles auxquelles on croit. Merci d’avoir pris le temps de lire ces pages : et bonne nuit prochaine.
Cet écrit n’a pas pour but de convaincre qui que ce soit. En revanche, il a commencé avec la marche et le repos. Peut-être, par capillarité infime, quelque propos çà et là aidera-t-il le fatigué, celui qui se repose dans son confort et n’a plus envie de quitter l’auberge, à se remettre en marche ? Inversement, peut-être peut-il redonner un sens ou une piste à celui qui se sent égaré sur le chemin (pas forcément celui qu’il a calculé en partant) ? Je ne sais pas. Il y aura toujours du risque et de l’imprévisible, il y aura toujours du flux, et dans ce flux il peut toujours survenir une vie nouvelle plus riche encore que celles auxquelles on croit. Merci d’avoir pris le temps de lire ces pages : et bonne nuit prochaine.




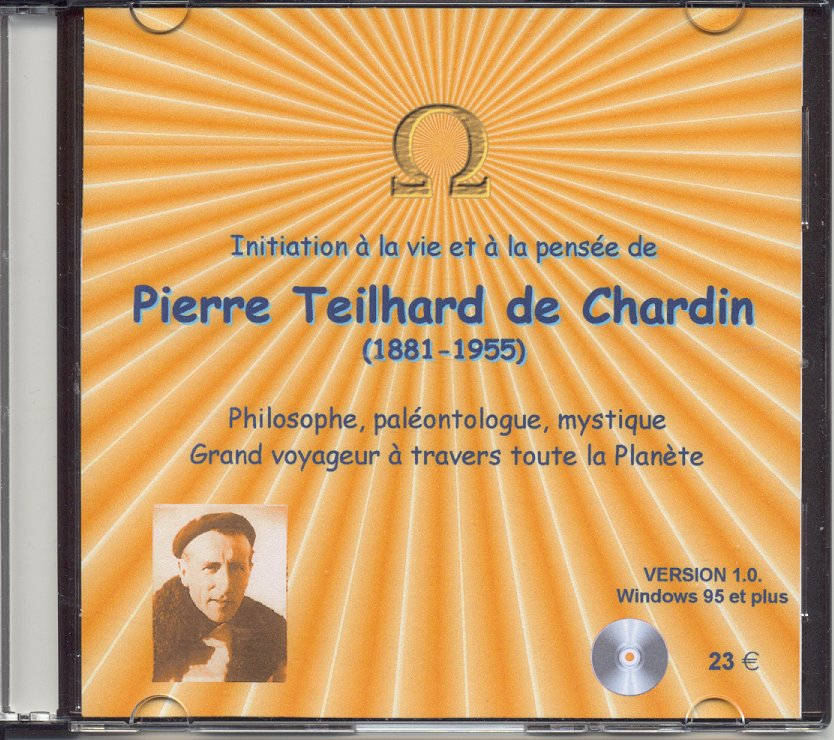
Coucou Nicolas!!! je ne retrouve pas ton humour!! et pourtant Dieu est humour!! et tu le sais bien!
J’ai lu ton « petit » message! Bigre!! Quelle vie!!
A mon petit niveau de « conducteur » de célébration de Funérailles, je ne peux être que Positive et pleine d’Espérance en confiant nos défunts à Dieu! Comme disait mon cher père, « quand vous vous retrouverez devant Dieu le Père, vous ferez moins les malins! » et on nous demandera: « as-tu aimé? »
C’est dommage que vous habitiez aussi loin…
Bref! bref! en attendant, je suis préoccupée par Maman de 97 ans et 1/2 qui s’éteint très très doucement et je ne manque pas de lui rappeler des souvenirs pleins de joies et d’humour pour la détendre!! Pauvre petite mère!!
Bien , sur ces belles paroles, je m’attaque à ma catéchèse (oh! le gros mot!) pour des 4è et pour des 3è, les 2 mon général! et j’ai la chance de n’avoir pas souffert à cause de l’Eglise , comme toi!…
Je t’embrasse ainsi que Véronique, les enfants et tous les petits-enfants!!
Merci Marie d’avoir eu le courage de lire ce texte jusqu’au bout… C’est super sympa.
Cela dit, il faut être extrêmement prudent si tu parles d’humour de Dieu. Au risque de me répéter, ne va pas raconter cela à une maman qui va être gazée avec ses enfants dans un camp d’extermination comme Auschwitz, ou à un brûlé par la radioactivité après l’explosion de la bombe d’Hiroshima, et combien d’autres tragédies au-delà de ce qu’on peut imaginer. Les SS anéantissaient les populations avec « Gott mit uns » sur leur casque… et les Américains ont mis « God » au début de leur Constitution, ce qui ne les gêne pas (comme tant d’autres) d’aller concevoir des armes abominables pour bombarder des villes. Ai-je besoin d’allonger la liste ? Le Christ ne riait pas sur la Croix.
Après, si on prend « humour » dans sa racine latine, en lien avec « humus », la terre, ou « humilité » (prudence aussi avec ce mot), on peut y réfléchir. L’humour ramène sur la terre quand on se laisse piéger par son bavardage cérébral dans les nuages, ou son « parlement intérieur » (expression d’Alexandra David Néel). La marche est l’occasion de souvent rire, et dans mon activité auprès des amputés, on rit souvent. Rire de soi, après une histoire, rire des autres, notamment des valides qui sont tellement ridicules parfois face aux handicapés. Dans « le nom de la rose » de Umberto Eco, il y a toute une réflexion sur le rire et l’humour divin : j’estime que s’il faut rire, il faut quand même regarder dans quel contexte on peut se le permettre. Je combat les essentialismes, pour éviter d’entendre dire bêtement des choses comme « Dieu est humour », ou même « Dieu est amour » sans un minimum de précautions. J’ai beaucoup réfléchi sur ces questions… Nous pourrons en reparler, surtout à travers le fait que tu t’occupes des funérailles. Véronique a beaucoup accompagné de mourants : souvent, ils ou elles partent paisiblement, mais certains portent aussi le poids de la souffrance du monde. Et parler n’est pas simple.
Bisous, je t’embrasse et toute la famille.
—–
PS. Attention de ne pas être « positive » aujourd’hui : ce n’est pas très à la mode !
Après avoir lu ton analyse qui essaye de répondre à la question/affirmation posée au début, je me demande si la vraie question n’est pas celle-ci : le catholicisme est-il mort ?
En effet tu démolis à juste titre la plupart des affirmations du credo et des rites qui les accompagnent.
Je n’ai pas comme toi un lourd passif avec l’église et ses ministres, mais j’ai de plus en plus de mal à vivre une foi authentique au milieu de ces fausses représentations de Dieu.
Cependant mon besoin de croire est profond et ta réflexion me plonge dans un grand désarroi. Mais peut-être est-ce là le premier pas sur un chemin nouveau, plus ardu mais aussi plus fécond, ce dont je te remercie amicalement.
Merci Denis, difficile de répondre à ton commentaire. Juste te dire que je n’abandonne ni la prière, ni l’espérance… bien au contraire. Je ne l’ai sans doute pas suffisamment mis en valeur, mais je suis de plus en plus stupéfait par le fait d’exister et plus encore, d’exister dans ce monde aussi surprenant et riche de créativité et de potentialités. C’est cela que je voudrais travailler dans le temps qui me reste… La pensée de Teilhard, celles de la Process Theology et la relecture critique de la Bible et de la Patristique, devraient aider. Et bien sûr, il y a l’aide des nouvelles représentations du Monde que nous offrent les sciences. Quant à l’Église Catholique, j’ignore où elle va : mais je ne l’imagine pas en dehors des autres églises, sans une critique de fond de son discours, de ses pratiques et de son organisation, et sans un vrai recours (et une reconnaissance non feinte) des laïcs. Mais peut-être que je me trompe ? Je suis à mon petit niveau dans le noir (ou dans la nuit des étoiles).
Nico
à mon tout petit niveau intellectuel et catho d’origine, je suis d’accord avec beaucoup de tes réflexions sur le Catholicisme actuel. La notion de Dieu est pour moi un mystère, une interrogation permanente et presque journalière. Je reviens de la sépulture de ma soeur, croyante passionnée, mais devant sa tombe je n’arrivais pas à appréhender le Dieu auquel elle croyait.
je vais te donner ma conclusion qui était celle de mon mari qui se déclarait athée convaincu, et qui disait volontiers : » j’aurai deux mots à lui dire quand je le verrai »
Merci Lulu. Quant à la réflexion de ton mari, elle est très biblique, voire judaïque… Dans le catholicisme, on ne discute pas avec Dieu (ou c’est réservé à quelques individus à qui il a été donné ce droit).