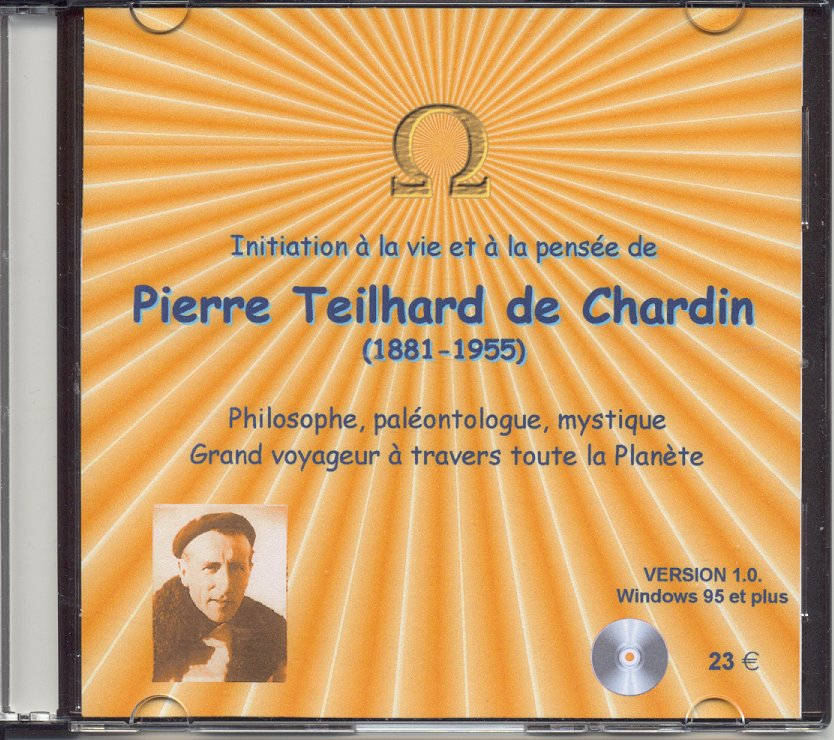Mai 2016, Saint-Guilhem-le-désert
Me voici sur le Chemin d’Arles, vers la très éloignée Santiago de Compostela. Il y a plus de 1800 kilomètres, d’après une borne entr’aperçue en Camargue. Je suis reparti sans rien prévoir, mais avec quelque résolution. Résolution au singulier : celle d’élargir l’espace-temps-énergie dit « de l’intérieur », tandis que les sens éprouvent, via la marche et les passions, le tourbillon de la vie dite « extérieure ». Dualité stupide, puisqu’il n’existe pas d’intérieur, ni d’extérieur, sauf en géométrie et en architecture… En ce qui concerne la vie, il n’existe que des interactions, des tissages, entre pôles imaginaires. Ou si on préfère une conjugaison, une fugue à multiples voix, entre ce qui est dit « vie intérieure » et « vie extérieure ». Au fond, seul le corps vivant importe. Note pour les non initiés à ma petite philosophie organique de papillon : le corps est d’abord un lieu et un vecteur d’interfaces et d’échanges d’information et d’énergie, avant d’être de la bidoche. Quand il est mort, il se décompose… les liens disparaissent.
Je passe la journée dans le gîte du petit Carmel de Saint-Guilhem. J’aurais l’occasion d’en reparler. Sept jours de marche déjà et beaucoup de solitude. Le Chemin d’Arles n’est pas la Via Podensis, le Chemin du Puy, et encore moins le Camino Francés, de Puente la Reina à Santiago. Les rencontres humaines se produisent dans les hébergements et dans les villages, quand on croise par chance un marcheur, pas sur les sentiers ou les bords de route. Il y a aussi la ville, puisque j’ai profité d’Arles un peu, de Montpellier un peu plus. Je suis resté dans la belle ville de l’Hérault une après-midi et une matinée. La nuit, à Montpellier, les klaxons ont résonné car le club de Rugby de la ville a gagné le Challenge Européen. L’énergie m’a manqué pour descendre dans la rue et partager la joie des montpellierains.
Le pélerinage de l’an passé vers Saint-Jacques-de-Compostelle m’a laissé dans une grande paix intérieure. Je craignais qu’elle ne dure pas. Erreur : j’ai passé l’hiver sereinement, même si quelques houles l’ont traversé. L’entropie augmente dans un environnement turbulent. Et l’environnement turbulent a toujours été le même dans ma courte vie : celui de ceux qui se disent spirituels ou religieux, alors qu’ils ne savent pas de quoi ils parlent ou parce qu’ils s’en servent pour manipuler les autres ou s’illusionner eux-mêmes. Peut-être en réécrirai-je un mot ? Et même. Est-ce vraiment nécessaire ?
Je suis officiellement à la retraite depuis Janvier. Une retraite anticipée, en tant que handicapé physique -et un peu mental-. Une retraite misérable aussi en raison de mon parcours professionnel chaotique, d’années perdues en maladie, convalescence, rééducation et surtout en études inutiles -les sept années de théologie-. Enfin « perdues » ? Est-ce si sûr ? À l’instant où j’écris, sur la belle et grande place de Saint-Guilhem-le-désert, je ne le pense plus. On progresse par essais et erreurs, montées et descentes, Soleil, pluies et brouillards, et non par ascension sur une route droite. Ainsi se construit un beau récit de vie.
Les fleurs, raffinées ou empoisonnées, de la philosophie sont vite réapparues. Mais je suis définitivement un philosophe papillon, un « lépidosophe », à côté du théologien désenchanté et meurtri, du physicien inaccompli et du musicien amateur et passionné. Le papillon n’est pas courageux, mais il demeure insaisissable.  Il s’envole au moindre danger… et pourtant il recueille du pollen et du nectar. J’en ai observé un, énorme, le long de l’Hérault ce matin. Il butinait sur une tige de fleurs bleues, de la luzerne semble-t-il, puis il s’éloignait de plusieurs mètres et invariablement revenait aux premières fleurs. Ainsi en est-il de ma propre « lépidosophie ». Quelques auteurs restent mes référents, mais j’aime vagabonder vers d’autres penseurs, parfois très éloignés de ceux qui ont structuré mon squelette intellectuel.
Il s’envole au moindre danger… et pourtant il recueille du pollen et du nectar. J’en ai observé un, énorme, le long de l’Hérault ce matin. Il butinait sur une tige de fleurs bleues, de la luzerne semble-t-il, puis il s’éloignait de plusieurs mètres et invariablement revenait aux premières fleurs. Ainsi en est-il de ma propre « lépidosophie ». Quelques auteurs restent mes référents, mais j’aime vagabonder vers d’autres penseurs, parfois très éloignés de ceux qui ont structuré mon squelette intellectuel.
Le premier soir, alors que je ne désirais pas me dévoiler, un bel homme de la quarantaine explique aux autres pèlerins sa passion de la philosophie. Il vit dans un camion, à la périphérie de la ville de Montpellier, un peu comme Diogène dans son tonneau. Il marche sur le Chemin en sens inverse pour se diriger je ne sais plus où, en Italie. Il a peu fait d’études, explique-t-il, et s’est arrêté deux ans après le Bac. Il explique avoir découvert la philosophie grâce à Michel Onfray. On ne peut vraiment pas reprocher au philosophe de Caen son formidable rayonnement didactique… et peut-être plus encore. Je n’ai pas le cœur à débattre, mais je ne peux m’empêcher de partager une de ces convictions qui se cristallisent dans ma tête. Ou plutôt qui « s’ADNisent », si on peut créer ce néologisme. La philosophie peut être abordée à partir d’un petit noyau de textes et d’auteurs qu’on apprécie, puis s’élargir petit à petit en agrégeant d’autres pensées proches, ensuite de plus en plus éloignées. Une spirale à partir de soi… Il est aussi possible d’attaquer la philosophie en s’affrontant aux idées qui nous heurtent ou qui s’opposent à nos propres présupposés. Voyage exotique et incertain au pays des idées. La première approche part de soi, prend de petits risques, puis se réconforte par le retour à la maison. La seconde approche demande de sortir de soi, de risquer son univers rassurant. Elle met en danger. Ma propre expérience de papillon oscille entre les deux attitudes. Toutefois ma formation polymorphe m’a conduit à m’aventurer plus souvent à partir de la seconde attitude, au risque d’être dangereusement déstabilisé. Et quelquefois de déstabiliser les autres : j’ai le souvenir d’un cours que je donnais sur Nietzsche dans un amphi. Plusieurs de mes étudiants se sont révoltés : « c’est insupportable ! », m’a crié l’un d’entre eux. Un débat s’est élevé avec un paradoxe qui m’avait amusé : c’était plutôt les étudiantes qui défendaient le philosophe allemand, et les étudiants qui le critiquaient…
Je dois toutefois reconnaître que je ménage en moi quelques sécurités, un peu comme le papillon de ce matin sur la rive de l’Hérault, qui revenait sans cesse au même bouquet de luzerne.
Le véritable danger est de se contenter ou de se polariser sur une seule attitude : soit le confort et sa richesse locale qui se déploie doucement, mais reste blottie dans la subjectivité ; soit le risque permanent d’ouverture et la menace de décomposition et de dilution de soi. J’ai proposé à mon compagnon l’idée selon laquelle ces deux approches de la philosophie correspondent, la première, au randonneur, la seconde, au pèlerin. Elles se complètent, se nouent ou se reflètent l’une l’autre. Le randonneur s’équipe, calcule ses itinéraires, prépare des tas de cartes, prévoit ses étapes et ses hébergements, éventuellement les réserve à l’avance, et préfère marcher en groupe pour s’assurer ou se rassurer. Il ne se quitte jamais vraiment lui-même. Le pèlerin s’en va, sans savoir où il dormira, où et comment il mangera, ni qui et qu’est-ce qu’il rencontrera. Il est un nomade et il fait confiance aux événements. Le Chemin de Compostelle est un mixte des deux, puisque le marcheur sait globalement où il va, avec quelque assurance de sympathie et de commodité le long de la route, à la différence du célèbre « pèlerin russe » ou sans doute de ces nomades du désert qui errent avec leurs troupeaux en fonction des points d’eau aléatoires et des herbages soumis aux caprices de la météo. Sur les sentiers de la Via Podensis, du Chemin d’Arles ou d’autres multiples voies vers Compostelle, se déplie un éventail de marcheurs qui vont de la randonneuse, du randonneur ou d’un groupe hyper-organisé, jusqu’au pèlerin abandonné, parfois sans un sou, confiant dans les aléas des rencontres, des opportunités et des expériences croisées.
Je n’écris pas ces mots par hasard. Dans un des premiers hébergements, le responsable du gîte m’apprend que désormais la « Compostela », à Santiago, ne sera remise qu’au pèlerin « chrétien ». Ma première réaction est un mouvement de mauvaise humeur. Mais qu’est-ce qu’un pèlerin ? Celui que j’ai proposé de définir à mon interlocuteur philosophique ? Et qu’entend-on par « pélerinage chrétien » ? Et si des randonneurs, des des touristes, des bouddhistes, des shintoïstes (il en existe), des taoïstes, des confucianistes, des juifs, des musulmans, des athées et agnostiques, ou même de simples chercheurs de sens et de vérité, désirent la Compostela après des semaines de marche, devront-ils se renier et mentir auprès des autorités pour l’obtenir ?
En un temps où des murs et des barbelés s’érigent partout dans un monde peureux, des hiérarchies ecclésiastiques qui se prétendent des autorités morales ne feraient-elles pas mieux de bâtir des ponts ou combler des fossés ? Réflexe identitaire, repli vers la forteresse qui caractérise nombre de catholiques depuis quelques siècles et surtout depuis quelques années ! La maladie de notre époque ! L’attitude de ces autorités religieuses reflète à la fois la peur et le mépris du monde. Peut-être acceptera-t-on quelques protestants, quelques évangéliques, quelques orthodoxes derrière les hautes murailles qui séparent ceux qui sont dignes de la Compostela et ceux qui n’en sont pas dignes ? C’est une question d’argent, explique un contradicteur, amusé de mon impatience : trop de monde sur les chemins. Bah, il n’y a qu’à demander un euro par personne qui quête une Compostela. S’il y a deux cent mille marcheurs vers Santiago, cela fera deux cent mille euros dans les caisses. Quand j’ai raconté ce souci à un jeune randonneur plus tard, il a éclaté de rire et il a affirmé : « ça ne durera pas longtemps, ça ne tiendra pas ! ». Il était évangélique. L’Esprit du Christ, a-t-il conclu, est universel. Un commentaire sur facebook ajoute qu’à la limite, on s’en fout. Ce n’est qu’un bout de papier. La municipalité de Santiago palliera à cette suffisance ecclésiastique. Tout cela n’a pas beaucoup d’importance. Mieux vaut en rire.
*
Deux jours de suite, je me retrouve avec un groupe de marcheurs seniors. L’un d’entre eux m’intimide beaucoup. Il arpente le dortoir et les couloirs du gîte et il parle avec assurance. Il exhibe un franc sourire communicatif sous une moustache abondante, mais bien taillée. Appelons-le Philippe. Au cours de notre conversation, il m’apprend qu’il a été PDG d’une grande entreprise de transport et de fret chimique, avec une flotte de tankers, des centaines de wagons de marchandises et de camions. Marche après marche, Philippe a gravi tous les échelons de son entreprise. Il avoue que son parcours professionnel est une belle réussite. Quand je mesure la mienne, c’est exactement le contraire. Inversement, Philippe explique qu’être présent à l’usine et au bureau tous les matins avant sept heures, revenir le soir après vingt-et-une heures et sacrifier ses week-ends et ses jours de congés n’aident pas tellement la vie domestique. Sa famille en a souffert et il le regrette. J’ai vécu l’inverse, moi qui suis si amoureux de mon épouse et si fier de mes enfants… qui me le rendent bien. Nous en avons conclu la toute relativité de ce que les bavardages médiatiques et le référentiel de la modernité nomment réussite ou échec. Ce fut une des plus sûres assimilations de mes pérégrinations, ces dernières années. Seul importe le récit de vie. Une conversation semblable est réapparue plus tard avec un autre marcheur.
Philippe et moi, nous nous sommes longuement salués avant de nous séparer. Mais j’ai senti qu’il était plus gêné à mon égard que moi-même à son égard. Je suis parti sur la route avec la paisible impression que bien des illusions se sont dissipés dans ma caboche.
Ma disposition d’esprit sur le Chemin d’Arles n’est pas orientée comme celle de la Via Podensis, en 2013 et 2014, et encore moins celle du Camino Francés, l’an passé. J’étais moins détendu. Entre Pampelune et Santiago, je m’étais engagé à ne jamais utiliser de transport en commun, ni de profiter d’une quelconque opportunité pour éviter une étape. La seule fois s’est produite à l’entrée de Burgos, après avoir tenté au maximum d’arriver à pied au Centre Ville, sous une chaleur à crever, avec un moignon en feu : j’avais craqué trois kilomètres avant le cœur de la belle cité. J’avais pris le bus. Là maintenant, ma vision est différente. Les occasions font le larron. À l’époque médiévale ou aux siècles précédents, bien des pèlerins profitaient des caravanes, des chariots ou des diligences. Comme je l’ai raconté dans l’article précédent, des hébergeurs recommandent de prendre le train entre Lunel et Montpellier. De gigantesques travaux pour le tracé du TGV et le contournement autoroutier de la ville de Montpellier ont cassé le GR et l’ont obligé à se détourner. Je suis parti chercher le train à Lunel, en improvisant le trajet, en franchissant un pont sur la Vistoule interdit aux piétons, en traversant une immense flaque d’eau de pluie sur un pied nu, la prothèse enlevée, en m’écrabouillant dans un TER bondé où il n’y avait pas de place pour s’asseoir.
 Parvenu à Montpellier, je m’engage dans les rues piétonnes. Il fait froid et la météo est à la pluie. Je suis en chemisette et en short, équipement qui contraste avec les habits des habitants et les touristes de la ville, protégés sous leurs imperméables ou abrités sous leurs parapluies. La préfecture de l’Hérault me ravit. Je ne me doutais pas qu’elle fut si belle. Un pianiste joue de son instrument en pleine rue. Il est à peine abrité sous une vaste tenture. Il m’interpelle en apercevant ma prothèse toute colorée : « je n’ai pas de danseuse ! ». J’éclate de rire et je lui réponds qu’avec moi, cela ne risque pas d’être très harmonieux. Ah, la danse ! Le seul art qui fait du corps l’œuvre d’art elle-même ! La veille au soir, j’avais regardé sur le smartphone l’extraordinaire film « The Red Shoes », « Les Chaussons Rouges » de Powell et Pressburger. Un des plus beaux films que je connaisse. Il fait partie de mon top cinq, il est le seul que j’ai emporté sur le smartphone. Le film relate l’histoire d’une jeune ballerine déchirée entre les exigences d’un chorégraphe qui veut faire d’elle la plus grande danseuse de son temps, et l’amour passionné, mais intéressé, de son mari, compositeur de musique. L’époux considère son épouse comme une muse, et, tout génial qu’il est, méprise la danse :
Parvenu à Montpellier, je m’engage dans les rues piétonnes. Il fait froid et la météo est à la pluie. Je suis en chemisette et en short, équipement qui contraste avec les habits des habitants et les touristes de la ville, protégés sous leurs imperméables ou abrités sous leurs parapluies. La préfecture de l’Hérault me ravit. Je ne me doutais pas qu’elle fut si belle. Un pianiste joue de son instrument en pleine rue. Il est à peine abrité sous une vaste tenture. Il m’interpelle en apercevant ma prothèse toute colorée : « je n’ai pas de danseuse ! ». J’éclate de rire et je lui réponds qu’avec moi, cela ne risque pas d’être très harmonieux. Ah, la danse ! Le seul art qui fait du corps l’œuvre d’art elle-même ! La veille au soir, j’avais regardé sur le smartphone l’extraordinaire film « The Red Shoes », « Les Chaussons Rouges » de Powell et Pressburger. Un des plus beaux films que je connaisse. Il fait partie de mon top cinq, il est le seul que j’ai emporté sur le smartphone. Le film relate l’histoire d’une jeune ballerine déchirée entre les exigences d’un chorégraphe qui veut faire d’elle la plus grande danseuse de son temps, et l’amour passionné, mais intéressé, de son mari, compositeur de musique. L’époux considère son épouse comme une muse, et, tout génial qu’il est, méprise la danse :  un art mineur à côté des symphonies et des concertos ! Le conte d’Andersen qui donne le nom au film, retrace l’histoire d’une danseuse qui met des chaussons rouges qui ne cessent jamais de l’entraîner dans la danse… qui finit dans la mort. Le ballet, au cœur du film, est un spectacle unique, féérique, sans équivalent, je crois, dans l’histoire du cinéma. Une pure merveille qui fait frémir et pleurer. Le film se termine tragiquement.
un art mineur à côté des symphonies et des concertos ! Le conte d’Andersen qui donne le nom au film, retrace l’histoire d’une danseuse qui met des chaussons rouges qui ne cessent jamais de l’entraîner dans la danse… qui finit dans la mort. Le ballet, au cœur du film, est un spectacle unique, féérique, sans équivalent, je crois, dans l’histoire du cinéma. Une pure merveille qui fait frémir et pleurer. Le film se termine tragiquement.
L’interpellation du pianiste de rue, sous la pluie, à un marcheur unijambiste, n’est pas sans signification. Il est bien possible que je poursuive, inconsciemment, ce nouveau Chemin comme une danse. Je songe peut-être à m’identifier un tout petit chouia à Zarathoustra, le danseur pèlerin qui écoute et conseille ceux qu’il croise… en moins bavard et en moins sentencieux, j’espère ! Le corps, même meurtri et lourdingue, comme œuvre d’art. Montrer sans démontrer. Voilà un beau projet du Camino. On évitera quand même la tragédie…