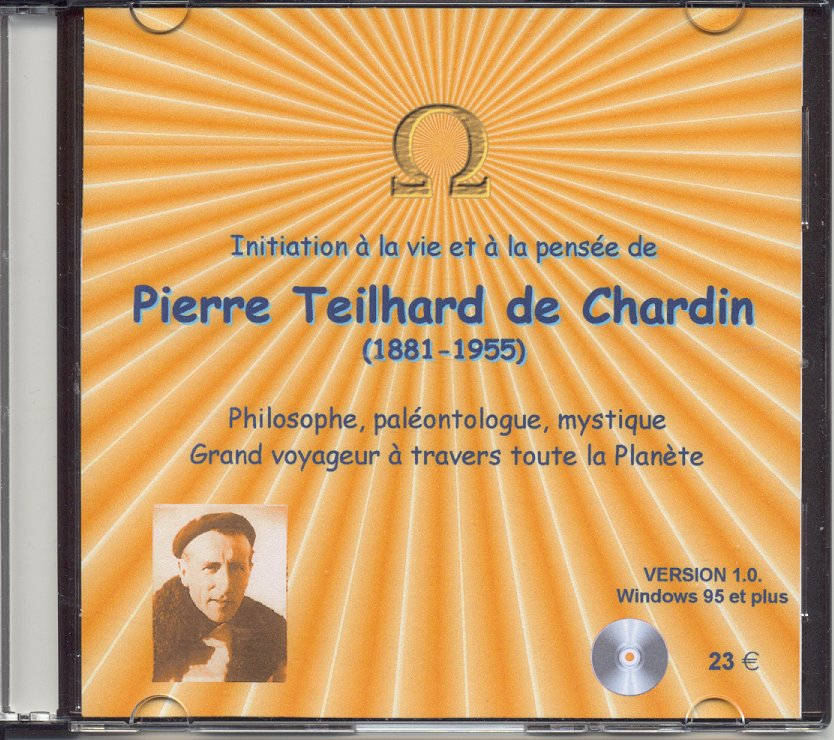Mai 2016, Montpellier
Le démon de la marche m’a saisi. Si je reprends le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et non une randonnée quelque part sur la Planète, c’est parce qu’il offre une zône de confort pour un handicapé. Si j’avais été valide, j’aurais aimé traverser la Chine, la Cordillière des Andes, me risquer sur la Route de la Soie, crapahuter au cœur de l’Himalaya ou vers la Terre de Feu. Le Chemin de Saint-Jacques propose de nombreux hébergements, il est balisé… et sur la route, il est possible de trouver une pharmacie, un médecin ou un pèlerin soignant.
Cette année, je consens à d’autres conforts : un smartphone avec un réseau actif qui permet d’échanger des informations et des photos avec des proches, sur lequel j’ai chargé Facebook. L’an passé sur le Camino d’Espagne, je possédais déjà un smartphone Xiaomi, acheté en Chine. Je prenais des photos et je notais les événements de chaque jour. Ma maladresse m’avait conduit à ne capter aucun réseau. J’avais cheminé une cinquantaine de jours, loin des nouvelles des miens, loin des bavardages médiatiques, sauf lorsque les circonstances conduisaient à croiser un réseau wifi. Et puis, le smartphone est mort, une fois arrivé à Santiago, à force de chocs, de chutes et de rayures. J’ai donc racheté un semblable smartphone Xiaomi de la nouvelle génération, encore plus performant et bien plus rapide, à un prix défiant toute concurrence. Et cette fois, j’ai installé Facebook. Le célèbre réseau social me rebutait, j’ai souvent navigué à la recherche d’une alternative open source… mais quand je me suis aperçu que non seulement nombre d’amis, de collègues, de proches et moins proches familiaux, mais encore des associations, des groupes de réflexion, des personnalités et des médias y écrivaient, j’ai songé : « et pourquoi pas ? Après tout, l’instantané fait autant partie du Chemin que la lente éternité de la marche ». Et si Facebook peut devenir une drogue, l’Esprit du Camino saura m’en détacher quand il le faut et me le rendre quand il le veut.
J’écris, assis à la terrasse du restaurant Sister’s Café, à Montpellier, près du gîte Saint-Roch, attenant à l’église du même nom. Je chemine depuis quatre jours depuis Arles. Petit à petit, les sensations se réveillent. Les multiples contrepoints de la conscience et de la parole, également. Ils m’amusent… Surtout le décalage entre le bavardage intérieur incessant, le « parlement intérieur » selon l’expression d’Alexandra David Néel dont j’ai déjà parlé, le silence en soi et la prière continue. Il faudrait ajouter aussi les mélodies que le cerveau droit infuse dans ces flux de mots et de pensées. Le Chemin d’Arles, ou « Camino Tolosona » comme je viens de le lire dans un dépliant, est calme en ce début de Mai. Aucun autre pèlerin en vue, sauf dans les hébergements, à l’exception d’une élégante et très belle femme blonde à l’accent nordique rencontrée lors d’une pause le long d’un canal… et que je n’ai jamais revue.
Quatre jours depuis Arles ? Aurais-je été si rapide avec ma jambe de métal, de résine et de plastique ? Non. En raison des travaux d’infrastructure du TGV, d’une autoroute de contournement de la métropole de Montpellier et de divers réseaux souterrains, j’ai pris le train entre Lunel et la préfecture de l’Hérault. Ce choix était vivement conseillé par les hébergeurs, par l’un ou l’autre marcheur et même écrit sur le guide du « Miam miam, dodo » que j’ai acheté cette année… et qu’utilisent nombre de pèlerins vers Compostelle.
Trois hébergements. Deux très sympathiques, un autre, plus cher, moins accueillant et où j’ai dormi seul. Aléas du Camino. Il a plu tous ces jours-ci. La nuit où j’étais seul, j’ai terriblement souffert de douleurs du membre fantôme. Heureusement, personne ne m’accompagnait ; il aurait mal dormi en entendant mes gémissements et mes spasmes. J’ai l’habitude des douleurs fantômes, elles ne m’affolent pas… mais elles peuvent inquiéter -à tort- des valides non habitués à ce curieux phénomène des amputés. Comme l’année dernière sur le Camino espagnol, elles ne se sont manifestées qu’une seule fois, en plein jour, du côté de Logroño, je ne me suis pas méfié et je n’ai embarqué aucun médicament. Les nécessités de soin du moignon sont déjà bien assez encombrants. Les crises du membre fantôme sont souvent des signes de changement d’atmosphère, météo, environnement, humidité, altitude. Elles manifestent aussi une médiation critique de tout l’organisme. Le système nerveux et le cerveau tentent de s’adapter à une situation nouvelle. La conjugaison de tous ces facteurs agit sur les zones fragiles et mutilées de l’organisme. Rien d’inquiétant, tout le monde l’expérimente sous d’autres formes physiques et psychiques.
Depuis plusieurs semaines, le climat est perturbé, froid, pluvieux, venteux. La terre trempée, habituellement indifférente aux infimes caresses des pieds des marcheurs, devient de la « terre amoureuse », de la boue qui colle aux sandales et qui les alourdit.  Des flaques d’eau barrent la route. Près de Lunel, j’ai dû déchausser mon bon pied, enlever la prothèse et franchir une mare d’eau avec les béquilles. Je tenais la prothèse en l’air pour éviter qu’elle se s’imprègne d’humidité. La prothésiste m’a expliqué qu’il y avait des capteurs électroniques jusque dans le talon métallique. Dans quel but ? Je n’en sais rien. Mieux vaut éviter les pannes. Lors de la marche sur la Via Podensis, la prothèse était tombée en panne du côté de Cahors : pendant dix jours, j’avais marché le genou raide.
Des flaques d’eau barrent la route. Près de Lunel, j’ai dû déchausser mon bon pied, enlever la prothèse et franchir une mare d’eau avec les béquilles. Je tenais la prothèse en l’air pour éviter qu’elle se s’imprègne d’humidité. La prothésiste m’a expliqué qu’il y avait des capteurs électroniques jusque dans le talon métallique. Dans quel but ? Je n’en sais rien. Mieux vaut éviter les pannes. Lors de la marche sur la Via Podensis, la prothèse était tombée en panne du côté de Cahors : pendant dix jours, j’avais marché le genou raide.
Cette année, j’ai acheté une grande pélerine rouge fluo, un « poncho » comme explique le vendeur, capable d’envelopper tout le corps et le sac à dos. Je ressemble à un dromadaire rouge, m’a-t-on écrit. Pour l’enfiler, j’ai tenté plusieurs méthodes avant de trouver une solution : assis par terre, sur un siège improvisé, une pierre par exemple, je me dissimuleet dessous, sans les manches, je me recroqueville à l’intérieur, je saisis le sac à dos par le côté gauche, je glisse la sangle droite et j’attache le tout, puis je sors la tête et les bras… et je remets la prothèse si elle est enlevée.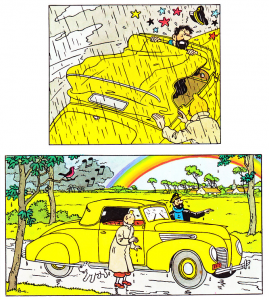 Lors d’un arrêt près de Vauvert, la pluie a commencé à tomber avec intensité tandis que je m’étais abrité sous un arbre. J’ai saisi la pélerine rouge, j’ai gigoté dans tous les sens pour essayer de l’enfiler… et quand j’y suis parvenu, la pluie a cessé. L’image du Capitaine Haddock, qui tente de déplier la capote de sa voiture sous l’orage et qui y parvient à l’instant où la pluie s’arrête, est une bonne illustration. Suite à cette mésaventure, j’ai analysé la meilleure technique pour enfiler la pélerine quand je suis seul. En Camargue, près de Saint-Gilles, j’avais demandé à un passant de m’aider.
Lors d’un arrêt près de Vauvert, la pluie a commencé à tomber avec intensité tandis que je m’étais abrité sous un arbre. J’ai saisi la pélerine rouge, j’ai gigoté dans tous les sens pour essayer de l’enfiler… et quand j’y suis parvenu, la pluie a cessé. L’image du Capitaine Haddock, qui tente de déplier la capote de sa voiture sous l’orage et qui y parvient à l’instant où la pluie s’arrête, est une bonne illustration. Suite à cette mésaventure, j’ai analysé la meilleure technique pour enfiler la pélerine quand je suis seul. En Camargue, près de Saint-Gilles, j’avais demandé à un passant de m’aider.
*
La qualité des paysages entre Arles et Montpellier est irrégulière. Longer et franchir des routes goudronnées est fréquent. Mais souvent les paysages sont apaisants, comme lors des longs kilomètres qui s’étirent au milieu de la Camargue, après Arles. Les bruits des animaux sont singuliers, parfois inconnus. En plus des merles et des oiseaux ordinaires, des grenouilles déchaînées, on entend des sons que je suis incapable d’identifier. Pendant plus d’une dizaine de minutes, je suis resté à écouter le vacarme d’un animal mystérieux, caché dans un marécage, à quelques mètres de moi. Il ne semblait pas être gêné par la présence d’un intrus. Il n’y a pas encore de cigales, mais malgré la pluie, toutes sortes de grillons et de criquets rivalisent les uns avec les autres. Sous la petite bruine qui caresse le visage et les oreilles, le tintamarre organique résonne comme un concerto pour orchestre ou une pièce de free jazz. Chaque instrumentiste vient faire son petit tour, s’en va, revient.
Là où je marche, il n’y a pas de flamants roses. Il faut se rapprocher de la Mer Méditerranée. En revanche, des troupeaux de chevaux blancs et gris paissent calmement et parfois courent à travers les prairies. Certains viennent manger dans ma main quelques herbes qu’ils ne parviennent pas à saisir par-dessus les clôtures qui nous séparent. Ils discriminent consciencieusement ce que je leur propose. Ce ne sont pas les plantes qui, à mes yeux de non équidé, me semblent les plus appétissantes que mes compagnons d’un instant choisissent. Les animaux domestiques sont fréquents. Ici, je tombe sur des cochons en pleine nature : c’est rare. Je les observe : d’où vient cette répugnance que l’on connaît dans certaines religions ? La saleté ? L’impureté ? Intéressant ! La craindrait-on ? Curieux que l’impureté organique repousse tant les esprits, alors que l’on s’accomode bien de la pollution mécanique, chimique et plastique : ça fait « moins sale », moins « pur » ? Ah, ce que m’agacent cette notion de pureté, élevé au rang divin, et toutes ces superstitions qui lui sont attachées ! Bref, passons. Il y a également de beaux moutons. Lorsque je longe le pré, les brebis et les agneaux s’éloignent, tandis qu’un bélier, courageusement, me fait front et m’accompagne le long de la clôture.
Il y a également de beaux moutons. Lorsque je longe le pré, les brebis et les agneaux s’éloignent, tandis qu’un bélier, courageusement, me fait front et m’accompagne le long de la clôture.
Alors que je longe un canal aux rives bétonnées, j’aperçois une forme bizarre flotter. Puis une autre, et encore une autre. Ce sont d’énormes poissons morts. Leur taille dépasse celles des grosses carpes que je pêchais dans mon enfance, et il ne s’agit ni de brochets, ni de sandres, encore moins de perches. Des silures ? Pas sûr. La rivière ne doit pas être très saine ! Il n’est pas souhaitable d’aller s’y baigner et encore moins de goûter la chair d’un poisson pêché dans ces eaux. Je cherche du regard l’existence d’une usine polluante. Rien en vue. Peut-être y a-t-il en amont quelque déversoir de pesticide, sulfate, de nitrate ?
Nombre de pollutions sont invisibles. Il n’existe pas que celles qui se voient, se sentent. Il y a celles qui s’entendent. Le retour sur le Chemin de Compostelle est l’occasion de soupeser la pollution sonore des moteurs mécaniques. Comme nombre de sections depuis Arles se déroulent sur des routes bitumées, le bruit des moteurs de voitures, de motos ou de tracteurs, ramène ses stress. Et inversement dès que la route est quittée, le silence ou plutôt le bruissement des sons naturels soulage le coeur et l’esprit et adoucit le corps. J’aime le chant du vent dans les hautes herbes, dans les roseaux et dans les arbres. Le craquement des branches qui s’entrechoquent répond, telle une batterie, aux souffles des feuilles qui se frôlent. Le Mistral, semble-t-il, ou plutôt les vents qui tourbillonnent autour des nuages d’averse, agitent sans rythme tout ce petit monde végétal. Cet hiver, j’ai appris sur le piano le Prélude de Debussy, « le vent dans la plaine » : le compositeur a bien saisi l’impression de l’instant, mais il n’a pu embrasser la variété infinie des sons des brises et des rafales.
Je savoure l’univers sonore dans les nombreux vergers que l’on traverse dans les collines, entre Saint-Gilles et Vauvert. Malgré la gadoue, voilà encore un sentier agréable, bordé de petits arbustes qui se balancent et murmurent, éloigné du goudron, du CO² et des pétarades des moteurs thermiques. Un agriculteur arrive avec son 4X4 par un chemin boueux. Allons bon, finie la tranquillité ! Sortent de l’arrière de la voiture et de la place avant droite, trois ouvriers d’origine maghrébine. L’agriculteur, un bel homme aux cheveux blancs argentés et au beau sourire marqué par les années, m’explique longuement qu’ici on cultive des pêchers et des abricotiers, mais pas des prunes. Il me montre le travail que ses ouvriers et lui-même ont commencé : couper les branches stériles dans les pêchers, sur des centaines de mètres. J’admire la vitesse des travailleurs, mais aussi la qualité des outils qui tranchent net les rameaux infertiles. Le soir, dans un gîte, l’hôtesse m’explique que son mari, d’origine tunisienne, a lui aussi oeuvré dans ces vergers. Mais les salaires sont bas et le travail éreintant. Ombres et lumières, comme la météo de ces premières journées.
 Plus loin, ce sont des champs de coquelicots qui s’étalent à perte de vue. Quelque part, dans la Meseta, face à de semblables prairies, j’avais plaisanté avec deux marcheuses malaisiennes en leur expliquant qu’il s’agissait de champs de pavots cultivés par des trafiquants d’opium. Elles m’avaient cru, avant de s’apercevoir de la supercherie. Nous nous sommes liés d’amitié à partir de ce jour-là.
Plus loin, ce sont des champs de coquelicots qui s’étalent à perte de vue. Quelque part, dans la Meseta, face à de semblables prairies, j’avais plaisanté avec deux marcheuses malaisiennes en leur expliquant qu’il s’agissait de champs de pavots cultivés par des trafiquants d’opium. Elles m’avaient cru, avant de s’apercevoir de la supercherie. Nous nous sommes liés d’amitié à partir de ce jour-là.
*
Je n’ai pas évoqué les bourgades traversées, Saint-Gilles, Vauvert, Aigues-Vives, Gallargues, Lunel. La pluie m’a dissuadé de les arpenter. Arles et Montpellier sont à part. Par beau temps, ces bourgs sont sans doute agréables. Gallargues et Saint-Gilles semblent relativement épargnés par la circulation automobile. De Lunel, traversé uniquement pour me rendre à la gare, je n’ai rien vu. Le bourg de Vauvert est sillonné de rues et la nuisance sonore est forte. J’éprouve souvent du chagrin quand je découvre un village tué par des routes passantes, tel un organisme transpercé par des épées : il est devenu dangereux de passer d’un point à l’autre de ce qui fut, peut-être, une sorte d’écosystème humain vivant. Bien des municipalités ont sacrifié leur biotope au dieu Automobile, au lieu de permettre aux rues et aux véhicules d’être au service des habitants. J’ai été conseiller municipal, je sais de quoi je parle. Et mon expérience de handicapé compâtit aussi aux épreuves que doivent subir les corps malades, blessés ou vieillis dans bien des villages et des villes. Cela dit, je suis en admiration devant ces pèlerins qui, après une longue journée de marche, décident le soir d’aller se promener au cœur des villages et des villes. Cela m’est parfois arrivé, mais rarement, sauf si je décide de m’arrêter plus longuement : Cahors, Saint-Jean-Pied-de-Port, Logroño, Burgos, Léon, si je me rappelle.
 À la sortie de Vauvert, j’observe des juments et des poulains allongés dans l’herbe. Il n’est pourtant pas encore l’heure de la sieste. Un vieux monsieur en vélo s’approche. Ses traits sont rieurs et son sourire édenté supportable. Il me raconte la généalogie de ces poulains et de leurs mères. Moins de trois mois, explique-t-il. Avec un faciès moqueur, il me demande : « savez-vous quel âge j’ai ? ». En le dévisageant et en constatant sa vitalité toute fraîche sur son vélo, je réponds : « je ne sais pas ! Soixante-dix-huit ans ? » Il éclate de rire : « quatre-vingt-douze ans, Monsieur. Je suis né en 1924, j’ai connu la Guerre, j’ai des enfants, des petits enfants, des arrière-petits-enfants. » Et il ajoute : « mon petit frère, qui était bien plus costaud que moi, est mort il y a huit ans. » Nous épiloguons, nous nous saluons. Je repars tout guilleret. En voilà un qui est bâti pour vivre centenaire. Je le regarde s’éloigner avec assurance sur sa bicyclette.
À la sortie de Vauvert, j’observe des juments et des poulains allongés dans l’herbe. Il n’est pourtant pas encore l’heure de la sieste. Un vieux monsieur en vélo s’approche. Ses traits sont rieurs et son sourire édenté supportable. Il me raconte la généalogie de ces poulains et de leurs mères. Moins de trois mois, explique-t-il. Avec un faciès moqueur, il me demande : « savez-vous quel âge j’ai ? ». En le dévisageant et en constatant sa vitalité toute fraîche sur son vélo, je réponds : « je ne sais pas ! Soixante-dix-huit ans ? » Il éclate de rire : « quatre-vingt-douze ans, Monsieur. Je suis né en 1924, j’ai connu la Guerre, j’ai des enfants, des petits enfants, des arrière-petits-enfants. » Et il ajoute : « mon petit frère, qui était bien plus costaud que moi, est mort il y a huit ans. » Nous épiloguons, nous nous saluons. Je repars tout guilleret. En voilà un qui est bâti pour vivre centenaire. Je le regarde s’éloigner avec assurance sur sa bicyclette.