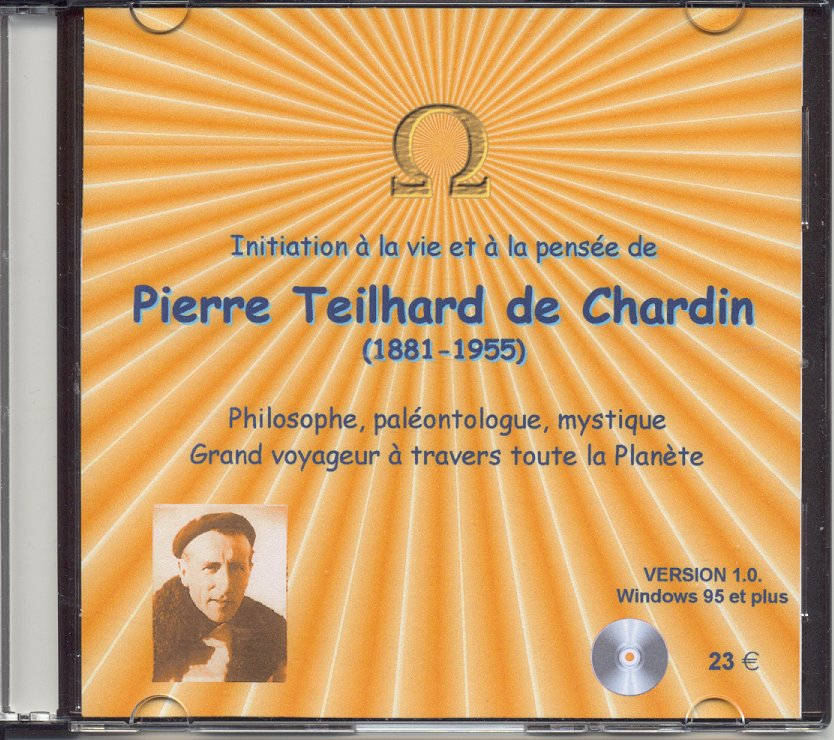Un jour, dans une conversation sérieuse et « profonde », un de mes collègues de travail m’a expliqué que j’étais une personne « superficielle ». Curieusement, cela ne m’a pas vexé et m’a plutôt rendu interrogatif sur ce que l’on entend par « superficiel » et en contraste, par « profond ». Lorsque j’étais étudiant, à peine sorti de quatre années éprouvantes de maladie, convalescence, rééducation, j’avais une amie qui lisait les revues « people », avec vedettes en vue au milieu des publicités pour cosmétiques. Elle adorait fréquenter les boutiques de gadgets et de colifichets quand elle n’allait pas passer des longues heures à rêver dans des boutiques de luxe ou des grands magasins de Centre Ville. Pourtant sa profession était de peindre et de créer des vitraux pour des églises et des entreprises. Elle était artiste et pleine de talents. Avec ma jeunesse blessée et mes références cathos, je m’étonnais de ce côté « superficiel » à côté de cette activité « profonde ».
Inversement, il m’est arrivé plus tard d’entendre des étudiants critiquer le fait que tel professeur ou tel écrivain, en se citant lui-même, en exposant ses idées singulières ou les idées d’un livre qu’il a écrit, n’est pas objectif dans sa présentation, fait croire qu’il est « profond » alors qu’il ne fait que cacher la « superficialité » de son savoir et de son être. Un vrai professeur ou un vrai savant est quelqu’un qui s’efface devant le savoir des autres et l’immensité « profonde » et mystérieuse de l’être, du temps et du monde. Il me semble toutefois que nombre de ces savants qui se prétendent totalement objectifs, « profonds » parce qu’ils ont creusé une question (qui souvent n’intéresse que les universitaires), et qui croient posséder la vérité par addition de toutes ces objets de connaissance, sont tout aussi trompeurs… et je dirais même qu’un tel savant peut devenir encore plus totalitaire que celui qui expose ses propres idées.
Ne chicanons pas : ce sont deux extrêmes, deux polarités. J’ai encore le souvenir aussi d’un philosophe affirmant la « profondeur » inouïe et sans égale de Heidegger, face à un contradicteur lui rappelant quand même que ce grand et « profond » philosophe était le penseur officiel de l’Allemagne nazie. Parenthèse : le premier philosophe avait même parlé de la « spiritualité » du nazisme… Comme quoi, on met n’importe quoi sous le mot « spiritualité ».  Fin de la parenthèse. Qu’il y ait des forêts profondes en Allemagne, comme il y a des puits profonds, des fosses marines profondes inexplorées, des regards profonds, je veux bien. Qu’il y ait des poésies profondes, des films profonds, des écrits profonds, OK. Mais qu’on me dise ce qu’on entend par « profond ». Je lis actuellement des romans de Haruki Murakami : son style apparemment « superficiel », sans grandes phrases « profondes », se situe pourtant sans cesse dans un corridor étroit entre des murs transparents de rêves, d’ésotérisme, d’étrangeté et de l’autre le mur opaque du quotidien le plus banal, entre la vie quelconque et la mort ou la rupture inattendue.
Fin de la parenthèse. Qu’il y ait des forêts profondes en Allemagne, comme il y a des puits profonds, des fosses marines profondes inexplorées, des regards profonds, je veux bien. Qu’il y ait des poésies profondes, des films profonds, des écrits profonds, OK. Mais qu’on me dise ce qu’on entend par « profond ». Je lis actuellement des romans de Haruki Murakami : son style apparemment « superficiel », sans grandes phrases « profondes », se situe pourtant sans cesse dans un corridor étroit entre des murs transparents de rêves, d’ésotérisme, d’étrangeté et de l’autre le mur opaque du quotidien le plus banal, entre la vie quelconque et la mort ou la rupture inattendue.
L’expérience démontre qu’il est impossible d’embrasser un savoir exhaustif et complet sur un thème, sauf dans des domaines extrêmement spécialisés… Un tel savoir est possible, bien sûr : il y a des domaines dans les mathématiques (la trigonométrie) ou dans la logique, parfois dans la physique (l’optique géométrique par exemple), qui sont des sujets achevés. Une fois déterminés leurs axiomes et les règles de leur fonctionnement, tous les théorèmes qu’on peut en extraire sont connus et démontrables. Toutes les applications sont calculables. Il faut toutefois savoir que ces domaines sont extrêmement réduits, et ils diminuent petit à petit dans l’espace des mathématiques.
Les derniers penseurs à posséder un savoir quasi encyclopédique sont les humanistes. Je prends l’exemple de Pic de la Mirandole (1463-1494) qu’on a présenté comme quelqu’un qui avait tout lu, qui parlait plus de vingt langues couramment et qui était capable de répondre sur tous les sujets de l’époque, scientifiques, ésotériques, théologiques. Du moins, c’est ce qu’en dit la légende. Il s’agissait d’un savoir d’érudition, de lecteur de livres et de bibliothèques, et aussi de chance historique : la chance de croiser d’autres esprits de même culture ou de même savoir, la chance d’apparaître à une époque où les livres étaient diffusés à partir de quelques éditeurs et de quelques presses géographiquement situées, où les princes avaient le temps de se cultiver pendant que des serviteurs et des commerçants se chargeaient des soins du corps, de la nourriture et de l’habitat.
Face au savant du XVème siècle que représente Pic de la Mirandole, le jugement de Pascal, deux siècles plus tard, est sans concession : ces grands humanistes ont un immense savoir, mais un savoir « superficiel ». Cette idée de savoir superficiel a une connotation péjorative, pour ne pas dire négative. Pascal a raison d’affirmer que Pic de la Mirandole et d’autres humanistes ont un savoir dit « superficiel ». Mais je ne partage pas les conclusions négatives de sa remarque. On retrouve le même genre de critique chez Voltaire critiquant Leibniz, non sans finesse il faut bien le reconnaître, ou plus récemment par exemple, chez Jacques Monod, dans le best seller « le hasard et la nécessité », au nom des « Pensées » de Pascal, à l’encontre de Teilhard de Chardin et de Bergson.

Pic de la Mirandole
Cela dit, il est impossible d’être totalement superficiel. Pascal a critiqué Pic de la Mirandole, deux siècles après sa mort, parce qu’il était trop érudit, trop savant pour être quelqu’un de profond. Il exprimait une opinion extrémiste, ce qui n’est pas étonnant de la part de Pascal dont l’oeuvre est particulièrement « profonde »… et dont les rayons aujourd’hui éclairent bien du monde : que ce soient des croyants ou des athées, des scientifiques ou des philosophes. Pic de la Mirandole était aussi un être qui avait soif de vérité profonde et ses recherches universelles, sans oublier les événements difficiles de sa vie (condamnation par l’Inquisition, fuite, exil, soumission aux princes de son époque et finalement empoisonnement à l’arsenic à la fin de sa courte vie, en 1494) qui démontrent une quête insatiable de sens. Il y a des carrefours où pour être soi-même, il faut faire des choix… et inversement pour faire des choix de plus en plus libres et créateurs, il faut être soi-même. Pic de la Mirandole a choisi l’érudition, a créé la Kabbale chrétienne, puis s’est rapproché de Savonarole à la fin de sa vie… et certaines de ses méthodes scientifiques ont beaucoup d’actualité : par exemple, le fait que la connaissance complète d’un sujet est l’analyse et le croisement de plusieurs points de vue, de diverses perspectives. Il avait une pensée superficielle et personnelle. Ce n’est pas interdit.
*
La « superficialité » est aussi essentielle que la « profondeur ». Le superficiel est aussi fondamental que le profond, selon un principe d’incertitude de la connaissance qui doit toujours être présent à l’esprit. Le terme de « superficiel » est peut-être mal choisi, mais gardons-le pour l’instant, puisqu’il désigne une surface, une étendue, un plan, une extension. Ce mot « extension » est important. Le principe d’incertitude que je propose, je l’appellerai « principe d’indétermination épistémologique », par extrapolation d’un autre principe d’indétermination bien connu, venu des sciences physiques, celui de Heisenberg dans le domaine de la physique quantique. L’adjectif « épistémologique » signifie qu’il concerne la connaissance, et dans la tradition française, la connaissance scientifique. Le « principe d’indétermination épistémologique » prend de multiples formes qui se recoupent. Il repose sur les limites qu’imposent notre façon de penser. C’est-à-dire une pensée qui se déroule dans le temps, selon un processus linéaire et parfois multi-linéaire (je pense une chose, puis une autre, que je relie logiquement ou par analogie, ou éventuellement par intuition).
D’abord un rappel : il existe deux principes de connaissance que tout intellectuel devrait connaître par cœur. Nous sommes nécessairement sujet et centre de notre propre perspective, et toute connaissance est une mise en perspective. Il y a toujours un grossissement de ce qui est proche, intellectuellement, affectivement, socialement… et une perte de précision, voire une perte de résolution (au sens optique) de ce qui est loin. Notre pensée est toujours en perspective : je vois mieux ce qui est proche, proche spatialement bien sûr, mais proche de mon histoire, de mes expériences, des présupposés et acquis de la communauté dans laquelle je vis et qui s’exprime dans un langage déterminé. Ensuite le lecteur de cet article devra intégrer le présupposé éthique suivant : selon moi, le dernier critère qui détermine la valeur d’une réflexion n’est ni le jeu entre la vérité et l’erreur, ni celui entre le bien et le mal, mais la mystérieuse dialectique entre la vie et la mort.
Le principe d’indétermination proposé peut prendre de multiples formes. J’en propose deux. L’un concerne le temps et l’espace. L’autre concerne le superficiel et le profond, ou plus exactement la généralité claire et distincte et la singularité ineffable et libre.
La première forme d’indétermination affirme, dans un référentiel spatio-temporel interne, que la connaissance complète d’un sujet s’accompagne d’une indétermination complète de son évolution. Mais sans aller jusqu’à ces extrêmes, disons que la connaissance d’un sujet est liée à une indétermination de l’évolution de l’ensemble ou de ses éléments et réciproquement. Prenons un exemple : supposons que je sois passionné par un savoir A : par exemple la musique romantique allemande de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle. Je vais donc étudier les grands musiciens allemands de cette époque, leur vie et leurs oeuvres, les précurseurs et les inspirateurs, les dédicaces, les interprètes, acheter les disques, analyser et comparer les partitions et les interprétations, etc. Je deviendrais un savant dans ce domaine particulier A.

Belà Bartok
Maintenant, je veux m’intéresser à un savoir B, toujours musical. Par exemple, la musique populaire de la Hongrie au début du XXème siècle. Je vais de nouveau lire de manière exhaustive tout ce qui s’écrit sur ce thème, écouter tous les disques ou le plus possible de disques, voire éventuellement me rendre sur place dans les villages et les quartiers des villes, noter, ou enregistrer toutes les mélodies, tous les rythmes et les contrepoints, toutes les nuances vocales et instrumentales etc. Je prends cet exemple, puisque le travail d’étude d’ethnologie musicale de la Hongrie a été réalisé par les musiciens Bartok et Kodaly dans les années 1920 à 1930, dans les campagnes de Hongrie. Pendant que le thème B est travaillé, la musique populaire hongroise donc, le savoir A, la connaissance globale de la musique romantique allemande, bien que logée dans la mémoire, est oubliée un certain temps. Bien sûr, elle agit comme paradigme actif, et peut-être même aide à traiter le savoir B.
Or ce savoir A évolue de son côté, tandis que nous étudions le savoir B, selon deux dynamiques : il y a d’une part une dynamique externe, l’arrivée de nouveaux interprètes, des relectures de la vie et de l’oeuvre de tel ou tel compositeur, une nouvelle connaissance des conditions matérielles, affectives ou politiques de la composition de tel oeuvre, de la vie de tel auteur ou de tel courant musicologique. Il y a d’autre part une dynamique interne due à la rétroaction qu’infère ma nouvelle connaissance du savoir B sur le savoir A : tiens il y a des influences hongroises ou populaires sur tel grand compositeur symphonique ou tel créateur d’opéras. Si nous revenons quelque temps après au savoir A, la musique romantique, nous constatons que nous avons perdu des informations sur ce savoir. D’une part, parce qu’une partie de ma mémoire s’est perdue, d’autre part et c’est le point important parce que ce savoir a évolué dans son environnement intellectuel et historique. A fortiori, cette perte se multiplie et se complexifie si nous voulons étudier un savoir C, puis un autre D, etc. à l’infini.
Nous pouvons même avancer plus loin : l’étude même du thème B demande de parcourir les différentes formes, déclinaisons, objets de notre étude, mais au fur et à mesure que nous nous attardons sur tel ou tel point, d’autres parties de ce même savoir B se sont transformées… Et j’irai encore plus loin : au fur et à mesure que j’étudie ce savoir B, c’est la perspective elle-même qui se transforme. Ainsi telle musique que j’attribuais à une tradition tzigane, je découvre qu’elle a des accointances avec la musique roumaine ou polonaise etc.
Ce qui est exprimé ici à travers un exemple de connaissance étalée dans le temps, l’est aussi dans l’immédiat, en raison des multiples influences de l’humeur, des échanges énergétiques avec l’écosystème, des soucis et des intentionnalités cachées.
Toute connaissance est en évolution permanente parce que nous habitons un monde vivant, sans cesse créatif et imprévisible dans nombre de ses processus, et non un monde d’objets immobiles, sans relation autre que le fait d’être posés les uns à côté des autres, comme des cubes. Il peut être intéressé, puisque je les ai évoqués, de se demander ce qui s’est ensuite passé chez Bartok par exemple, à la fois formé dans la tradition allemande et slave, et dans l’expérience des campagnes hongroises ? Pour synthétiser ses études et ses connaissances, il a construit sa propre oeuvre personnelle où on sent l’influence de toutes ses analyses. Il lui est impossible de tout connaître, soit des formes et figures musicales de son temps, soit de leur évolution. La singularité de l’oeuvre de Bartok, géniale je l’avoue, permet de s’ouvrir sur d’autres espaces musicaux. Dès lors, on peut comprendre qu’un professeur expérimenté préfère transmettre à ses étudiants sa propre pensée plutôt qu’un catalogue encyclopédique de savoirs. J’ai le souvenir d’enseignants prodigieusement ennuyeux dont le cours consistait à accumuler les citations d’auteurs et les références bibliographiques.
Nous sommes des êtres physiques, matériels, vivants. Dans le concret de l’étude, il y a des limites à déterminer. Ces limites peuvent être circonscrites dans deux directions : d’une part, le fonctionnement même de la pensée qui se déroule dans le temps et qui ne peut embrasser tout à la fois ; d’autre part, la capacité de la mémoire à enregistrer tout le savoir. Par conséquent, la connaissance d’un sujet précis A, se paie d’une dépense d’énergie mentale et physique qui exige du temps d’étude et d’appropriation, et aussi du ménagement de soi. Personne ne peut tout embrasser instantanément, même le plus grand des génies. Toujours dans le domaine musical, j’entends souvent des âneries concernant par exemple Mozart : Mozart enfant était génial, mais il ne faisait jamais que répéter, plus vite que les autres, ce qu’on lui avait appris. Ce n’est que plus tard, à l’âge adulte, qu’il a composé une oeuvre personnelle. Pour ma part, je trouve ses œuvres de jeunesse d’une grande banalité. La connaissance, c’est-à-dire un panorama d’idées, de représentations reliées entre elles, dans l’espace intérieur, demande du temps et de l’énergie.
*
La deuxième forme d’indétermination est associée à la profondeur ou à la superficialité supposée, mais que je traduirais autour des concepts de singularité et de globalité. Venons-en à notre thème. J’entends un jour, dans les couloirs de mon lieu de travail (un centre théologique), une personne me dire « qu’Edgar Morin, c’est loin d’être aussi profond que Simone Weil », même si cette personne a admis que les deux auteurs l’avaient intéressée. Admettons. Je n’ai pas eu le réflexe de répondre : « oui, mais Simone Weil, c’est loin d’être aussi superficiel qu’Edgar Morin ! »
Supposons maintenant que je m’intéresse à un auteur Lambda, par exemple Leibniz dont on a parlé. Je le fais exprès parce que Leibniz passait pour un très grand érudit et parfois pour un philosophe un peu superficiel, au sens courant du terme, notamment dans sa théodicée… et objet, comme on le sait, de l’ironie d’un auteur aussi « profond » que Voltaire. À titre personnel, je les aime bien tous les deux ! Le « profond » théologien Urs von Balthasar, par exemple, assassine assez méchamment le « superficiel » Leibniz dans la Métaphysique de « la Gloire et la Croix ». L’idée que Leibniz est superficiel, toujours au sens courant du terme, n’est pas pertinente. Il a soulevé des questions essentielles, auxquelles il a parfois donné de mauvaises réponses ou des réponses peu crédibles aujourd’hui, mais il a eu le mérite de les poser en des termes différents des « profonds » universitaires de l’époque.
Revenons au point de départ : je deviens spécialiste de lambda, Leibniz. Supposons que je n’étudie que lui, ses livres, ses idées, l’évolution de ses idées. Plus je creuse sa pensée, plus je perds de vue ce qu’écrivent les autres, dans l’espace, dans le temps… Au début, j’arrive à le repérer par rapport à d’autres penseurs, je parviens tant bien que mal à le situer dans son contexte, mais au fur et à mesure que je me familiarise avec sa pensée, l’obscurité m’envahit. En effet, je creuse une singularité, une pensée personnelle, ce qui signifie que je la différencie de celle des autres par négations successives : Leibniz se différencie de Descartes, de Malebranche, d’Aristote etc. sur tel ou tel point… À la limite, j’insiste bien sur cette limite qui est bien sûr inaccessible, plus je crois connaître l’identité de Leibniz, plus je l’isole des autres, voire de moi-même. Ce qui vrai de l’étude d’un auteur ou d’un thème, l’est aussi, dans la vie courante, de l’expérience de la connaissance de son voisin, de son collègue de travail, et a fortiori de l’amitié ou de l’amour. Si vous dites à quelqu’un que vous l’aimez pour telle ou telle raison, c’est-à-dire par comparaison ou par effectivité par rapport à telle ou telle cause « profonde » cachée, l’amour n’est pas vraiment unique. L’aimé(e) n’est pas vraiment singulier à vos yeux. Il faut pouvoir dire à l’autre que vous l’aimez pour lui-même, ce qui est bien sûr une finalité impossible à atteindre en soi, mais qui marque une tension vers l’avenir. Quand on approfondit un sujet, un thème ou une relation humaine, on débouche toujours sur une interrogation sur l’amour.
Bien. Maintenant, prenons l’autre bout. Au lieu de m’intéresser à un sujet Lambda précis, je m’intéresse à toute une époque et je regarde les correspondances, les ressemblances des uns et des autres : je vais multiplier les liens et les relations, par exemple de Lambda, avec tout le contexte social, culturel, idéologique, naturel, voire mental de l’époque. Je vais bâtir de beaux schémas où je vais montrer l’influence de tel courant, de tel phénomène ou de telle superstructure sur Lambda, sur Alpha ou sur Epsilon. J’étalerai « en surface », sur un plan intellectuel, sur un plan tout court, les positions et les relations d’Alpha, de Lambda, d’Epsilon. Ce sera un étalage « superficiel », sans ombres, sans relief, sans « profondeur », digne d’être traduit en « slades » pour « power point ». Je peux donc être un érudit, mais superficiel. Je balaierai en surface toute une époque… et je peux même m’amuser à relier cette époque à d’autres époques, trouver des parallèles, des liens, des relations de cause à effet, des globalités et des généralités. J’étalerai mon savoir… Mais bien sûr, je perdrais au fur et à mesure la singularité personnelle, l’unicité d’Alpha, d’Epsilon et par exemple de Lambda, c’est-à-dire Leibniz.
La seconde forme du « principe d’indétermination épistémologique » que je propose consiste à rappeler que je ne peux pas approfondir un sujet sans connaître les relations que ce sujet possède avec son environnement… c’est-à-dire que je ne peux prétendre à une pensée profonde, localisée, singulière sans me servir des connaissances superficielles, lesquelles serviront de référentiel à ma pensée. Inversement, si je veux bâtir un savoir élargi, voire global sur un thème, et donc multiplier les relations internes et externes, il me faut connaître de plus en plus précisément la position des éléments. Pour comprendre la philosophie des XVIIème et XVIIIème siècles, je dois multiplier les relations qui existent entre les auteurs, bâtir des schémas qui récapitulent tel ou tel point de vue… Mais à la limite, une connaissance totalement profonde sur un sujet est impossible car elle conduit à la nuit de la connaissance, et une connaissance globale qui embrasse tout est toute aussi impossible car elle perd toutes les singularités et toutes les identités. La connaissance superficielle et la connaissance profonde s’alimentent l’une l’autre. Simone Weil a besoin d’Edgar Morin, et Edgar Morin a besoin de Simone Weil.
J’ajouterai toutefois une nuance : les seuls sujets sur lesquels nous pouvons avoir une connaissance complète, globale sont les sujets limités, déterminés, dont les frontières sont définies. Ce sont en fait les sujets morts, c’est-à-dire ceux qui sont clos et qui n’évoluent plus. Les sujets clos se rapetissent au fur et à mesure que le savoir humain s’étend. Les sujets morts se décomposent : d’où le paradoxe. C’est une loi de la nature, c’est une loi de la vie, c’est même une loi physique de l’énergie… J’ai un savoir complet sur un sujet : mais c’est un savoir mort, sans vie, sans avenir, sans créativité, sans évolution. Il y a une conséquence : un système fermé qui pense être vrai est un système mort qui n’a pas d’avenir… et s’il devient totalitaire et conquérant, il se comporte comme un cancer qui se développe dans l’organisme. La spécialisation et la créativité des cellules et des interactions entre cellules cèdent la place à des cellules clones qui se répètent indéfiniment. Ce qui est vrai dans l’organisme l’est aussi dans les sociétés. Les mouvements intégristes d’un côté, totalitaires de l’autre, sont des cancers sociaux. Les personnes se reproduisent comme des clones, identiques les uns aux autres… et peuvent menacer la vie sociale dans sa multiplicité, et la variété de ses individus, de ses groupes et des relations entre eux. Et parce que je travaille dans un centre théologique, j’affirme qu’une théologie qui se prétend achevée, et qui prétend se couper du monde et de l’écosystème est une théologie mortifère. Si elle prend le pouvoir, elle peut devenir un cancer dans l’espace de la théologie et plus largement, dans le temps de l’humanisation.
La meilleure manière de rester vivant, c’est de se construire soi-même dans sa singularité, en sachant que cette singularité s’approfondit dans la relation aux autres sujets, aux autres singularités, mais aussi au monde, à la nature. Tout cela pour dire que, comme dans la vie de tous les jours, la pensée est une acrobatie permanente, un travail de funambule. La vie est un risque, et la mise au monde est un risque. Ainsi en est-il de la pensée. Et j’encourage chacun à faire l’aller-retour permanent entre la connaissance dite superficielle (celle qui se cultive, devient érudite et apprend à se dire, s’étaler et se répandre : une connaissance spatiale) et la connaissance dite profonde qui est une connaissance de plus en plus personnelle, intime, amoureuse même, de l’autre, de l’autre sujet ou de l’autre objet, et surtout de soi.
À titre personnel, je revendique le droit d’être un penseur ou un praticien « superficiel » et même, pourquoi pas, de passer aux yeux des uns et des autres pour quelqu’un de superficiel. Mais aussi le droit d’être « profond » à ma manière. Et cela ne se communique pas, excepté dans un climat d’amitié et de confiance.