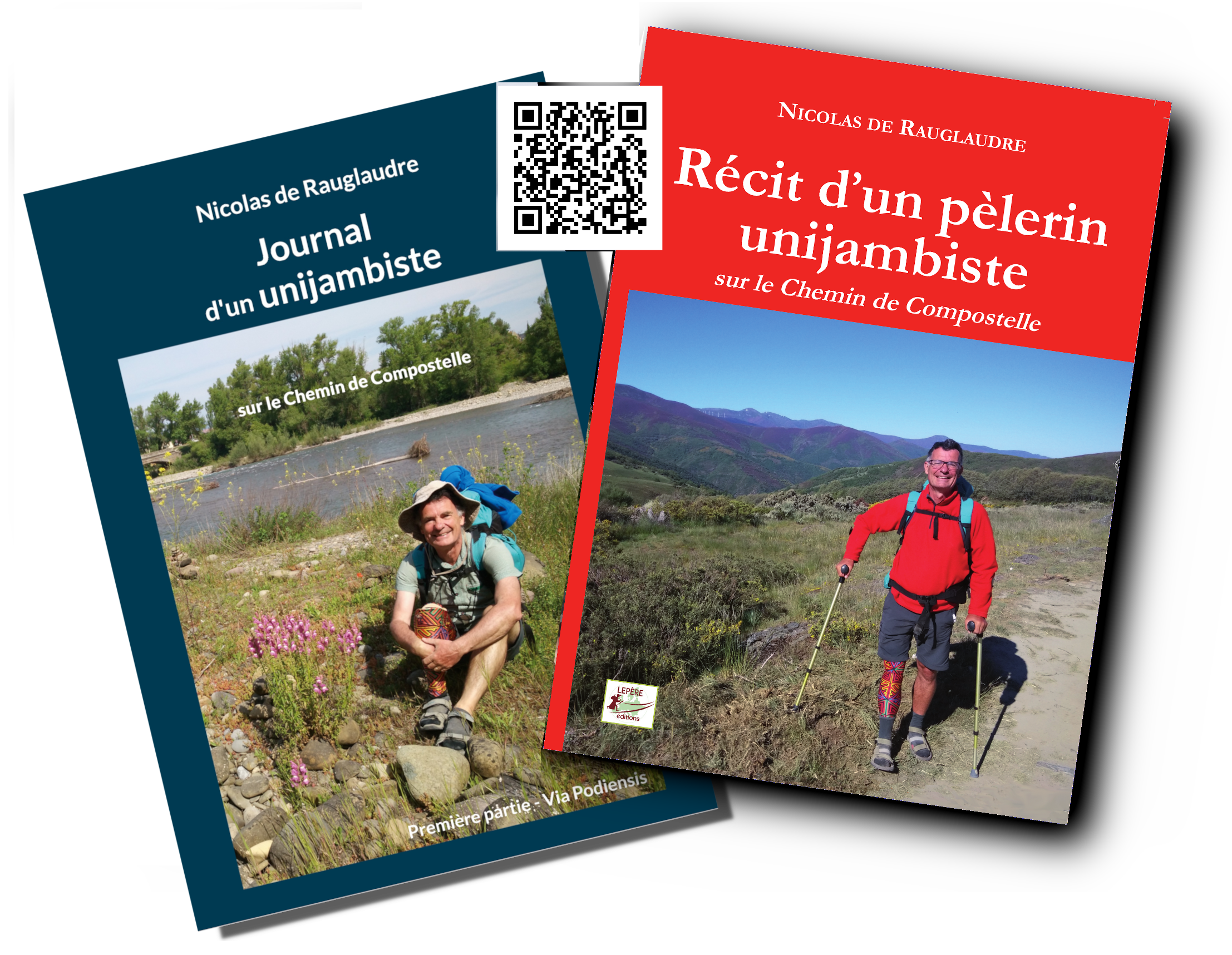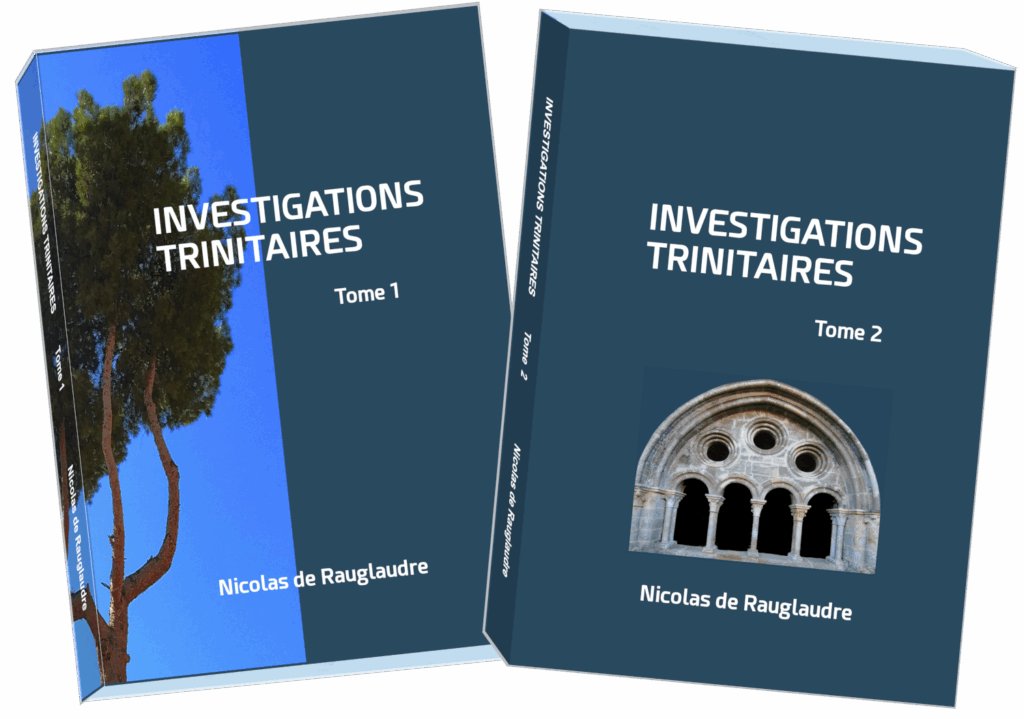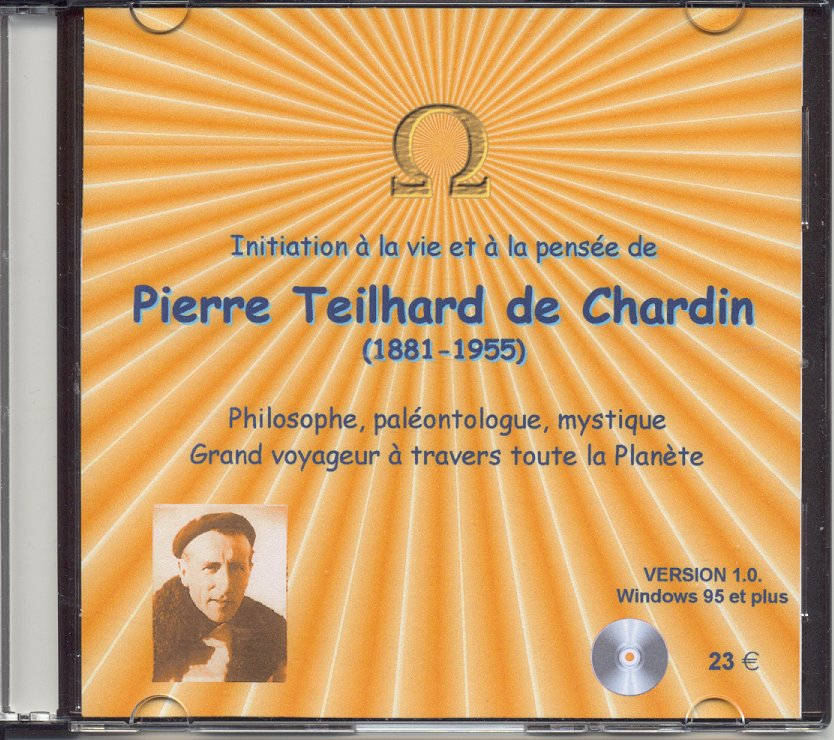ci j’aborde la question de la liberté, démocratique et éthique, face aux alibis du libéralisme d’un côté, de l’écologisme pressé de l’autre. Pour cela, quelques distinctions et quelques interactions s’imposent entre la liberté d’indépendance, la liberté d’autonomie et la liberté comme process.
ARTICLE COMPLET EN CLIQUANT SUR L’IMAGE
1. Introduction
1.1. L’espace et le temps
1.2. Schémas méthodologiques
(voir article précédent)
1.3. Relecture conceptuelle
Aborder la créativité dans le développement durable d’un point de vue philosophique pourra sembler stérile à certains. La crise écologique qui affleure à l’horizon et qui est déjà active à bien des échelles semble avant tout exiger des mesures d’urgence politiques et économiques. Par conséquent, il est préférable de suivre le célèbre principe marxiste selon lequel la philosophie qui servait autrefois à penser le monde, doit désormais être au service des actions pour le changer.
Mais il y a un problème de fond. La crise écologique et énergétique exige non seulement des actions concrètes, indispensables, mais elle annonce aussi un profond bouleversement de paradigme. Le marxisme traditionnel, celui du dix-neuvième siècle, était encore dans la continuité de la philosophie des Lumières et de l’idéalisme allemand, retourné en matérialisme par nécessité sociale et économique. Et même si l’on voit au-delà et qu’on remonte au triomphe de la philosophie du sujet à partir de la Réforme protestante, puis de la philosophie de Descartes, il restait à l’intérieur du projet prométhéen de domination d’une nature soumise et passive. Or la problématique d’aujourd’hui est celle d’une nature qui se réveille et d’une écosphère en danger de destruction globale, entraînant dans sa chute l’humanité elle-même. Le sujet libre n’est pas le point de départ absolu, mais un des pôles, ou si l’on préfère un des foyers, d’une interaction nécessaire entre la biosphère et la sphère humaine.
Un changement des présupposés qui dirigent l’activité humaine exige non seulement des actions et des techniques, mais aussi une pensée. Or il est vrai qu’une question travaille la plupart des personnes qui se consacrent à la réflexion philosophique : comment rendre une pensée philosophique opératoire ? En d’autres termes, comment faire en sorte que l’analyse et la dialectique des concepts débouchent sur une pratique, que ce soit selon une éthique personnelle et collective, selon une politique et des institutions juridiques, selon une approche scientifique et économique. Marx et Engels avaient réussi en leur temps ce pari, ce qui fit le succès de leur pensée. Malgré les échecs politiques du marxisme à chaque fois qu’il est arrivé au pouvoir, aux quatre coins de la Planète, tout le monde est imprégné par capillarité de l’analyse des deux philosophes allemands. Or, dans le domaine de l’écologie politique, il manque une marche dans l’escalier qui permettrait de l’intégrer : comment faire de l’écologie une préoccupation quotidienne, non seulement pour les militants et les convaincus, mais aussi pour tous. Chaque jour, nous nous levons, nous agissons, nous nous couchons en considérant l’état de nos finances et de notre budget à l’échelle personnelle, familiale ou à l’échelle de nos responsabilités économiques ou associatives, en s’interrogeant sur nos rapports de force sociaux et les solidarités qu’ils imposent. Avec bien sûr suffisamment de sagesse pour que les difficultés ne nous prennent pas la tête, ce qui est une autre affaire. En est-il autant des impératifs écologiques ?
Si l’interpellation écologique devient une charge de plus pour nos soucis déjà lourds du début du vingt-et-unième siècle, elle créera par réaction un rejet psychologique, voire réactionnaire. Par conséquent, l’écologie politique et sociale et sa mise en œuvre dans le développement durable, les agendas 21, « les » Grenelle de l’Environnement, les Assemblées internationales, les normes ISO 14000 et autres, et les RSE doivent être intériorisées et vécues comme un prolongement naturel de soi, un peu comme nos membres et nos organes obéissent aux impulsions de notre cerveau, des pulsions de notre inconscient et de notre volonté. Mise en œuvre applicative ou créative, bien sûr. Une telle intériorisation ne peut brusquer la vitesse d’assimilation des corps et des mentalités, et elle doit respecter le temps et la durée. Pour arriver à l’intériorisation des impératifs écologiques, il semble important de passer par plusieurs étapes d’appropriation non seulement collective ou militante, mais encore et surtout personnelle, des interrogations posées par le rapport à l’environnement naturel, par le développement soutenable et par la préoccupation éthique que ces interrogations engendrent. La réflexion philosophique survient là : elle a pour ambition de structurer la pensée pour qu’elle soit capable naturellement de se persuader elle-même de la pertinence des exigences posées par la crise qui se profile, et par l’action qui s’impose. Le catastrophisme ambiant, que certains croient efficace pour atteindre leurs objectifs, est un mauvais pédagogue. L’histoire l’a démontré : jouer sur la peur n’a d’effets qu’à court terme.
Il n’y a pas d’auto-persuasion sans liberté d’une part, sans respect des lois de la raison ou du moins de la pertinence de la raison d’autre part. Il n’y a pas de créativité non plus sans un minimum de connaissance des structures existantes et de la circulation d’informations. Je propose de poser la liberté sous une perspective différente et complémentaire que celle qui a émergé d’une philosophie du sujet, en l’ancrant dans la perspective plus large qu’est l’écosystème naturel, historique et humain. C’est le sujet de la partie qui suit. Puis, nous reviendrons sur quelques concepts clé et les schémas qui les accompagnent, tel celui de développement durable naturellement, celui d’écologie, mais aussi quelques autres comme « noosphère » et « noogenèse ». En fonction de la méthodologie esquissée précédemment, nous exercerons une relecture critique du célèbre schéma des trois piliers de Johannesburg, sans lui faire perdre sa signification.
1.3.1. Notre concept de liberté
La liberté fonde la modernité occidentale, voire aujourd’hui toutes les aspirations planétaires, en dépit de quelques voix qui voudraient la relativiser à une culture nord-méditerranéenne et américaine et aux zones qui ont subi son influence. La construction de la liberté a coûté des vies, a traversé des combats redoutables, son concept a connu des interprétations douteuses et déviantes. Son histoire est celle de l’humanisation et nous n’avons pas le droit de mettre en péril la liberté, même pour des raisons de bonne conscience religieuse, idéologique, éthique et écologique. Je dis cela notamment pour mettre en garde contre les écologies politiques trop pressées, qui céderaient volontiers à l’autoritarisme pour imposer les réformes nécessaires et qui risqueraient de mettre en péril le principe démocratique que l’histoire a eu tant de mal à mettre en place.
Toutefois, la liberté, dont la statue trône à l’entrée de New York et qui est inscrite sur le fronton de nos mairies, en bonne compagnie du reste, sert aussi d’alibi pour justifier des pratiques peu humaines. Ce qui est le comble pour un concept dont le processus de compréhension et de mise en œuvre fut si coûteux. C’est le cas par exemple de l’égoïsme individualiste qui se cache sous le beau nom de libéralisme. Le libéralisme a une histoire complexe et longue. Il n’est pas question ici d’en développer toutes les faces et toutes les formes historiques qu’il a pris. Comme expérience et mémoire historique, il a eu ses bons et ses moins bons côtés, surtout après deux siècles d’accroissement de la population mondiale, de bouleversement technologique, de développement économique et social des nations, d’affirmation du modèle démocratique. Il s’agit dans l’essai présent du libéralisme sous sa forme d’archétype idéologique que certains prétendent sans alternative. Le libéralisme, tel qu’il est compris médiatiquement par ses défenseurs et ses détracteurs, privilégie une polarité particulière de la liberté, même si dans l’histoire, le libéralisme a aussi eu des effets pratiques bénéfiques.
(…)
Suite dans l’article complet en pdf