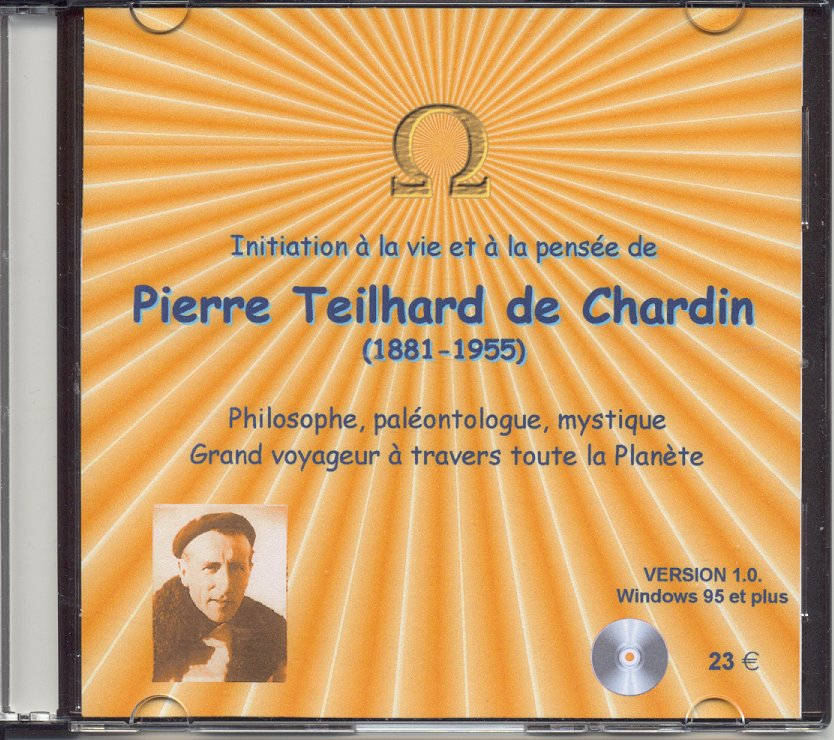Résumé : Debussy est incontestablement le musicien que j’ai le plus de plaisir à jouer sur le piano. Quand un philosophe médiatique donne son opinion, cela est assurément digne d’intérêt… quoique ses conclusions soient discutables. NB. J’avoue n’avoir pas eu le courage de lire son livre…
Il y a un avantage des journées de grève sur les radios publiques. Elles permettent d’écouter d’intéressantes émissions anciennes et d’ainsi se rafraîchir ou repeupler la mémoire. Il y a quelques jours, j’entendais Michel Onfray, l’homme qui sait tout sur tout, parler de la musique sur France Culture. De fait, aux débuts des années 2010, il a écrit, en dialogue avec un compositeur de musique, un essai assez volumineux consacré à la musique classique : « la raison des sortilèges ». Comme j’ignorais l’existence de ce volume, j’en ai profité pour lire çà et là quelques extraits choisis sur internet. Le titre provient de la pièce musicale « l’enfant et les sortilèges » de Maurice Ravel. Michel Onfray ne craint pas de se proclamer héritier dissident de philosophes musiciens ou musicologues, tel Schopenhauer, Adorno ou Jankélévitch, et surtout de son maître et inspirateur Nietzsche.
 Revenons à l’émission de France Culture. L’obsession de Michel Onfray à se référer, comme à un leitmotiv, à son point de vue philosophique « moi qui suis matérialiste » m’a donné le sentiment qu’il n’écoutait la musique que sous l’angle intellectuel. D’ailleurs, j’ai cru comprendre que cela faisait partie de son credo, à savoir qu’il n’existe pas de musique en soi. Angle intellectuel et angle réductionniste : l’ouïe ne serait qu’un développement particulier du seul sens réel, le sens du toucher. Ce n’est pas idiot en soi, selon sa perspective matérialiste. Par l’ouïe, nous « touchons » un aspect de la réalité non tactile, celui des sons, très exactement celui de la réalité des ondes mécaniques qui environnent le corps. L’oreille n’est qu’un prolongement perfectionné de la peau, un des divers modes du toucher par-delà le contact direct. De même, le corps touche le monde électro-magnétique lumineux par la vue. Quant aux odeurs, parfums, ils sont captés par une capacité cervicale de saisir la géométrie des molécules et leurs isomères.
Revenons à l’émission de France Culture. L’obsession de Michel Onfray à se référer, comme à un leitmotiv, à son point de vue philosophique « moi qui suis matérialiste » m’a donné le sentiment qu’il n’écoutait la musique que sous l’angle intellectuel. D’ailleurs, j’ai cru comprendre que cela faisait partie de son credo, à savoir qu’il n’existe pas de musique en soi. Angle intellectuel et angle réductionniste : l’ouïe ne serait qu’un développement particulier du seul sens réel, le sens du toucher. Ce n’est pas idiot en soi, selon sa perspective matérialiste. Par l’ouïe, nous « touchons » un aspect de la réalité non tactile, celui des sons, très exactement celui de la réalité des ondes mécaniques qui environnent le corps. L’oreille n’est qu’un prolongement perfectionné de la peau, un des divers modes du toucher par-delà le contact direct. De même, le corps touche le monde électro-magnétique lumineux par la vue. Quant aux odeurs, parfums, ils sont captés par une capacité cervicale de saisir la géométrie des molécules et leurs isomères.  Ce qui m’impressionne toujours que je promène notre chienne Aïka et qu’elle est perçue (sentie) par d’autres chiens à des centaines de mètres. Ne parlons pas du goût, car son lien avec le toucher est évident.
Ce qui m’impressionne toujours que je promène notre chienne Aïka et qu’elle est perçue (sentie) par d’autres chiens à des centaines de mètres. Ne parlons pas du goût, car son lien avec le toucher est évident.
Bref, le seul sens évident, celui qui fonde les autres, est le toucher. Il permet l’interaction du corps, comme structure matérielle avec ses métabolismes, dans son environnement immédiat. Les autres sens permettent d’étendre le toucher dans l’espace au-delà de la peau, grâce à leur perception des ondes mécaniques, électro-magnétiques, aux géométries moléculaires, etc. Michel Onfray est fidèle à son postulat matérialiste, même s’il faut bien avouer que cette vision de la sensibilité reste un peu faible. N’ayant pas lu son livre, je suppose que Michel Onfray considère la musique et les autres arts sans doute, gastronomie comprise, comme de simples épiphénomènes produits par quelque phosphorescence sur une matière locale (sur la Planète Terre, en l’occurrence), en vue de s’appréhender fugitivement elle-même, avant de sombrer dans le néant. Bon admettons : c’est sa logique d’hédoniste, admiratif des atomistes grecs, Démocrite, Épicure et sans doute Lucrèce. Et bien sûr Nietzsche et sa « physique ».
À titre personnel, il m’a toujours paru que le monisme matérialiste est plus cohérent que le vieux dualisme matière-esprit, ou l’autre qui lui est attaché : corps-âme. Je serais malhonnête si je n’avouais pas ma fréquentation et mon attirance vers les atomistes grecs, mais aussi vers Lucrèce, relu par Michel Serres, qui m’ont permis de me libérer d’un essentialisme spirituel qui s’opposerait à la matière, et qui m’a pas mal empoisonné l’existence. Mais Teilhard (et derrière lui, Aristote) m’a (m’ont) aussi permis de percevoir de plus en plus la « puissance spirituelle de la matière », ce qui me conduit aujourd’hui à lire plus encore de cohérence dans un monisme spiritualiste que dans le matérialisme, sans sombre dans l’essentialisme. Comme apprenti physicien quelque peu informé, je suis toujours amusé quand on parle de matière : c’est quoi en fin de compte ? Aristote avait exprimé qu’en définitive, à force de généralisation et d’extension, la notion de « matière » n’était jamais qu’une abstraction. Par ailleurs, il existe un autre monisme qui me touche : celui de la Bible -où il n’est pas question de dualité âme et corps, mais d’histoire, d’alliance et d’existence humaine. L’anthropocentrisme biblique, centré sur le corps comme présence au monde et lieu de la parole et de la communication -pour employer des mots d’aujourd’hui- est cohérent. D’ailleurs peut-on être autre chose qu’anthropocentrique quand on fait de la philosophie ? Voire égocentrique -avec prudence, toutefois, en raison du langage qui nous lie essentiellement aux autres.
Retournons à la musique. Dans l’émission de France Culture, Michel Onfray évoque Ligeti, Wagner, Schoenberg, Berlioz, Debussy, et bien d’autres, dont des compositeurs contemporains que je ne connais que de nom. Il reconnaît sa préférence pour le Romantisme, ce qui est inattendu de la part de quelqu’un qui se réfère au matérialisme. Pas au matérialisme marxiste, en tout cas. Paradoxalement, et je ne le contesterai sûrement pas sur ce point, il place Bach au-dessus de tous les musiciens. Je partage son point de vue. Je suis bien obligé de reconnaître sur ce point son honnêteté intellectuelle. Bach reste, en effet, le plus profond musicien religieux que la Terre ait porté. De la part du philosophe athée et anti-religieux, cette reconnaissance est sympathique.
 Revenons à Berlioz et à Debussy. Le Debussy, des Préludes et des Études notamment, est le type de musicien qui conduit au silence. Michel Onfray cite Vladimir Jankélévitch qui a écrit un magnifique livre « Debussy et le mystère de l’instant », que j’ai lu dans ma jeunesse et que j’ai donné à un jeune mélomane quelques années plus tard… et qu’il me faudra retrouver parce que j’ai vu sur internet qu’il était épuisé [Dernière info : non, il existe encore]. Michel Onfray explique qu’il se situe très loin de Jankélévitch et de sa vision assez « spiritualiste » (mais je ne suis pas sûr que ce dernier aurait accepté ce qualificatif). Pas étonnant. Là où Onfray et Jankélévitch s’accordent, c’est que la musique de Debussy conduit au silence. Un silence qui est aussi de Debussy, en paraphrasant une remarque que m’a rappelée récemment une amie, à savoir que « le silence qui suit la musique de Mozart, est également de Mozart ». En ce qui concerne Mozart, je n’ai pas le sentiment que sa musique conduit au silence, comme celle de notre musicien français, ou comme par exemple, celles de Jean-Sébastien Bach, d’Alban Berg, ou certaines musiques de Gustav Mahler. Michel Onfray semble ne pas aimer ce Debussy qui conduit vers une sorte de suspension de la musique au-dessus du silence. Du mystère du silence.
Revenons à Berlioz et à Debussy. Le Debussy, des Préludes et des Études notamment, est le type de musicien qui conduit au silence. Michel Onfray cite Vladimir Jankélévitch qui a écrit un magnifique livre « Debussy et le mystère de l’instant », que j’ai lu dans ma jeunesse et que j’ai donné à un jeune mélomane quelques années plus tard… et qu’il me faudra retrouver parce que j’ai vu sur internet qu’il était épuisé [Dernière info : non, il existe encore]. Michel Onfray explique qu’il se situe très loin de Jankélévitch et de sa vision assez « spiritualiste » (mais je ne suis pas sûr que ce dernier aurait accepté ce qualificatif). Pas étonnant. Là où Onfray et Jankélévitch s’accordent, c’est que la musique de Debussy conduit au silence. Un silence qui est aussi de Debussy, en paraphrasant une remarque que m’a rappelée récemment une amie, à savoir que « le silence qui suit la musique de Mozart, est également de Mozart ». En ce qui concerne Mozart, je n’ai pas le sentiment que sa musique conduit au silence, comme celle de notre musicien français, ou comme par exemple, celles de Jean-Sébastien Bach, d’Alban Berg, ou certaines musiques de Gustav Mahler. Michel Onfray semble ne pas aimer ce Debussy qui conduit vers une sorte de suspension de la musique au-dessus du silence. Du mystère du silence.
Debussy est incontestablement le musicien que je préfère jouer au piano. Bien plus que Chopin, que Schubert, Bartok ou Beethoven. Plus que Ravel ou Albeniz. Bien sûr, j’admets que le personnage, surtout à la fin de sa vie, est assez détestable. Mon répertoire personnel ne doit pas être très loin de deux heures de sa musique, bien que nombre de ses compositions soient très techniques… surtout dans son rapport au pianissimo et justement au silence. Après avoir joué notre musicien national, je ne suis plus capable d’interpréter autre chose. Un calme mystérieux me remplit et me fait goûter à la fois l’instant et la durée, pour reprendre l’expression de Jankélévitch, bien au-delà de tout sentiment et de toute pensée, voire au-delà de l’espace et du temps qui passe. Difficile à exprimer. Une musique en soi.
 Michel Onfray n’apprécie pas. Il confie qu’il préfère nettement Berlioz, ses chants, ses bruits et fureurs romantiques, les portes et les fenêtres qu’il ouvre vers la musique du XIXème siècle. Bon, il n’a pas dit cela exactement, mais en effet, derrière Berlioz, se profilent à la fois un chemin de tradition de musique française, lyrique et magnifiquement orchestrée, et une part du grand romantisme allemand et ses vagues dans toutes les nations qui se révoltent et s’affirment. Je soupçonne Michel Onfray d’avouer sa préférence pour Berlioz, non pour des raisons musicales, mais pour des raisons idéologiques : les révolutions, les mouvements de libération, l’agitation des peuples… et peut-être aussi un chouïa de Nietzsche. De telles raisons sont plus sexy à ses oreilles que celle de musiques qui conduisent au silence. Elles sont plus dionysiaques et moins apolliniennes…
Michel Onfray n’apprécie pas. Il confie qu’il préfère nettement Berlioz, ses chants, ses bruits et fureurs romantiques, les portes et les fenêtres qu’il ouvre vers la musique du XIXème siècle. Bon, il n’a pas dit cela exactement, mais en effet, derrière Berlioz, se profilent à la fois un chemin de tradition de musique française, lyrique et magnifiquement orchestrée, et une part du grand romantisme allemand et ses vagues dans toutes les nations qui se révoltent et s’affirment. Je soupçonne Michel Onfray d’avouer sa préférence pour Berlioz, non pour des raisons musicales, mais pour des raisons idéologiques : les révolutions, les mouvements de libération, l’agitation des peuples… et peut-être aussi un chouïa de Nietzsche. De telles raisons sont plus sexy à ses oreilles que celle de musiques qui conduisent au silence. Elles sont plus dionysiaques et moins apolliniennes…
Le silence, pour Onfray, est vide. Pour moi, c’est le contraire. En n’omettant pas que le silence est lié à l’ouïe et donc aussi à « l’entendement » (au sens philosophique du terme), le silence est empli de l’univers. Le silence éternel des espaces infinis ne m’effraie pas du tout. Bien au contraire, il m’émerveille. Le silence est la musique qui vient de l’infini. D’ailleurs, soit dit en passant, les espaces infinis ne sont pas si silencieux que cela !
Ici, se pose donc la question du rapport de la musique à l’idéologie. Idéologie politique, philosophique ou religieuse. Ce rapport est aussi un combat personnel.

Hitler lors d’une représentation des Carmina Burana de Orff
J’avoue être réticent à l’égard de Carl Orff et ses Carmina Burana, en raison de son flirt avec les nazis. J’ai des difficultés à apprécier Chostakovitch dont la musique, trop fréquemment tragique et désespérée, sarcastique parfois, a du mal à se dépêtrer de la pression stalinienne, même si sa vie a été courageuse sur la fin. Du côté soviétique et communiste, il y a des musiciens que j’ai appréciés… et qui sont malheureusement quelque peu bannis aujourd’hui. Inversement, les viennois, Berg, Schoenberg, un peu moins Webern, m’attirent pour leur musique, mais aussi parce qu’ils étaient honnis des deux totalitarismes. Il faut donc faire la part des choses et lutter contre ses propres répulsions et attractions. Avec un groupe d’amis, nous écoutons fréquemment divers musiciens, sans a priori ou presque, et nous étendons ainsi notre capacité d’écoute. Il est absurde, par exemple, de considérer Wagner comme un nazi, même si son antisémitisme était notoire et que sa belle fille était une amie d’Adolf Hitler et une de ses propagandistes. Karajan ou Furtwängler ont fricoté avec les nazis, mais leur direction orchestrale restent des références. Même Richard Strauss s’est parfois compromis avec Goebbels et autres (in)dignitaires du Troisième Reich. Bon, j’arrête là, car je vais écrire des sottises. Stop sur le sujet.
… Ou pas tout-à-fait stop. Michel Onfray préfère Berlioz à Debussy. OK. Il se réfère aussi continuellement à Nietzsche, son mentor en fin de compte. Tout le monde sait, ou presque, que Nietzsche s’est détourné de Wagner après une violente dispute sur la direction que prenaient les opéras : Tristan et Isolde, et Parsifal, si je me souviens bien.

Jessie Norman chante Carmen
Nietzsche s’est alors rapproché de Bizet, en raison de l’opéra « Carmen » où une bohémienne défie l’ordre militaire, religieux et bourgeois, vision qui correspondait mieux à son attente philosophique. Nouvel os : est-ce que Carmen vaut mieux, musicalement parlant, que Tristan ? Je n’en sais rien. La musique est plus simple, plus sexy et plus attrayante. J’aime les deux opéras. Il est difficile, mais possible, de s’abstraire des emprises idéologiques sur la musique. Combien de fois ai-je entendu que Brahms était beaucoup plus conservateur que Wagner, bien plus bourgeois que révolutionnaire. Aujourd’hui, je trouve que sa musique du hambourgeois est plus novatrice que celle du fondateur de Bayreuth. Bien évidemment, j’exclue de ma réflexion les musiques délibérément au service des tyrans.

Revenons à Debussy, au mystère de l’instant et du silence. Vladimir Jankélévitch qui est un bergsonien avoué, mais aussi un ancien résistant qui a risqué sa vie durant l’Occupation, reconnaît et écrit son amour de Debussy dont la musique est la meilleure manière de se détacher de la musique à thème, et au spectacle total porteur d’un message, comme l’était celle de Wagner. Il ne faut pas se fier aux titres indiqués dans ses œuvres, titres qui décrivent plutôt des impressions atmosphériques et fluides plus que des idées. La musique en soi, au sein de son propre espace, n’est-elle pas le meilleur moyen de se sortir de ses intentions idéologiques à prétention intellectuelle ? Et là, je conteste vivement la position de Michel Onfray quand il accuse Debussy de glisser vers l’abstraction. Il n’y a pas moins de sensibilité et d’émotion musicale dans « Ondine » ou dans « Pour les arpèges composées » que dans le bel orgasme féminin que représente (à mes yeux) la musique de la mort d’Isolde. Seulement, cette sensualité, cette émotion, est ailleurs. Elle se situe dans cette ouverture au silence des choses et au concret de l’instant, ouverture que j’oserai appeler « métaphysique »… alors que finalement, la musique de Wagner, et pourquoi pas celle de Berlioz, restent sur le terrain de la mythologie et des sentiments. Michel Onfray est peut-être beaucoup plus sentimental qu’il ne le confesse… mais je ne pense pas que je prendrais le temps de lire son livre. J’essaierai de retrouver ceux de Jankélévitch.
Pour conclure, voici ce que mon épouse m’a confié, tandis que je lui faisais part de mon écoute de l’interview sur France Culture : « Finalement, Michel Onfray a peur du silence ».